Le projet de reconstruction de l’ex-marché central de Bujumbura, une infrastructure emblématique, se trouve aujourd’hui au cœur d’une polémique qui ne cesse d’enfler. Au centre des débats : l’attribution hautement contestée du marché, sans appel d’offre, à la société Ubaka nation group, dirigée par Fablice Manirakiza. Pour certains observateurs, ce projet crucial pour le développement économique ne doit pas devenir un symbole supplémentaire de la mauvaise gouvernance qui gangrène le pays.
Le 2 septembre 2024, une convention préliminaire pour la mise à disposition du terrain qui abrite l’ex-marché central de Bujumbura a été signée entre le ministre en chargé des infrastructures, Dieudonné Dukundane, et Fablice Manirakiza, représentant l’entreprise Ubaka nation group.
Cette entreprise avait un délai de six mois pour non seulement prouver sa capacité de financement mais aussi finaliser les conceptions définitives. Un accord qu’il avait reçu de la part du président de la République, Evariste Ndayishimiye.
C’était lors de la semaine dédiée à la diaspora à Kayanza qui s’est tenue en juillet 2024. Le jeune entrepreneur avait expliqué au chef de l’Etat qu’il peut construire 5 complexes et une tour de 30 étages sans recourir au financement de l’Etat.
Dans la foulée, Fablice Manirakiza a commencé à collecter des fonds avec une action à 103 000 BIF pour ceux qui sont au pays et 100 dollars US pour ceux de la diaspora burundaise. Le 16 septembre 2024, les travaux de préparation du terrain pour la construction de ce complexe commercial ont été lancés par Ubaka nation group. Depuis, les travaux sont aux arrêts. Certains observateurs doutent déjà de la capacité de cette société à conduire à bon port ce projet.
Les six mois sont déjà écoulés et rien ne pointe à l’horizon. Lors de la dernière Table ronde des investisseurs qui s’est tenue à Bujumbura du 5 au 6 décembre 2024, la reconstruction de l’ex-marché de Bujumbura en un complexe commercial figurait parmi les grands projets du gouvernement avec un coût estimé à 400 millions de USD. Une question taraude alors les esprits : Qui va réellement exécuter ce projet ?
Les ex-occupants se posent mille et une questions
« Que voulez-vous qu’on dise ? Le 27 janvier 2013 reste une journée noire pour nous et nos familles. Notre vie a basculé. On a tout perdu et nous n’avons plus espoir de réoccuper nos stands », lâche le prénommé Bosco, un ancien commerçant de l’ex-marché central de Bujumbura. Désemparé, il dit même que s’il advenait qu’il soit reconstruit, il n’y a plus de place pour lui. « Ça fait combien d’années qu’on nous chante qu’on va réhabiliter ce marché ? Même quelques mois après l’incendie, des informations ont circulé disant que les partenaires du Burundi allaient le faire. Mais, voilà, jusqu’aujourd’hui, c’est la même chanson. Qu’on arrête de se moquer de nous ! »
Cet ancien commerçant de matériel de bureau trouve qu’il n’y a pas eu de volonté : « Comment est-ce qu’un pays indépendant peut passer des années et des années sans reconstruire son poumon économique ? Depuis 2013, il y a eu au moins deux processus électoraux. Ça a coûté combien ? »
Interrogé sur le projet d’Ubaka nation group, il croit à une pièce de théâtre. « Je n’y crois pas. C’est une comédie. D’habitude, pour un tel projet, c’est via un marché public en bonne et due forme que cela doit passer. Et un certain matin, quelqu’un dit qu’il veut reconstruire ce marché et aussitôt dit, le marché lui est accordé. »
Pour lui, l’avenir nous le dira. Et de s’interroger : « Quel sera le sort des anciens occupants de ce marché au moment où on nous dit que l’argent pour sa réhabilitation proviendra des actions des uns et des autres ? Qui sont ces anciens commerçants capables d’y mettre des actions après avoir subi cet incendie ? »
Pour sa part, le nommé Bukuru dénonce l’opacité qui entoure cet octroi du marché. « Pour des projets nationaux, nous entendions des appels d’offres à la radio, une compétition des investisseurs. Mais, voilà, un marché en termes de milliards de dollars gagné gré à gré. Ça fait rire. » Il trouve également anormal qu’un entrepreneur dit qu’il va réhabiliter le marché avec de l’argent collecté ici et là. « Qu’est-ce qui lui garantit qu’il en aura en suffisance ? »
Pour lui, c’est peut-être une façon de s’approprier de cet espace. « Et je ne crois pas que cet homme, Fablice Manirakiza, est l’initiateur de ce projet ? Doutons ! »
Il indique d’ailleurs qu’il y a une confusion. « Un jour, j’écoutais la radio. C’était lors d’une grande réunion économique organisée à Bujumbura. J’ai entendu l’ancien ministre des Finances dire que parmi les projets prioritaires de l’Etat, il y a aussi la reconstruction de l’ex-marché central de Bujumbura. Qui va alors le faire entre le gouvernement et Ubaka nation group ? » Il craint lui aussi que si, par hasard, ce marché venait à être reconstruit, les anciens occupants n’auront pas de places. « L’attente est déjà longue. Beaucoup de ceux qui possédaient des stands-là ont presque tout perdu. Il n’y en a même qui ont été traumatisés et qui sont morts laissant des veuves et des orphelins. Ces derniers n’ont pas d’actions à mettre dans Ubaka nation group. Donc, ils sont exclus d’avance. »
Pour Gabriel Rufyiri, président de l’Olucome, les 5 000 anciens occupants du marché central de Bujumbura doivent avoir de la place dans la réhabilitation du marché. « Qu’ils y mettent des actions ! Notre souhait est de les voir en train de recevoir en premiers les stands dans le nouveau marché qui sera construit ».
Il invite le comité des anciens occupants de l’ex-marché central de Bujumbura à approcher l’Olucome en vue de se convenir sur le plaidoyer à faire pour avoir une place dans le processus de réhabilitation dudit marché.
« Le gouvernement devrait y aller avec réserve »
Pour Faustin Ndikumana, directeur national de Parcem, le partenariat public-privé est une solution pour plusieurs gouvernements qui cherchent à financer les grandes infrastructures pour le besoin de la population et soutenir le développement économique. Car, beaucoup d’infrastructures exigent des coûts extrêmement élevés. « Les avantages du partenariat public-privé sont importants. Mais il convient de bien définir et de respecter le rôle de chaque acteur. Il y a plusieurs modèles d’accords différents mais qui sont extrêmement complexes et dont la réussite suppose des compétences de deux côtés. »
Selon M. Ndikumana, il y a des cas de monopoles qui exigent la régulation. « On peut faire jouer la concurrence. Mais, dans ce contexte, ça exige une compétence, une expérience très avérée parce que ça comporte beaucoup de risques juridiques qui doivent être distribués convenablement. Sinon, la réussite devient très mitigée. »
Si on analyse le partenariat public et privé qui régit ceux qui veulent reconstruire l’ex-marché central et l’État, poursuit-il, on voit beaucoup de lacunes. « Un cadre juridique institutionnel promis par l’Etat n’est pas encore opérationnel. L’expertise avérée n’est pas encore préparée du côté gouvernemental. Le gouvernement n’a pas encore fait une évaluation préliminaire, si je ne me trompe, des coûts de l’infrastructure. Qu’est-ce qu’on veut réellement dans le marché central ? Les termes du contrat, le coût de l’infrastructure, les modalités de remboursement, les règles d’exploitation par l’autre partie prenante, la durée de construction, rien n’est encore là. »
Faustin Ndikumana s’étonne qu’on parle déjà de commencer à reconstruire l’ex-marché central de Bujumbura alors qu’on est au stade des négociations. Et de se poser des questions. « Si c’est un monopole dans lequel l’Etat s’engage, quelle est la capacité de régulation ? Pourquoi on n’a pas fait jouer la concurrence en lançant un appel d’offres en bonne et due forme ? Est-ce que les capacités financière, technique et l’expérience de l’entreprise ont été bien évaluées parce qu’on a vu que les modalités de choix ont été informelles ? »

Pour le directeur national de Parcem, le gouvernement devrait y aller avec des pincettes et avec réserve. « Il faut jouer la transparence même si c’est un Burundais. Si les Burundais veulent s’y engager, il y a des normes fondamentales qui doivent être respectées afin d’éviter des conflits éventuels. Les gouvernements changent parfois et quand il n’y a pas un cadre juridique et institutionnel solide, les risques sont élevés et le projet va aboutir à l’échec. »
Pour la reconstruction de l’ex-marché central de Bujumbura, souligne-t-il, il faut même une expertise étrangère et se référer aux cas de réussite à l’extérieur pour qu’on ne s’aventure pas. « Si on analyse la situation, on dirait qu’on veut sauter dans l’inconnu. »
« Nombre d’observateurs y voient un possible mécanisme de blanchiment d’argent »
Pour D.M, économiste, cette attribution soulève de nombreuses questions quant à la transparence du processus d’appel d’offres et aux véritables motivations derrières ce choix surprenant. « Comment une société jusque-là inconnue, dont l’actionnariat reste opaque et la capacité financière non démontrée, a-t-elle pu remporter un projet d’une telle envergure ? Cette interrogation devient d’autant plus pertinente dans le contexte actuel du Burundi marqué par la suspension récente des financements de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI). »
D’après lui, la dimension économique du projet soulève des inquiétudes majeures quant à sa faisabilité même. « Dans un pays confronté à une pénurie chronique de devises étrangères, la réalisation d’une infrastructure de cette envergure apparaît comme un véritable défi, sinon une chimère. »
En effet, poursuit-il, la construction d’un marché moderne nécessite l’importation massive de matériaux de construction spécialisés : acier, verre, équipements techniques, systèmes électriques et de ventilation, qui ne sont pas produits localement. « Le Burundi, dont la production locale en matériaux de construction se limite essentiellement au ciment et aux agrégats de base, devra importer plus de 80% des matériaux nécessaires. »
Et d’ajouter : « Cette dépendance aux importations pose un problème fondamental dans le contexte actuel de pénurie de devises. Les réserves en devises du pays, déjà sous forte pression, ne permettent même pas de couvrir les besoins essentiels en importations de carburants et de médicaments. Comment, dès lors, envisager de financer l’importation massive de matériaux de construction ? Cette situation risque d’aggraver davantage la crise des devises avec des répercussions en cascade sur l’ensemble de l’économie nationale. »
Plus troublant encore, relève l’économiste, le jeune entrepreneur Fablice Manirakiza, tente actuellement de lever des fonds à travers une structure tout aussi obscure dénommée « One Fund Africa ». « Cette démarche inhabituelle pour un projet déjà attribué soulève des inquiétudes légitimes sur la viabilité financière de l’entreprise et sa capacité réelle à mener à bien ce chantier d’envergure. »
D’après cet économiste, l’impact sur l’économie nationale pourrait être désastreux à plusieurs niveaux. « Premièrement, la pression supplémentaire sur les réserves en devises risque d’accélérer la dépréciation du franc burundais, alimentant ainsi l’inflation déjà galopante. Deuxièmement, la mobilisation des ressources financières pour ce projet contesté pourrait détourner des investissements d’autres secteurs prioritaires comme l’agriculture ou la santé. Troisièmement, l’engagement dans un projet potentiellement voué à l’échec risque d’aggraver l’endettement du pays qui est déjà dans une situation précaire suite à la suspension des financements internationaux. »
Dans un pays où la transparence dans la gestion des marchés publics reste un défi majeur, indique D.M, cette situation fait écho aux nombreuses critiques concernant la gestion des ressources publiques par le régime du CNDD-FDD. « De nombreux observateurs y voient un possible mécanisme de blanchiment d’argent, permettant de recycler des fonds dont l’origine reste douteuse. La coïncidence entre l’arrêt des financements internationaux et l’émergence de ce projet aux contours flous ne fait qu’alimenter les soupçons. »
Pour l’économiste, cette affaire met en lumière les failles persistantes dans la gouvernance des marchés publics au Burundi. « L’absence de critères rigoureux dans la sélection des prestataires, le manque de transparence dans les processus d’attribution et l’inexistence apparente de diligence dans la vérification des capacités des soumissionnaires constituent autant de signaux d’alarme pour la société civile et les partenaires internationaux du pays. »
Il s’étonne du silence assourdissant des autorités face aux nombreuses interrogations du public. Pour lui, cela ne fait que renforcer les doutes quant à la régularité de cette attribution. Il trouve que dans un contexte où le pays fait face à des défis économiques majeurs, l’utilisation optimale des ressources publiques devrait pourtant être une priorité absolue. « La reconstruction de l’ex-marché central, un projet crucial pour le développement économique de Bujumbura, ne doit pas devenir un symbole supplémentaire de la mauvaise gouvernance qui gangrène le pays. Il est impératif que toute la lumière soit faite sur les conditions d’attribution de ce marché et sur l’origine des fonds qui seront utilisés pour sa réalisation avant que le pays ne s’engage dans un projet potentiellement ruineux pour son économie déjà fragile. »
Iwacu a tenté, à maintes reprises, d’avoir la version du ministère en charge des Infrastructures, en vain.
Rencontre avec Fablice Manirakiza : « Les Burundais devaient me dire merci »
Qui est Fablice Manirakiza ?
Je suis né à Mwumba, à Ngozi. Quand je suis né, le Burundi traversait déjà une crise. Parce que la crise de 1993 a éclaté alors que j’avais un an. Avec mes parents, nous avons fui vers le Rwanda. Après, on est revenu au Burundi. Malheureusement, à 8 ans, mes parents sont morts. Orphelin, je suis devenu un enfant de la rue.
Alors, j’avais une sœur qui vivait dans un camp de déplacés en Tanzanie. A 11 ans, elle a eu écho de ma situation. Elle m’a demandé de la rejoindre en Tanzanie. Je suis parti. Nous avons alors commencé à chercher un moyen de trouver refuge en Australie. Je vis en Australie depuis 2007. Cela fait déjà plus de 15 ans.
C’est alors en 2016 que j’ai commencé à sentir une vocation.

C’est-à-dire ?
Parce que c’est Dieu qui accomplit tout ce que je fais. Ce n’est pas vraiment moi. Il faut bien le souligner. J’ai eu une révélation. Car, j’étais parmi ces jeunes qui pensent qu’il n’y a rien à faire au Burundi.
Alors depuis 2016, j’ai commencé à travailler ici au Burundi. Dieu m’a orienté dans la construction des maisons modernes.
Vous avez vu nos réalisations. Nous avons construit le Village I& II dans le quartier Miroir, le 3e village est en cours de construction à Kabezi, un autre à Ku Mashurwe. Nous sommes en train de construire pour les propriétaires des parcelles, etc.
Plus de 90% de nos clients sont des gens de la diaspora. Nous les mobilisons beaucoup pour venir investir au Burundi. Et le plus grand marché est celui de l’ex-marché central de Bujumbura.
Comment avez-vous reçu ce marché ?
Lors de la dernière réunion de la diaspora, j’ai eu la chance de présenter mon idée au président de la République. Il m’a répondu favorablement. Le ministère des Infrastructures m’a approché par après. Nous avons échangé et ils ont compris que c’est un projet possible.
Je leur ai montré comment nous comptons le faire. Ils ont alors accepté de me donner un premier contrat. Ils m’ont dit : « Il faut aller sur le terrain et nous montrer que tu en es capable. Après, nous allons te donner l’accord définitif pour construire. » C’est cet accord que j’attends aujourd’hui.
Quand vous avez reçu cette réponse favorable du président de la République, il y a eu beaucoup de commentaires. Il n’y a pas eu de passation de marchés publics comme d’habitude. N’est-ce pas du favoritisme ? Quelle est votre réaction ?
En fait, les gens disent souvent des choses qu’ils ne maitrisent pas. Normalement, quand on parle de marchés publics, c’est-à-dire que celui qui lance ce marché a de l’argent.
Or, l’Etat ne m’a pas donné de l’argent pour aller construire ce marché. S’il en avait, il allait sortir un appel d’offres en bonne et due forme pour appeler les différentes compagnies à déposer les offres.
Comment avez-vous procédé alors ?
Moi, j’ai utilisé l’approche suivante : je me suis dit : peut-être, il y a un problème de budget. Nous sommes avec des Burundais de la diaspora et nous avons besoin de développer notre pays et d’y investir. J’ai demandé au gouvernement de m’accorder le contrat qu’on appelle « Build, Operate, Transfer » (BOT).
C’est-à-dire ?
L’Etat te donne par exemple la reconstruction de ce marché. On vous dit : allez-y travailler. Et on s’entend sur le nombre d’années pendant lesquelles nous pouvons l’exploiter après les travaux.
Dans ce cas, l’initiateur récupère ses investissements en gérant ce projet durant un certain nombre d’années. Par exemple : 50 ans. Cela signifie que durant cette période, avec mes associés, nous avons le droit d’exploiter ce marché pour récupérer notre capital et faire des bénéfices. Et après les 50 ans, cette infrastructure est remise à l’Etat.
Bref, dire qu’il s’agit du favoritisme, cela montre qu’on ne maîtrise pas le dossier. Moi, je n’ai pas un proche qui peut plaider pour moi. Tout ce que je réalise, c’est par la main divine.
Cependant, on dit que vous avez reçu ce marché parce que vous êtes proches de certaines hautes autorités du pays. Qu’en dites-vous ?
(Rires). En fait, quand les gens disent que je suis proche des hautes autorités, je ne comprends pas vraiment ce qu’on veut réellement signifier. Ils se trompent fort. Moi, je suis une personne ordinaire. Allez-y faire une investigation pour identifier ces personnalités dont on parle. (Rires)
Vous avez signalé que vous avez un contrat provisoire. Quelle est sa durée et son contenu ?
Cet accord nous donne six mois pour montrer réellement qu’on est capable. En fait, il y avait des maquettes que le gouvernement avait validées lors d’un Conseil des ministres. Ils nous ont alors donné ces plans et d’autres documents à leur disposition et nous ont demandé d’aller faire des améliorations suivant notre projet.
Ce qui est déjà clair dans ce contrat provisoire : c’est le déblayage de cet endroit dans cette durée de six mois. Au cas contraire, le gouvernement disait qu’il va rompre l’accord et chercher un autre preneur. C’est pour cette raison que nous avons mis en place ce Fonds dénommé One Africa Investment Funds pour que toute personne désireuse puisse mettre son capital.
Quand nous avons vu l’affluence des gens pour mettre des capitaux, nous comme Ubaka nation group, avons décidé d’investir dans le déblayage de cet espace.
Je dois rappeler aux gens que le montant utilisé pour ce premier travail appartient à Ubaka nation group. L’argent de la population est toujours sur des comptes bloqués dans les banques. Je le répète. Ce qui signifie que moi, pour engager l’argent de la population, ça sera conditionné par la signature du deuxième contrat.
Avez-vous espoir que ce contrat définitif vous sera accordé ?
Sûrement. C’est un projet de la population. Moi, j’ai soumis le dossier sur l’état d’avancement. Je pense que, bientôt, nous aurons ce contrat.
Concrètement, quel est le rôle de chacun dans ce projet ? Entre l’Etat et Ubaka nation group ?
Oui, il faut que cela soit clair. En fait, il y a le projet du gouvernement dénommé Buja City Plazza.
Comme Ubaka nation group a manifesté la volonté de le réaliser, le gouvernement lui a donné le feu vert de mobiliser les moyens techniques et financières. Ubaka nation group est un développeur, un constructeur et il va exploiter ce marché durant autant d’années convenues avec le gouvernement.
Et pour mobiliser les fonds, au lieu de s’adresser aux banques, cette organisation a fait une innovation. Elle a ouvert les portes à tous ceux qui veulent donner des actions. On a mis alors en place un fonds collectif appelé One Africa Investment Funds. C’est lui qui finance donc ce projet Buja City Plaza. Dans ce processus, le rôle de l’Etat reste la surveillance.
Pouvez-vous rassurer les Burundais que ce marché sera reconstruit ?
Bien sûr. Nous les rassurons à 150%. Celui qui doute encore, il n’a qu’à se rendre dans le quartier Miroir pour apprécier nos réalisations. Nous en avons l’expertise. D’ailleurs, j’ai commencé à organiser des voyages d’études pour mes ingénieurs. Dernièrement, nous étions à Dubaï pour nous inspirer. C’est un projet qu’on va réaliser en cinq phases.
Lesquelles ?
Pour la première phase : il est prévu un complexe qui sera comme un shopping Mall. En tout, il y aura cinq complexes.
Il y aura aussi un bâtiment en étage de 30 niveaux. Là, c’est dans la sixième phase. Tout cela sera réalisé entre 3 et 8 ans. Sans doute que tout cela va bien se passer.
Mais, sur les réseaux sociaux, on disait que vous fuyez le pays. Votre commentaire ?
(Rires). Moi je n’oblige personne à investir dans mes projets. Seulement, ceux qui doutent encore, ils peuvent venir demander des explications. Ils rentreront convaincus.
Mais, celui qui est contre, qu’il se ressaisisse. Que tous ceux qui disent du mal de nous nous laissent poursuivre notre projet. Mais, qu’ils sachent que leurs actions ne nous empêchent pas de continuer. Nous sommes déjà oints. On s’en fout du reste. Que les Burundais arrêtent de se tendre des pièges. On n’ira nulle part avec cela. C’est d’ailleurs pour cette raison que le développement de notre pays reste problématique.
Nous avons entendu que l’action est de 102 mille BIF pour les locaux et 103 dollars pour les gens de la diaspora. Mais, il y a des anciens occupants de ce marché. Sont-ils obligés de donner des actions pour bénéficier des places ? Ou ils seront prioritaires ?
En fait, c’est un nouveau projet. J’ignore ce qui s’est passé. Celui qui avait un stand ou pas, il n’avait pas de contrat avec Fablice ou notre organisation. Moi, je dis qu’il faut traiter les gens équitablement. Au moment opportun, après la construction, on fera un appel. Toute personne capable sera la bienvenue sans distinction. Il n’y aura pas de favoritisme, de priorité pour les anciens occupants. C’est le business. On repart à zéro.
Vous dites que vous avez espoir d’avoir le contrat définitif. Mais, lors de la Table ronde de décembre 2024, la reconstruction de l’ex-marché central de Bujumbura a été citée parmi les projets prioritaires du gouvernement. N’y a-t-il pas de chevauchement ?
Premièrement, il y a eu une erreur de communication. Mais, il ne faut pas « négativiser » les choses. Il faut les « positiver ».
D’ailleurs, ce n’est même pas le ministère des infrastructures qui a fait cette présentation. Ce projet est de son ressort. Selon nos calculs, le projet va coûter autour de 100 millions de dollars ou autour de 500 milliards de BIF. Mais, dans leur présentation, c’était autour de 400 millions de dollars. Cela étant, chaque technicien a sa façon de faire.
Moi, je considère ça comme une erreur de communication. L’Etat peut avoir un investisseur prêt à mettre de l’argent dans ce projet. Il peut m’approcher et nous mettre en contact. Et ce, pour alléger le fardeau de la population. Tout est possible.
Un message à ceux qui ont eu déjà mis des actions
Ce projet de reconstruction de ce marché est très bénéfique pour les actionnaires et le pays. D’abord, c’est pour la première fois qu’un fonds collectif est mis en place pour donner la chance à tout Burundais de mettre ses actions.
Supposons qu’on nous accorde 30 ans d’exploitation. Par exemple, après la construction, nous parvenons à récupérer notre capital en 5 ou 10 ans. Prenons que chaque actionnaire va passer 20 ans en train de récupérer des bénéfices. Quel est cet autre projet bénéfique que celui-là ?
Normalement, les Burundais devaient me dire merci. Aujourd’hui, les uns me maudissent. Mais voilà, j’ai pensé à un projet, j’ai eu un contrat. Et comme c’est un projet de Dieu, au lieu de le faire en solo, j’ai associé tous les Burundais.
Quel est le montant déjà mobilisé ?
Vraiment, je n’ai pas de chiffres actualisés. Ça fait déjà plus d’une semaine. Mais, nous étions aux environs de 5 milliards BIF et 500 mille dollars. Les actionnaires sont environ 5 000 personnes.
Dates clés de l’ex-marché central de Bujumbura
1994 : après sa construction, la gestion du marché central de Bujumbura est confiée à la Société de gestion du marché central de Bujumbura (Sogemac) pour une durée de 30 ans.
27 janvier 2013 : incendie du marché central de Bujumbura
Octobre 2016 : le gouvernement annonce un projet de construction d’un Mall à la place de l’ex- marché central de Bujumbura
19 septembre 2018 : le gouvernement abandonne le projet sous prétexte qu’aucune offre n’a été reçue à la date limite de dépôts de dossiers
Une société chinoise Jiangxi Jiangxi International Engineering CO, Ltd reçoit le marché de reconstruction de ce marché, sans résultat. Aucune explication n’a été fournie.
Mi 2021 : adoption par le Conseil des ministres d’une feuille de route et le mémorandum d’entente pour la construction d’un centre commercial aux normes internationales de cinq niveaux. Et ce, sur base d’une requête présentée en décembre 2020 au gouvernement par l’Association des banques et établissements financiers (ABEF).
Novembre 2021 : il était prévu le choix du projet et de la maquette.
Juin-Juillet 2022 : il était prévu le lancement d’appel d’offres pour la construction de ce centre commercial.
Avril 2023 : il était prévu la pose de la première pierre.
30 juillet 2024 : lors de l’ouverture de la semaine de la diaspora, édition 2024, Fablice Manirakiza sollicite publiquement auprès du président de la République un marché de reconstruction de l’ex-marché central de Bujumbura avec les moyens de la diaspora burundaise.
2 septembre 2024 : l’association de construction Ubaka nation group signe un accord avec le ministère des Infrastructures et des bâtiments publics pour entamer les travaux de rénovation
16 septembre 2024 : lancement des travaux de déblayage du terrain par Ubaka nation group











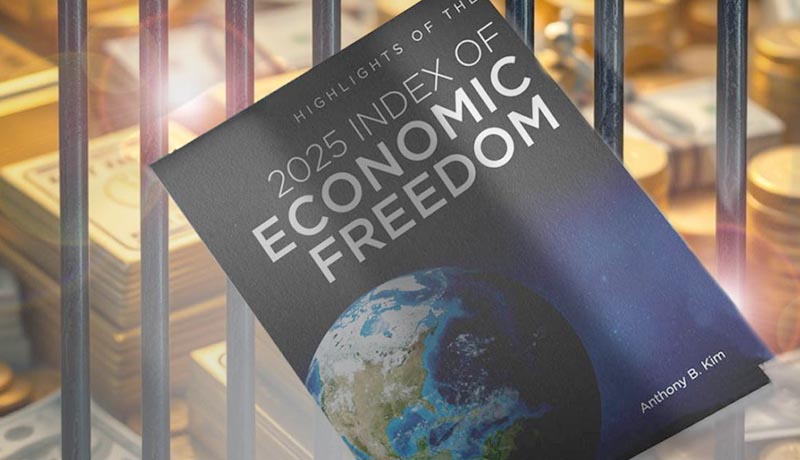








Cela ne peut se passer qu’au pays d Eden. Le nouveau surnom du Burundi.
Quand vous amènez des théories divines ppur construire des immeubles, c’est grave.
Kera muri Polytechnique, on étudiait des sciences fondamentales: Analyse, Physique, Résistance des matériaux, etc…
Merci Mfysi. Ces théories divines m’inquiètent aussi. Malheureusement c’est à la mode. Même le chef de la 1ère puissance mondiale nous dit qu’il réalise la volonté divine !!!
24.09.2024
Le journal Iwacu écrivait: « Le patron d’Ubaka nation group promet que dans 5 ans, le marché tant attendu sera fonctionnel. Il précise qu’il comprendra plusieurs espaces dont un bâtiment en étages de 30 niveaux. […] Il laisse espérer que 8 ans après la réhabilitation, les investisseurs auront déjà récupéré tout ce qu’ils auront mis comme actions. »
12.02.2025
« Tout cela sera réalisé entre 3 et 8 ans. Sans doute que tout cela va bien se passer. […]
Supposons qu’on nous accorde 30 ans d’exploitation. Par exemple, après la construction, nous parvenons à récupérer notre capital en 5 ou 10 ans. »
J’ai lu différents articles et écouté plusieurs interventions du patron de l’entreprise Ubaka Nation Group. J’ai constaté beaucoup d’approximations et de contradictions dont certains figurent dans un commentaire que j’ai posté après la publication de l’article d’Iwacu le 24 septembre 2024.
J’aurais souhaité avoir tort. J’exprimais mes doutes quant à la capacité et les compétences techniques de cette entreprise. Aujourd’hui, M. Manirakiza dit qu’il a déjà commencé à payer des voyages d’étude à ses ingénieurs pour aller s’inspirer de ce qui se fait à Dubaï. Ici peut-être que je dois me rappeler qu’il disait que le Burundi serait comme Dubaï dans quelques années.
J’exprimais mes doutes quant au coût du projet: les chiffres étaient avancés alors que M. Manirakiza disait n’avoir pas encore fait faire les études. Il promettait que le budget serait réuni en un mois. Aujourd’hui, soit six mois plus tard, il dit avoir déjà réuni 1/100ème. Pourtant, il dit être à 150% sûr qu’il va réunir cent millions de dollars. Pour mieux convaincre, il a un argument béton: » c’est un projet de Dieu ». C’est exactement ce que disait M. Édouard Nduwimana, alors ministre de l’intérieur au moment de l’incendie: c’était la volonté divine qui a conduit à l’incendie afin que fut construit un marché moderne. Merci M. Manirakiza, vous par qui la prophétie se réalise. Seulement, à ce rythme, la mobilisation des fonds risque de prendre des décennies mais c’est le propre de la prophétie quand elle n’est pas auto-réalisatrice. Dans Mat. 24:34, Jésus dit « Cette génération ne passera pas avant que tout cela n’arrive ». Voici que quasiment 2000 ans viennent de se passer. Je crais que le projet du marché central n’emprunte la perspective des prophéties, car, me semble-t-il, la représentation que se fait le patron d’Ubaka Nation Group ne pourra en aucun cas participer à la production de la réalité. J’aimerais bien avoir tort.
Je suis surpris par cette phrase: « Supposons qu’on nous accorde 30 ans d’exploitation… ». Au fait, l’entrepreneur ne sait pas à combien d’années d’exploitation auront droit les investisseurs! Une information aussi importante peut-elle ne pas figurer dans le contrat?
Au moins Vous ,Vous êtes réaliste
Je ne crois pas que le Cndd fdd les gens faire du business sans s’y participe