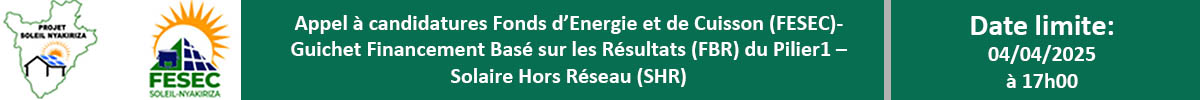La soirée des récompenses des lauréats du Prix Michel Kayoya 2012, c’était ce samedi 24 novembre à l’Institut Français du Burundi. Iwacu vous propose la Préface du recueil des meilleures nouvelles de 2011 présentée à cette occasion et signée Ketty Nivyabandi. Il y est question de la femme au Burundi …
Les impressions pressées concluraient qu’à l’égard du reste de l’Afrique, le Burundi demeure sensiblement privilégié quant aux indécences faites aux femmes. En effet, la femme des collines d’Imana n’est pas excisée dès sa tendre enfance (Afrique de l’Ouest), elle ne doit pas s’agenouiller, même dans la lourdeur d’une grossesse, devant tout homme qui croise son chemin (Ouganda), ni exhiber publiquement la fraicheur de son corps, pour daigner être choisie, parmi d’autres centaines de filles de son âge, comme épouse par son roi (Swaziland).
Et pourtant. Si l’horreur de couper et sceller les lèvres intimes d’une petite fille, et par conséquent toute sa liberté charnelle, scandalise ailleurs et avec raison, celle-ci n’en absout pas une autre, plus subtile, plus sournoise, mais tout aussi ravageuse : celle d’étouffer sa parole, l’ijambo, en son sein.
Dans le Burundi traditionnel, qui survit encore aujourd’hui, la femme n’a pas droit à la parole publique. Elle n’a donc pas le droit, devant la société et surtout, devant elle-même, d’exprimer sa réalité. Si cela est jugé nécessaire, un homme proche d’elle l’exprimera pour elle. Les conséquences que véhiculent un tel reniement culturel sont sérieuses et profondes. Elles impliquent que cette réalité féminine n’est ni digne ni nécessaire d’être exprimée. Et surtout, elles créent dans l’inconscient collectif de la femme burundaise l’étrange et fatale certitude que celle-ci n’est pas capable de s’exprimer avec dignité, de créer le ton, les images, la texture qui reflètent le mieux son univers. Et peut être, en définitive, que son univers est tout simplement accessoire.
C’est dans ce contexte traditionnel qu’il faut tenter de comprendre la rareté des écrits féminins dans la littérature burundaise, ceci dans un pays qui demeure foncièrement pudique : ‘ijambo rigukunze rikuguma mu nda’ (la parole qui t’aime meurt en toi). Car au delà du verbe, c’est aussi toute la créativité qui se meurt née.
C’est aussi dans ce contexte qu’il se doit d’accueillir ces trois nouvelles du Prix Michel Kayoya 2011 et la révolution de taille de voir une jeune femme en remporter le premier prix.
‘Sabine Michaella Z3’ (de Claudia Niyonzima) est une nouvelle déconcertante d’actualité et de fraicheur. Brisant tous les tabous traditionnels, sa prouesse est d’avoir su retranscrire parfaitement, par sa langue, son humour, son rythme et ses références, la réalité de cette jeune femme dans son temps.
‘Le fils de la violence’ (de Jean Sacha Barikumutima) et ‘Mon nom est Rehema’ (de Joseph Ndayisenga) se rejoignent étrangement par ce geste altruiste de sauver un nourrisson (symbole de promesse et d’espoir) et sauver leur humanité en même temps. L’on y retrouve la femme dans toutes ses facettes : l’inconnue victime de la guerre, la jeune femme désemparée par un nouveau-né et qui se découvre des instincts meurtriers, la femme qui assiste à la douce démence de sa fille, la femme maternelle et généreuse qui n’hésite pas à voler ce qu’il y a de plus précieux, la jeune femme blasée par le quotidien de la vie urbaine, la femme prête à tout pour redéfinir son quotidien …
En somme, les femmes de ces trois nouvelles sont tout sauf identiques, elles ne sont ni saintes ni sorcières, elles sont entières, dans la complexité de leurs réalités. Et c’est un plaisir de les découvrir une à une.
L’on ne peut qu’espérer que ces textes pionniers en inspireront beaucoup d’autres, et contribuer ainsi à libérer le verbe féminin dans toutes ses formes et possibilités.
En attendant le prochain PMK …