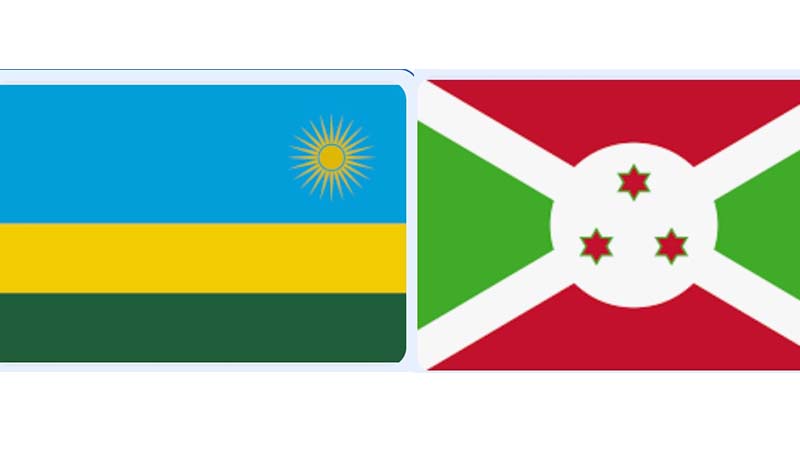Par Louis-Marie Nindorera
L’arrestation et l’emprisonnement récents à Bujumbura de Christa Kaneza, jeune mariée (18 ans), mère d’un bébé d’un mois, accusée de complicité du meurtre de son propre mari, Thierry Kubwimana, ont provoqué un émoi dans une partie de l’opinion publique burundaise. Etalée dans les réseaux sociaux, l’affaire prend la tournure d’un test public de la capacité du nouveau président burundais, Evariste Ndayishimiye, à tourner la page des excès spécifiques du « régime Nkurunziza » en matière de droit et de justice. Le lien est possible, mais l’amalgame l’est tout autant. Car depuis des décennies, les prisons burundaises sont remplies à ras bord de détenus et condamnés victimes de procédures pénales légères et peu crédibles. Elles sont terriblement lourdes de conséquences pour des milliers d’anonymes, chaque année abusivement privés de liberté. En prison, dit-on, ils rendent des comptes à la société qu’on prétend ainsi protéger du danger qu’ils représentent pour elle. Mais qui protège la société burundaise du danger d’un système judiciaire qui, lui-même, ne rend pas ou peu de compte et perd le sens de sa mission ? Que les projecteurs soient braqués sur l’arrestation et l’emprisonnement de Christa est assurément une bonne chose. Mais le débat public qu’il suscite gagnerait à aborder, à travers cette triste affaire, les maux de la « justice » burundaise, qui sont vieux et profonds, systémiques et culturels.
Durant les années de guerre civile, un mini-bus engagé sur l’axe routier Bujumbura – Bugarama tomba dans une embuscade tendue par un groupe d’ « assaillants » (opposants armés) qui forcèrent le véhicule à l’arrêt. Un des passagers du bus était un militaire armé, en uniforme. Avant que les auteurs de l’embuscade l’eussent vu, ce militaire voulut ouvrir le feu sur « l’ennemi », avec le mince espoir de sauver sa peau. Face au risque que cela dégénérât en fusillades chaotiques et massacre, d’autres passagers le supplièrent de ne rien en faire. Il accepta. Malheureusement, dès que les hommes du groupe armé le virent, ils le traînèrent vers le bas-côté et sur le champ, l’exécutèrent d’un coup de feu. La détonation creva le silence et l’atmosphère déjà tendue, provoquant instantanément l’hystérie et la débandade générales. Tous les passagers du bus furent recherchés par la « justice » burundaise. Quatre d’entre eux furent retrouvés, emprisonnés, jugés et en dernière instance, condamnés à 20 ans de prison ferme pour … complicité de meurtre ! Et la vie continua. Sauf pour deux des quatre condamnés qui perdirent la vie en détention, des suites de leurs mauvaises conditions d’internement à la prison de Muramvya.
Un exemple d’injustice. Injustice ? Sondez le public burundais sur les responsabilités dans cette affaire d’embuscade. Les avis seront partagés ! Qu’à cela ne tienne, au bistrot, les gens sont libres de papoter sur une affaire de justice, d’envoyer au diable un suspect, par les suspicions et l’antipathie qu’il leur inspire, sans s’embarrasser de présomption d’innocence, de doute objectif ou de preuve. Leur seul devoir du moment envers la société est de régler leur facture de bières. La République attend autre chose de ses magistrats. Et pourtant ! Qu’y a-t-il de plus ironique pour quatre pauvres passagers de bus que de survivre à l’embuscade d’un groupe de « tribalo-terroristes » (ainsi qu’ils étaient appelés) pour finir en victimes d’une terreur égale : la justice burundaise !
Un quart de siècle et quatre élections « démocratiques » plus tard, la « justice » burundaise sème toujours la terreur. Avec de la chance, s’ils survécurent aux terribles conditions de leur détention à la prison de Muramvya, nos deux derniers passagers du bus seront sortis de prison après cinq ans, au lieu de vingt. Les onze prisons et maisons d’arrêt du Burundi ont une capacité d’accueil totale d’environ 4.000 places mais en abritent souvent près du triple. Du Parlement à la Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme, cette surpopulation carcérale chronique est décriée presque chaque année, et depuis fort longtemps. Pour tenter d’y remédier, le Parlement vote des lois mais sitôt promulguées, il leur tourne le dos, même quand elles sont quasi totalement inappliquées. Peines alternatives, sanctions disciplinaires pour magistrats, etc. tout y est prévu mais on les ignore pour assouvir le même besoin urgent et prioritaire de sanctionner et emprisonner. La présomption d’innocence et la charge de la preuve sont inversées : qu’un soupçon pèse sur vous et vous serez conduit en prison. Quand les prisons sont pleines à craquer, une commission de magistrats est mise sur pied par le Ministère de la Justice pour en faire le tour et pour les désengorger. En s’arrêtant à Muramvya, ces magistrats seront tombés sur deux gars, devenus « complices de meurtre », sur leur chemin en bus vers un mariage, un retour de congé, etc. Qui sait ? Dans le moment des faits, leur malheur fut que l’affaire fit sans doute grand bruit et que la justice fut sommée d’envoyer quelques têtes à la potence, pour apaiser la colère populaire. Cinq années plus tard, plus personne n’avait sans doute encore souvenir ni intérêt dans cette affaire d’embuscade. Du coup, nos deux « complices de meurtre » se mirent de nouveau à ressembler à de simples et paisibles passagers de bus. Et parce qu’ils avaient purgé le quart de leur peine (une des conditions à la libération conditionnelle), ils furent sans doute ainsi rendus à leur liberté ainsi qu’à leur famille, leur vie sans doute partiellement détruite.
C’est à la sanction judiciaire d’être en cohérence avec le discours politique
Hier comme aujourd’hui, chaque régime qui en renverse un autre ou échappe à un putsch fait des procès qui s’ensuivent une « affaire personnelle », entendez par là que pour lui, ça ne regarde ni le droit ni les juges ! A leur accession au pouvoir, les gouvernements de Micombero, Bagaza et Buyoya firent tous ouvrir des procès emblématiques contre des personnalités associées aux régimes renversés. Souvent, pour de tels procès politiquement très chargés, aucune autre issue que la condamnation n’est envisageable ni admissible. C’est à la sanction judiciaire d’être en cohérence avec le discours politique. Dans les années de guerre civile (1996-2008), les accusations de « participation à des bandes armées » (article 419 du code pénal de 1981) et toute complicité liée menaient droit en prison et excluaient toute mesure de réduction de peine. Depuis la tentative de putsch de mai 2015, le pouvoir burundais est dans le même type de croisade politique, orchestrée en symphonie avec l’appareil judiciaire, au garde-à-vous. La mise au ban des « traîtres à la nation » est une longue « affaire personnelle ». Mais face à l’explosion des excès et des abus dans les arrestations et condamnations, certains juges et procureurs ont eu le courage de se mêler des « affaires personnelles », bref d’en faire leur affaire et de prononcer des acquittements. Dans plusieurs cas, malgré les significations de jugement, les « mandats d’élargissement » (remise en liberté) n’ont pas été émis et quand ils l’ont été, ils sont restés dans les tiroirs !
À côté de ces procès politiques sensibles, même les contentieux les plus ordinaires portés devant les tribunaux sont soumis depuis longtemps aux mêmes injustices, sans nul besoin d’interférence des « chefs », et ce par le fait d’officiers de police et magistrats, au mieux débordés, au pire incompétents et/ou corrompus. Quand un vol est déclaré dans un domicile familial, combien de fois voit-on le chef de ménage, la police et la justice s’accorder pour se retourner contre le personnel domestique, spontanément, systématiquement et par défaut. Au bout du compte, tout se passe un peu comme si, dans la certitude que le coupable d’un crime était l’une des cinq personnes présentées, notre choix de société consiste à jeter les cinq en prison. Certes, ce sera la certitude d’avoir quatre innocents en prison. Mais notre société tient cela comme un moindre mal, comparé à la satisfaction de tenir le coupable.
À force de voir les procédures d’enquête policière et judiciaire ratisser large et rafler pêle-mêle des témoins, des voisins, l’auteur du dernier coup de fil, etc., sur base de présomptions légères, en ne s’embarrassant ni du doute ni de preuves fiables, les citoyens s’adaptent et apprennent à se tenir coi, loin du rayon de balayage de cette justice. Pire, ils finissent par admettre qu’être innocent c’est savoir se tenir hors de portée du champ de ratissage de la justice. Ainsi par exemple, demain, un assassinat dans un quartier de Bujumbura pourrait conduire quelqu’un en prison pour meurtre, tout ça parce que son « cahier de ménage » était « étrangement incomplet ». Si l’affaire fait bruit, tout le monde se mettra à scrupuleusement remplir son cahier de ménages pour que celui-ci ne soit jamais la source d’un problème avec la justice. Avec l’habitude de remplir leur cahier, les gens finiront eux-mêmes par être suspicieux envers un voisin qui n’a pas rempli son cahier le soir d’un meurtre, même si la piste de l’assassin ne tient à rien d’autre que ça. Et d’un « délit » de non-remplissage de cahier, vous le verrez condamné pour meurtre, faute de tout autre piste d’enquête !
A 18 ans, à peine émancipée par son mariage et comblée par la naissance d’un enfant, Christa Kaneza est dans la tourmente d’une double terreur : celle du meurtre de son mari en novembre dernier, puis celle de son accusation et de son emprisonnement, il y a quelques jours. Le meurtre de son mari Thierry est grave, comme l’ont été des centaines de milliers avant le sien. Mais la décision de mettre l’épouse de la victime en accusation, puis de la placer en détention préventive, est une de celles qui ramènent au sens et à la mission sacrés de la justice, aux lourdes responsabilités des officiers de police et magistrats et à leur devoir de justice envers les victimes et la société. Le statut de jeune épouse, mère et veuve n’innocente pas, certes. Mais au vu du « casier » de notre justice, la mise en détention préventive de Christa interroge sur ses bases légales et sur ce qu’elle contient comme part de certitude dans les faits et preuves rassemblés par le magistrat instructeur, puis comme part des pratiques abusives qu’on connait à la procédure pénale au Burundi. La certitude qui doit être celle de ceux en charge de ce dossier est que toute erreur de leur part signifierait qu’ils ont alourdi l’injustice. Faute de connaitre les éléments du dossier, il est difficile de juger du poids de l’un ou de l’autre. Par ailleurs, avec la tournure que prend l’affaire dans les médias et réseaux sociaux, il est aussi difficile de savoir dans quelle catégorie elle va finir par tomber, entre affaires de justice et … affaires personnelles du pouvoir ! Qu’à cela ne tienne, le plus grand bien que cette affaire puisse faire à la société burundaise, c’est d’éclairer les geôles où croupissent des milliers de Christa et d’ouvrir le procès de cette justice qui traîne les mêmes vices depuis des décennies et dont nul ne sait à qui elle rend compte.
 *Louis-Marie Nindorera, Burundais , historien de formation est consultant, principalement pour le compte du Fund for Global Human Rights. Il est aussi membre du Law and Peace Practice Group, de l’ Institute for Integrated Transition (Barcelone, Espagne)
*Louis-Marie Nindorera, Burundais , historien de formation est consultant, principalement pour le compte du Fund for Global Human Rights. Il est aussi membre du Law and Peace Practice Group, de l’ Institute for Integrated Transition (Barcelone, Espagne)
*Les articles de la rubrique opinion n’engagent que leurs auteurs