Par Gérard Birantamije*
« Au nom du peuple burundais et en mon nom propre… ». Voici une formule quasi magique que j’adore beaucoup surtout quand elle est proférée par le premier des Burundais (entendu ici le chef de l’Etat) pour souligner et apaiser les souffrances endurées par son peuple. Je l’adore par sa symbolique politique qui rappelle que le premier des Burundais n’est rien sans ces Burundais, sans leur existence, sans leur participation à la vie commune, à la vie des institutions de l’Etat.
Je vous rassure. Je n’emprunte pas cette formule pour prétendre incarner cette symbolique en ce moment, mais pour rappeler aussi l’existence de légitimités multiples dans les systèmes de représentation politique. Ces systèmes de représentation existent aussi au Burundi depuis l’avènement du pluralisme politique. Comme quoi, si le premier des Burundais se refuse de parler, d’agir et de faire « au nom des Burundais » et pour eux, d’autres peuvent le faire et agir, pour les représenter.
Ainsi, « Au nom du peuple burundais … », je me permets de revenir sur les politiques publiques initiées par le pouvoir en place dans son art de gouverner qui entrainent tout Burundais « présent et à venir », permettez-moi encore cet emprunt, dans une précarité sans précédent. Je ne voudrais pas dresser une liste exhaustive des malheurs qui accablement le peuple, tellement beaucoup de politiques initiées brillent par leur incohérence et leur inadaptabilité au contexte social, politique et économique du pays. Je me permets de demander :
« Au nom du peuple burundais … », pourquoi cette politique de ‘destruction massive’ des infrastructures économiques de proximité ?
La quasi-totalité des membres du gouvernement, du parlement et des autres institutions de l’Etat sont nés au Burundi. Ils savent ce que signifie une boutique du quartier, un kiosque au coin d’une rue, un ‘takataka’ d’une colline éloignée d’un centre de négoce. Ce sont des lieux d’approvisionnement quotidien, ce sont des lieux de communalisation qui permettent de souder des sociabilités idoines, au-delà du politique ou d’autres différences. Je dirais même que ce sont des lieux de co-création d’un environnement solidaire. Mais au-delà, ces kiosques et modestes boutiques constituent des pôles d’attraction de ce qui survit de l’activité économique, n’en déplaise à certains. Toutes les communes rurales et urbaines font chaque année l’inventaire de ces espaces économiques qui n’ont jamais fait l’ombre aux marchés et autres supermarchés. Pour autant qu’ils existent. Les impôts et les taxes, certes modestes, permettent à ces entités décentralisées de fonctionner et d’investir dans les politiques publiques locales.

Par ailleurs, ces hautes personnalités ont déjà voyagé à l’étranger, du moins certaines. Ne seraient-elles pas ébahies de ne pas trouver de kiosques grouillants à Yaoundé ? Quelle image serait Kampala sans ces espaces de convivialités improvisées à même la voie publique ? Que serait Abidjan ou Cotonou sans ces « maquis » ? Marrakech sans ses souks ou « Matongé » à Bruxelles sans ces petits « shops » disséminés ici et là ?
Ces boutiques ou ces kiosques sont implantés à chaque coin de rue et coexistent avec les habitations des banlieusards moins nantis, même dans les grandes métropoles comme Paris ou New York, Londres ou les quartiers huppés d’Abidjan et autres Lagos ou Cape Town. Autant dire que même dans les pays aux économies avancées où existent des chaînes de supermarché et de magasins de distribution, ces boutiques de proximité tournent, restent ouvertes tard dans la nuit et jouent un rôle important dans la société. Dans bien de ces métropoles, tout le monde connaît les fameuses boutiques dites « Night shop » que l’on retrouve surtout dans les quartiers populaires, mais pas seulement. Elles aident une population défavorisée dans ces quartiers, mais font tourner l’économie du pays. Elles n’en sont pas moins des Petites et Moyennes Entreprises (PME). Ma grand-mère dirait « isorosoro… » que l’on traduirait plus ou moins par « tout fait nombre ». L’on peut se poser la question de savoir pourquoi le gouvernement s’évertue à initier une politique qui pousse à des décisions qui n’apportent pas de valeur ajoutée à l’économie, disons même à la survie de sa population. Je serais aussi tenté de me demander pourquoi le gouvernement cherche plus des problèmes aux solutions que des solutions aux problèmes. Ce n’est pas un jeu de mots. Je me répète, et il ne faut pas avoir une expertise en économie pour dire que ces infrastructures économiques de proximité jouent un rôle important. Elles participent à résoudre des problèmes qui hantent la vie des citoyens au quotidien. Et ces problèmes sont légion. Pourquoi ne pas les moderniser et inviter les banques à plus d’appui ? Pourquoi ne pas doter leurs tenanciers des outils pratiques de management et de comptabilité pour les rendre plus rentables ?
« Au nom du peuple burundais… », pourquoi empêcher les vaches de brouter encore l’herbe tendre des prairies ?
Au Burundi, il y a des animaux qui font partie de notre vie, de notre vivre-ensemble dans nos différences de pauvres et de riches, d’élites et de roturiers. Ces bêtes structurent nos relations et cimentent nos liens de proximité, de parenté, d’amitié et parfois de clientélisme. On peut ne pas en avoir. Ce n’est pas un fait nouveau. C’est normal. Mais personne ne peut dire qu’il n’en profite point. Ce sont les vaches. Elles incarnent parfois la symbolique des humains, la jeune femme comparée à une génisse, le jeune fort à un taureau. Du temps de la monarchie, je dirais même de nos jours, dans certaines régions la vache rythmait et rythme encore la vie sociale quotidienne. La mesure de ne pas laisser les vaches brouter, la fameuse stabulation permanente, n’a pas été contestée. Parce qu’il est risqué de contester, par les temps qui courent. Mai 2015 a laissé des traces, des blessures béantes. Mais la mesure a été mal accueillie par les populations. Sans bruit. Vaut mieux le savoir.

Cette politique, pourtant intéressante sous d’autres cieux, n’a jamais été explicitée ni au sommet de l’Etat ni au niveau des structures décentralisées. Et pourtant pour un gouvernement rationnel, toute politique publique suit son cycle normal : un problème sociétal ou politique qui se pose, des réflexions sur les meilleurs possibles, des solutions sur le court terme et le long terme, des implémentations d’expérimentation, des retours sur les problèmes générés par la mise en œuvre, et finalement des reformulations de politique. Si déjà il est difficile de savoir pourquoi « s’en prendre » à la vache (en fait à leurs propriétaires, les éleveurs), le décideur a oublié qu’autour de l’activité de pâturer les vaches, du moins là où c’est encore possible au regard de l’exigüité des terres, se structure tout un empire de pratiques du vivre-ensemble des populations surtout rurales. Si un citoyen lambda peut prêter sa prairie à son voisin, il n’est pas évident qu’il lui prêterait son champ de Setaria sphacelata ou de tripsacum floridanum. Mais pire, le décideur oublie que dans l’acte de donner se trouve le rendez-vous du recevoir. Dans les régions où l’élevage vit encore, la vache n’est pas pour son propriétaire, elle est un bien public, communautaire qui, d’une certaine manière, bénéficie à la communauté entière : le lait, le beurre, la bouse, le fumier, la viande, la peau et les cornes, l’argent de la vente (via l’impôt sur bétail), et même la symbolique de la vache profitent à la communauté entière. D’une manière ou d’une autre. Une politique de stabulation permanente se pense dans tous les contours, et la mise en œuvre est scrutée au quotidien avec art et empathie pour les bénéficiaires, ou plutôt pour les victimes. Et comme il se doit pour toute politique publique, elle aurait dû être incrémentale et téléologique ; pas trop hâtive et ni brutale vis-à-vis des éleveurs, et des entrepreneurs pastoraux, surtout de la plaine de l’Imbo. Ces contribuables, pas seulement ceux des régions traditionnelles d’élevage, vous regardent hagard, pensent à ces bêtes malmenées, vendues pour des miettes, non pas pour gagner un peu, mais pour s’en débarrasser.
« Au nom du peuple burundais… », pourquoi détruire des maisons dont on a toujours besoin ?
Des gens ont construit avec des autorisations de l’Etat ou du moins des services habilités de l’Etat (Direction de l’urbanisme, services des titres fonciers, communes, quartiers, etc.). Ce fut parfois en mobilisant les positions de pouvoir et les rapports de clientèle dans l’architecture institutionnelle de l’Etat. S’il est normal que les gens construisent avec l’autorisation de l’Etat, il est anormal que l’Etat procède à la destruction de ces œuvres sans explication rationnelle qui concourt de l’intérêt général de la population. Bien plus, le gouvernement ne peut pas uniquement convoquer la violation des normes urbanistiques pas plus qu’il ne peut d’ailleurs parler des erreurs commises par les autres, ceux qui ont gouverné avant eux.

L’on était habitué à des catastrophes naturelles, emportant des maisons, détruisant des routes, des installations électriques, etc. Mais qu’un gouvernement s’investisse à détruire, ce qui a été construit après des efforts titanesques mêlant crédits bancaires et endettements familiaux informels, temps de travail et stress infinis, est une première. C’est une première parce que l’Etat reste l’Etat. L’Etat pense sur les tenants et les aboutissants. Les institutions de l’Etat pensent, interrogent, dialoguent, et choisissent avant de prendre une décision. Dans l’absolu, les gens qui construisent dans les périmètres interdits ne sont pas à pleurer. Cependant, s’il est vrai que toutes les décisions ne peuvent pas plaire à tout le monde, qu’elles soient fâcheuses pour tout le monde est aussi un cas d’école.
Ce qui s’est passé avec cette campagne de destruction des maisons questionne l’essence même de l’Etat. L’Etat est intemporel, durable, continu. Il ne s’articule pas autour des changements de régime ou de systèmes politiques ni autour des humeurs changeantes des dirigeants. Il doit assumer les conduites et les erreurs de ces agents et mandataires, ceux d’aujourd’hui comme ceux d’hier. Même si des responsabilités doivent être établies dans cette responsabilisation.
Cette destruction des maisons qui n’ont pas respecté les normes urbanistiques ne relève pas des prérogatives de l’Etat dictées par l’urgence de l’intérêt général. Il n’a été point évoqué des perspectives d’autoroute ou de boulevard, de métro ou de railways en perspective pour dicter autant de frénésie destructrice. Par ailleurs, le ‘deux poids deux mesures’ observé dans cette campagne de démolition montre une politique mal pensée, erratique et discriminatoire. Une politique qui suscite des questionnements sur les intentionnalités profondes du Gouvernement. Bref, là où l’urgence dicte de telles mesures, il y a des campagnes d’information, de sensibilisation, de dialogue et de concertation avec tous les bénéficiaires des œuvres présentes et en projet. Il y a des programmes d’indemnisation en amont de la procédure qui ne se résument pas dans la ténacité des engins lourds et de la police administrative. Ces maisons détruites, les Burundais avaient trimé pour les construire. Ils en avaient encore besoin. Ils les pleurent et les traumatismes traverseront les âges. Pourquoi, tant d’acharnement sur un peuple qui ne cherche qu’à sortir des trappes de la pauvreté ?
« Au nom du peuple burundais … », pourquoi empêcher les ‘bi-tri-cycles’ de circuler en ville ?
La dernière mesure du ministre de l’Intérieur sur l’interdiction des bicycles et tricycles de circuler dans les périmètres de la partie centrale de la ville de Bujumbura a fait couler beaucoup d’encre et de salive. Les autorités administratives déconcentrées et décentralisées ont eu du mal à expliquer aux populations cette mesure de quasi-confinement des vélos, motos et fameux Tuk-Tuk. Et de leurs propriétaires et bénéficiaires, en filigrane. Pour ces autorités de proximité, il ne s’agit pas moins d’une patate chaude transmise par le ministre. C’est une mesure doublement difficile à expliquer. D’une part, ils ne sont pas en mesure de montrer rationnellement le lien de cause à effet entre la circulation des bi-tri-cycles dans les périmètres centraux de la ville et le nombre d’accidents recensés par les services de la sécurité routière. D’autre part, il n’y a point d’ersatz proposé pour faire face à la raison d’être de leur prolifération comme moyen de transport. Le ministère de l’Intérieur ne donne pas de proposition sur le modèle alternatif de transport public qu’il propose aux habitants de Bujumbura, surtout ceux de ces quartiers populaires défavorisés. Ailleurs, une mesure de ce calibre est pensée et repensée en profondeur. Parce que tout simplement ce système de transport aide l’Etat à pallier le défi de l’absence de politiques publiques de transport en commun. L’Etat ne peut se permettre de les supprimer sous un coup d’humeur ou d’humour, fut-ce celui du ministre.

Enfin, rien qu’en donnant le bénéfice du doute au ministre en question, cette mesure demeure irréfléchie dans ce sens qu’elle cloue au pilori les investisseurs et les politiques des coopératives initiées comme modèle d’économie solidaire et partagée. Derrière un vélo, une moto, ou un Tuk-Tuk, se trouve des bénéficiaires de ce système de transport, mais aussi des investisseurs, des importateurs, des commerçants, des courtiers, des entreprises, des mécaniciens, des banques et institutions financières, et pour couronner tout l’Etat et ses entités décentralisées. Bujumbura n’est pas une mégapole. C’est moins d’un million d’habitants au dernier recensement. La situation peut être maitrisée. Il suffit d’un minimum d’engagement de la puissance publique. Pourquoi ne pas penser à d’autres voies et moyens pour limiter les accidents comme la formation des conducteurs (pas les seuls) au Code de la route ? Pourquoi ne pas penser à allouer certaines routes ou certains axes aux bi-tri-cycles jusqu’au centre-ville ? Pourquoi ne pas imaginer la solution de la circulation alternée de ces bi-tri-cycles pendant les heures de pointe suivant les axes nord/sud de la ville de Bujumbura ? La limitation des vitesses avec des mesures radicales aux contrevenants ? etc. Cette mesure risque de créer d’autres catégories de citoyens au Burundi : ceux qui ont des droits, et ceux qui n’en ont point ; des citoyens à part entière et des citoyens entièrement à part. Le ‘Nous’ et les ‘Autres’. Des ‘privilégiés’ et des ‘sans-culottes ». Ce n’en est pas moins une bombe à retardement et à sous-munitions.
Et quid de cette Force de Réserve et d’Appui au Développement (FRAD) ?
L’on a depuis un certain temps cru que la ‘question de l’armée’ avait été réglée par la mise en œuvre du Protocole III de l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. La Force de défense nationale du Burundi semblait sur les rails de la professionnalisation même si des lacunes de sa républicanisation, sa modernisation et surtout sa dépolitisation demeurent prégnantes. Cependant, l’année 2015 a marqué un coup d’arrêt aux différentes initiatives en étayant au grand jour deux commandements parallèles. Ce fut un coup fatal. L’armée est devenue un autre champ de batailles politiques. Entre-temps, une intense miliciarisation de la jeunesse s’est mise en branle. L’insécurité a monté d’un cran et les corps de sécurité sont régulièrement pointés du doigt. Même au-delà des frontières. En 2017 au plus fort des tensions politiques postélectorales de 2015, la Loi organique mettant en place de la Force de Défense Nationale du Burundi parle des réservistes. Elle a déjà été fustigée surtout dans ses articles 115, 116 et 117 évoquant des réservistes. L’environnement politique actuelle justifie de moins en moins la nécessaire conscription de cette force de réserve, qui par ailleurs, semble avoir des missions qui vont de la sécurité, la défense, inculquer l’esprit patriotique aux jeunes, ou encore le développement. Serait-ce la lutte contre l’insécurité qui impulse la mise en place de cette force ? Rien n’est clairement dit. Et rien ne semble justifier sa nécessité. Pourquoi investir dans la mise en place d’une force de réserve au lieu de moderniser l’armée (et les autres forces de police et de renseignement) pour faire face aux menaces identifiées dans le « Livre blanc de la défense » (non publié) ? Pourquoi investir ‘dans les retraités’ quand des formations de réinsertion des candidats à la retraite sont prévues au sein de l’armée ? Pourquoi insister sur la nécessité de cette force lorsque le pouvoir en place est étiqueté de posséder une milice ? Serait-ce une ruse politique à peine voilée pour légitimer a posteriori l’action des miliciens qui se fait parler même au-delà des frontières nationales ? Comment gérer deux armées parallèles (en plus des anciens combattants), une statutaire et une autre de stagiaires ? Comment gérer au sein d’un même corps des soldats formés professionnellement et des réservistes à la formation paramilitaire ? Il y a beaucoup de questions pendantes qui interpellent le pouvoir en place à fournir plus d’éclairage aux Burundais. Parce qu’eux seuls seront confrontés aux conséquences de cette dichotomisation.
Après tout ça… « Au nom du peuple burundais », laissez-nous au moins danser au rythme du tambour de nos ancêtres
Quand les battements du tambour résonnent, ils font bouger même un enfant dans les entrailles d’une maman ; interpellent les passants sur l’existence d’une joie partagée, ils font oublier la fatigue d’une journée de travail au rendement incertain. Ce tambour qui est devenu, non seulement un patrimoine des Burundais, mais aussi de l’humanité, est plus que jamais frappé d’interdits quand il n’est pas soumis à une marchandisation éhontée. Plus que jamais, jouer au tambour n’est pas moins un exploit. Plus que jamais, il faut un code vestimentaire, un code génétique ! Les femmes en sont exclues. Domaine réservé de la gent masculine ! Pourquoi, elles, pas les hommes dans un pays qui reconnait l’égalité des genres ? Le gouvernement en imposant ce code de conduite en a fait sa chasse gardée. Contrairement aux tyrans antiques qui offraient du spectacle pour faire oublier le malheur, ici c’est comme si même la joie nous est confisquée. Or il n’y a de plaisir que quand il est partagé. Remettez le sourire aux Burundais, laissez-les battre le tambour, danser, exhiber les talents, transmettre des messages, vous glorifier, mais aussi vous signifier les impasses, les mécontentements ; vous interpeller sur vos dérives parce qu’il y en a. Simplement danser au rythme du tambour. Au nom du Peuple burundais… C’est notre tambour, notre joie, notre patrimoine culturel commun. Rire et danser, c’est pour beaucoup d’entre nous, ce qui nous reste…
 *Gérard Birantamije est chercheur en sciences politiques à l’Université Libre de Bruxelles. Ses recherches portent sur les politiques de paix et de reconstruction de l’Etat dans la région des Grands Lacs.
*Gérard Birantamije est chercheur en sciences politiques à l’Université Libre de Bruxelles. Ses recherches portent sur les politiques de paix et de reconstruction de l’Etat dans la région des Grands Lacs.
*Les articles de la rubrique opinion n’engagent pas la rédaction








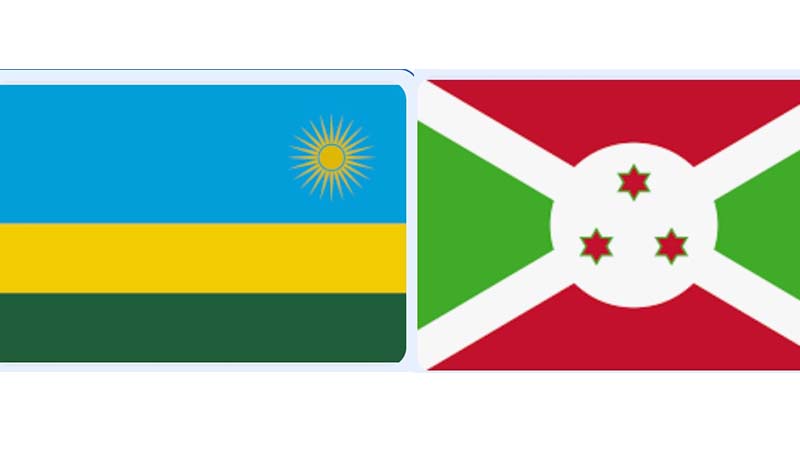











Gouverneur n’est pas facile. Être un Gouvernement pas mou,qui se veut implanter un vrai changement demande du courage et de pouvoir faire passer des lois mêmes inpopulaire.
Ce que j aurai souhaité,c’est que l’Etat fasse un travail de sensibilisation plus poussé,pour éxpliquer le bien finale de toutes ces reformes.
À vous tous, chers lecteurs et commentateurs de cet article, cessez d’encenser et de lancer des fleurs à quelqu’un qui appelle des kiosques en planches, des « infrastructures »… et la destruction de ces mêmes kiosques « une politique de « destruction massive » »!
Une infrastructure, c’est une rue, un marché public, une gare de train, un stationnement, un aéroport, un hôpital, une école, etc… L’auteur veut-il insinuer que le « premier burundais » ou le Gouvernement sont coupables des incendies qui ont ravagé les marchés et la prison qui ont brûlé? Si on peut admettre qu’un marché, une école ou une rue sont des infrastructures de proximité, veut-il aussi dire que les prisons, quoique des infrastructures, peuvent aussi être considérées comme « de proximité »? Pour qui et dans quel intérêt?
Et pour la « destruction massive », je n’ai pas vu de quartiers entièrement rasés par cette prétendue destruction tellement massive que des coups de pieds ont suffi pour la tâche! (cfr. photo ci-dessus).
En Occident, si vous stationnez votre véhicule dans une zone interdite pour une période de la journée, on vous colle une amende. Si vous recidivez un autre jour, à la même place, on vous colle une nouvelle amende! Si par hasard vous stationnez dans une zone dans laquelle il est prévu des travaux, non seulement on vous colle une amende, mais également on remorque votre véhicule à vos frais. C’est-à-dire que, dans certains cas, vous ne pourrez même pas récupérer votre véhicule sans avoir payé la facture de remorquage. Et c’est à vous de vous débrouiller pour trouver où et par qui votre véhicule a été emmené! Vous pourrez vous plaindre contre l’État ou le remorqueur si le véhicule subit des dégâts pendant le remorquage, mais vos chances de gagner votre procès s’en trouveront diminuées.
Avant de procéder au démentèlement de ces kiosques, le Gouvernement a donné un délai et l’option aux propriétaires de se conformer à la loi en détruisant eux-mêmes leurs kiosques, avec la possibilité de récupérer leurs matériaux de construction. Auriez-vous aimé que le Gouvernement les laisse continuer à violer la loi?… Qu’il leur colle des amendes?… Ou encore que le « démentèlement » se fasse aux frais des propriétaires?… Ou encore (encore!) tout ce qui précède à la fois?
Quant à la continuité de l’État, j’espère que vous ne voulez pas demander au Gouvernement de laisser se perpétuer une violation avérée de la loi, sous prétexte qu’il s’agit d’un gagne-pain et que les gouvernements précédents ont fermé les yeux. J’espère également que vous ne voulez pas que le gouvernement les indemnisent pour avoir violé la loi, quand bien même cela se serait fait avec la complicité des irde gouvernements précédents!
Le vol est aussi un gagne-pain… Voulez-vous qu’on laisse le voleur voler, sous prétexte qu’il a faim et que le vol est son seul moyen de survie?
Vous ne pouvez pas demander qu’il y ait un État de droit sans en même temps demander que l’État fasse respecter la loi. C’est pourtant la substance contenue dans cet article.
*Trucs et astuces : je vous propose ce lien sur les techniques de manipulation : https://www.penser-et-agir.fr/technique-de-manipulation/
Intéressez-vous surtout à celui qui s’appelle « Le mille-feuille argumentatif ». Vous reconnaîtrez le même style dans ce texte.
Je m’adressais surtout aux lecteurs et aux commentateurs… L’auteur savait ce qu’il faisait.
*Protégez-vous, c’est offert.
Au fait, les millions de dollars du nickel ? Sauriez-vous s’ils sont déjà dans les caisses de la BRB ?
Bravo pour ce raisonnement dynamique et structuré.
Cependant, une autre analyse sur le programme qui nous a permis d’élire notre président serait la bienvenue. En effet, sur cette base, nous pouvons juger si les promesses sont tenues ou pas.
Si nous l’avons élu sans programme, nous ne pouvons qu’ à nous en prendre à nous-même.
Ou si des partis politiques pensent que le comptage des votes n’a pas respecté la réalité, comment préparent-ils les prochaines échéances électorales pour éviter cette situation ?
Quel que soit le pays, un peuple qui ne revendique pas ses droits jusqu’à en payer le prix, même de sa vie, restera un peuple de sujets tout simplement.
Monsieur Birantamije! Merci. Ta réflexion est profonde et froide! Nous en avons besoin. Les décideurs politiques devraient réfléchir deux fois (si pas plus) avant de « décider ». Ce peuple a beaucoup souffert, sa résilience a été mille fois mise à l’épreuve. C’est autant de raisons pour ne pas le brutaliser davantage.
Au nom du peuple:
1) Notre pays est devenu le pays le plus pauvre et le plus corrompu au monde
Nous ne voyons aucune vision de la part de ceux qui nous gouvernent pour s’en sortir.
2) Que sont devenus les 15 jours promis pour châtier les responsables du « Mpanda Gates »?
2) Les entreprises suivantes sont en déperdition: Regideso, Onatel, Rnp, etc… . Pourquoi et comment?
3) Pourquoi nos dirigeants ne déclarent ils pas leurs biens à leur entrée en fonction?
Je réponds à moi même. Pour cacher l’extrême corruption qui fait du Burundi le pays le plus corrompu et le plus pauvre au monde.
C’est étonnant à quel point votre « inventaire » change complètement de sens si on remplace votre titre par « Au nom de la loi…. »!
Allez-y, faites l’exercice et vous constaterez par vous-même!
Quand on écrit un texte d’opinion avec une intention aussi manifeste de ternir l’image des autres, on oublie souvent qu’une simple tournure peut tout ruiner.
Bonne lecture!
@Gérard Birantamije
« Que serait Abidjan ou Cotonou sans ces « maquis » ? Marrakech sans ses souks ou « Matongé » à Bruxelles sans ces petits « shops » disséminés ici et là ? »Marrakech sans ses souks ou « Matongé » à Bruxelles sans ces petits « shops » disséminés ici et là ? »
Pour juste parler d’un endroit que je connais, à Matongé (de Bruxelles), il n’y a pas de boutique érigée sur le trottoir (Chaussée de Wavre et d’Ixelles). A ne pas comparer avec les constructions érigées sur les zones réservées aux voiries publiques. Ceci dit, je condamne aussi énergiquement les préjudices subis par les personnes dont les bâtiments ont été détruits, alors qu’ils avaient, à l’époque, obtenu des permis de bâtir en bonne et due forme.
Merci Mr Birantabije pour cette tribune. Ça fait du bien. Mille merci
« Le ‘Nous’ et les ‘Autres’. Des ‘privilégiés’ et des ‘sans-culottes ». Ce n’en est pas moins une bombe à retardement et à sous-munitions. »
Cette phrase en vient à résumer la situation. Mille merci à Mr Birantabije! Mille merci à notre journal Iwacu modèle dans la région