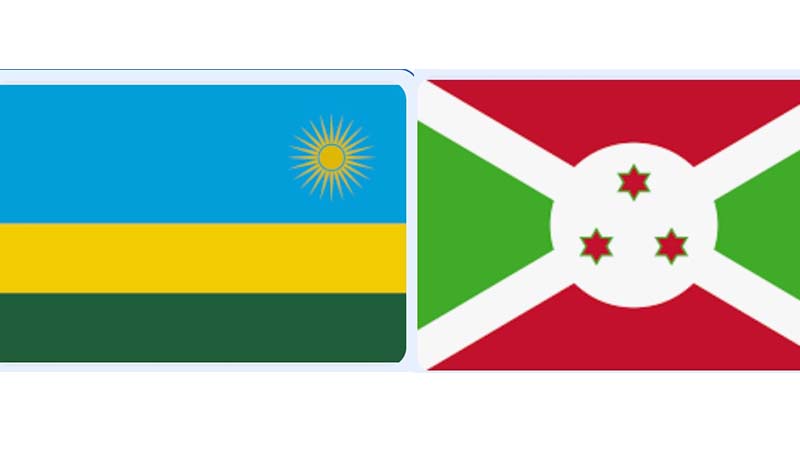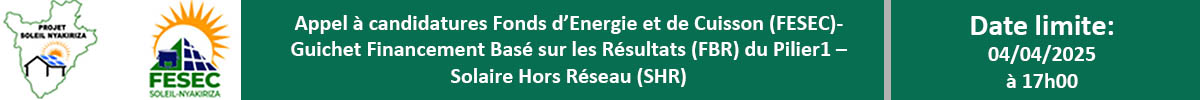*Par Gérard Birantamije
« Arrangez-vous, vous, la majorité, qui êtes plus proche de Mago (Ruyigi, Gitega, Rutana, Gisuru, Nyabitsinda, Muhwazi…) venons-en, constituons-nous un jury pour annuler son certificat » (Traduction d’un Message supposé d’un Directeur Provincial de l’Enseignement-DPE )
Ce message serait la réaction d’une haute autorité d’une province scolaire. Il a été beaucoup partagé sur les réseaux sociaux. Un petit rappel des faits. Une adolescente en pleine passation du prestigieux examen d’Etat donnant l’accès à l’enseignement supérieur a réussi un autre exploit, tout aussi prestigieux. Mettre au monde toute seule. Un enfant qui donne vie à un enfant sans aucun soutien. Ni médecin, infirmier, ou sage-femme. Même les examinateurs qui auraient pu l’aider en recourant à leur expérience de mère ou de père. N’ont rien su. Aucun cri. Stoïque, la petite a souffert seule, car l’accouchement n’est jamais un jeu. C’est un père de famille qui vous parle et toutes les mères confirmeront.
Et WhatsApp s’est emparé de l’histoire. Dans nos coutumes, du moins ce qui nous en reste, à la jeune fille photographiée pensive et dépassée par les événements, on aurait dit « Simbimbanga- kibondo », que l’on traduirait plus ou moins par « sois reconfortée chère enfant ». Je rappelle que parfois des mères ne survivent à l’accouchement. Avec cet accouchement, dans ces conditions précaires, le risque était grand de perdre les deux enfants, le bébé et la jeune maman.
Je reste pantois face au déchainement de paroles, parfois très méchantes envers cette pauvre enfant.
Des paroles trop cruelles parfois. Comme si on a oublié cet adage ancestral : « umwana s’uwumwe- (l’enfant appartient à la communauté). Cette jeune fille et son bébé sont nôtres.
Hier n’est pas aujourd’hui, vaut mieux le savoir…
Nous avons appris dans « Imigenzo y’Ikirundi (les coutumes burundaises) » qu’il était interdit à toute jeune fille de mettre au monde avant le mariage. La fille-mère risquait de se voir jetée dans le précipice dans de lointaines contrées (Ku mpinga). Si l’histoire de cette pratique sociale quasi mythifiée nous donne peu de cas avérés, cette punition, disons même cette peine capitale, aura développé une sorte de crainte trans-générationnelle de consommer l’acte sexuel avant le mariage. La symbolique de cette crainte s’est effritée, parce qu’autour d’elle les pratiques cultuelles telles que la sacralisation de la chasteté (Isugi/ubusugi) ne font plus l’image prisée d’antan. De la crainte, on en est venu à la contrainte. Parce que pour cause au centre se trouve l’humain. D’abord la consommation de l’acte sexuel ne relève pas moins des besoins physiologiques, et partant, celui qui voit les soupapes cédées ne commet pas un crime au sens juridico-judiciaire du terme. Il répond à ses pulsions corporelles attestant d’un bon fonctionnement de son système reproductif, partie intégrante de son corps. Ensuite, ne l’oubliez pas, une jeune fille dans la fleur de l’âge est bien côté à la « bourse », scrutée d’un œil glouton par la gent masculine. Le marché de la demande est souvent en hausse, et parfois il y a le plus offrant en termes de charme. Mais il y a aussi des fois l’amour simplement, le coup de foudre. Pour « cueillir la fleur », les courtisans et/ou les courtiers sont prêts à tout. De cadeaux qui viennent parfois comme des réponses aux angoisses matérielles, voire existentielles. Enfin, il y a les mécanismes para normaux, ou encore anormaux : les rapports de force au niveau sociétal, les viols. Bref, toutes ces pratiques font de la jeune fille d’ici ou d’ailleurs la proie chétive des fauves ubiquistes qui rodent et roderont encore autour des jeunes filles. Les Evelyne sont nombreuses en ce moment.
Mais encore hier n’est pas aujourd’hui. Ces jeunes filles sont-elles à jeter dans les précipices comme à l’époque mythique ? Et c’est pourtant ce que le message supposé du Directeur Provincial de l’Enseignement veut dire. Je peux me tromper sur la signification profonde, mais les marges d’erreur sont limitées. Cette jeune fille, désormais « Maman » est à rejeter, à jeter dans le précipice. Mais le précipice a changé de forme. Elle n’aura pas droit à son certificat, disons-le bien, à son Diplôme de fin des humanités générales/techniques. Ce diplôme c’est au moins onze années de durs labeurs, de nuits blanches, de cauchemars, de peines dans ce coin quasi perdu où on se réveille cinq heures pour commencer la révision en mettant à profit les premiers rayons de l’aurore. Je sais de quoi je parle pour avoir été élève et enseignant dans la même aire géographique. Onze années, c’est toute une vie. Surtout, ce diplôme c’est peut-être son premier et son dernier investissement dans ce pays où l’enseignement supérieur est devenu de plus en plus un luxe.
Encore une fois, il faut que les gens se rappellent qu’hier n’est pas aujourd’hui. Hier, sans diplôme, on pouvait mener sa vie, peu importe la qualité, l’aune était à portée de main. Le voisin. Tous mènent une même vie. Il n’y avait pas trop à envier. Il y avait la terre à gratter bon an mal an. Les relations sociales n’étaient pas monétarisées. Tout se troquait. Aujourd’hui, le diplôme c’est une nouvelle forme de lopin de terre, que chacun cultive à ses talents. Priver à cette jeune fille son diplôme, c’est la dépouiller de ce lopin de terre pour lequel elle s’est battue jusqu’à passer son dernier examen en plein travail. Si elle a résisté aux douleurs de l’enfantement, ce n’était pas pour voir s’abattre sur elle le courroux des administratifs qui lisent et appliquent sans état d’âme un article d’un règlement.
Mais au-delà c’est condamner à peine né, ce rejeton qui a pleuré dans les toilettes de ce centre de passation d’examens, ce bébé né comme les autres, mais qui risque de pleurer toute sa vie. Sans doute que cette jeune maman se disait en mettant un point et en scrutant sa copie avant de la remettre au summum des contractions de l’enfantement, « avec mon diplôme, le fruit de mes entrailles ne manquera de rien » se disait-elle peut-être pour supporter le supplice. Et voilà que l’étau se referme sur deux innocent(e)s. Comme dans un film, il y a FIN.
Ce n’est pas un fait divers
Sur les réseaux sociaux, les commentaires sont allés dans tous les sens : moquerie, compassion, empathie, nécessité d’intervention, des réquisitoires, des questions sur le sort du géniteur, condamnation au nom du tout féministe, etc. De telles réactions n’attestent pas moins qu’il ne s’agit point d’un fait divers. Le cas questionne nos rapports avec la sexualité dans notre Code légal commun tout comme dans notre conception des politiques publiques en matière d’éducation, de la jeune fille en l’occurrence.
Une adolescente comme Evelyne qui met au monde un enfant en pleine passation d’examen national montre le côté raté de notre éducation sexuelle à la maison comme à l’école. Au Burundi, la sexualité reste un tabou, on en parle rarement en famille. Rarement un papa parle à son fils de la signification du changement de voix, de l’apparition des poils pubiens ou de la barbe. Jamais ou presque des pollutions nocturnes au cours d’un de ces doux rêves que tout ado se fait au terme d’une randonnée virtuelle avec une « nana » du coin, réelle ou idéelle. Pire, les mamans ne parlent pas, ou plus tôt pas assez, des changements physiologiques de leurs fillettes : des seins qui poussent comme d’un coup de bâton magique, d’un bassin qui prend des formes provocatrices jusqu’aux premières menstruations, douloureuses sans doute, vécues comme un saut dans l’inconnu. Ces signes de maturité physiologiques devraient être expliqués à l’école, c’est là où l’enfant passe la grande partie de son temps, de sa vie. On laisse l’enfant aux paires qui se posent éventuellement les mêmes questions. Et pourtant c’est au cours de cette période que les questions de relations sexuelles, de rapports sexuels, de grossesse, de méthodes contraceptives devraient être posées ; les dangers d’une grossesse non désirée soulevés et expliqués. Notre société reste muette, trop muette.
Si Evelyne a mis au monde en pleine passation d’un examen national, c’est le symbole de la faillite de notre système éducatif, en famille comme à l’école. Chemin faisant, au lieu que ce cas fasse hurler l’administration scolaire pour prendre l’ultime décision d’annuler le certificat scolaire de l’infortunée et d’annihiler tant d’années d’effort et de mois de résilience face à une grossesse sans doute non désirée, elle aurait dû se réunir pour se remettre en cause, pour réanimer notre système éducatif, pour interroger la responsabilité collective en tant que parents et éducateurs. Les statistiques des grossesses des écoliers et des élèves donnent du tournis. Elles sont hallucinantes, mais n’interpellent pas la famille, la société, l’autorité. Puisse ce nième cas constituer un nouveau départ à neuf vers une prise de conscience collective sur la question des grossesses en milieu scolaire!
 *Gérard BIRANTAMIJE est enseignant et chercheur en sciences politiques et sociales, il s intéresse aux questions de reconstruction de l’ Etat au Burundi et dans la region des Grands Lacs.
*Gérard BIRANTAMIJE est enseignant et chercheur en sciences politiques et sociales, il s intéresse aux questions de reconstruction de l’ Etat au Burundi et dans la region des Grands Lacs.
Les articles de la rubrique « Opinion » n’engagent pas la rédaction