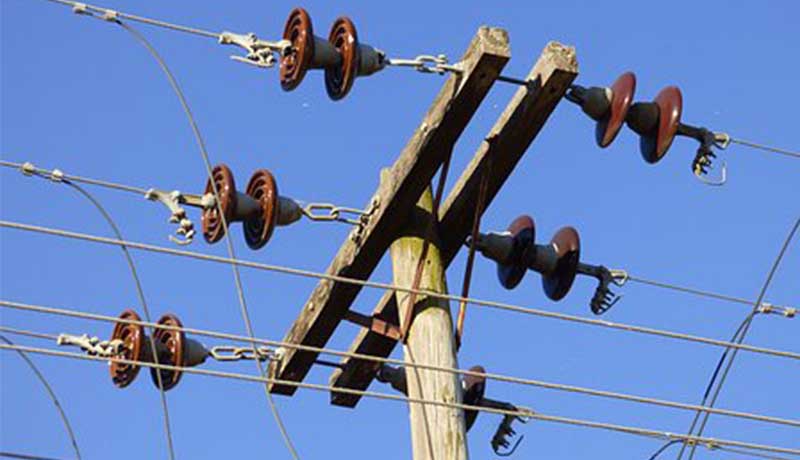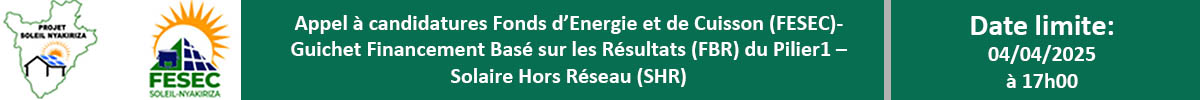Un atelier d’écriture, animé par Michelle Rakotoson, est prévu à l’Institut Français de Bujumbura. Les activités de l’écrivaine malgache coïncident avec [les cérémonies de remise du prix Michel Kayoya->http://www.iwacu-burundi.org/spip.php?article1118], organisées par le journal Iwacu, ce vendredi 28 octobre, à l’IFB. Elle raconte son expérience, son exil, …
<doc1761|left> Qu’est-ce qui vous a motivé à venir au Burundi ?
J’étais déjà venue au Burundi une première fois au mois de juin 2011, dans le cadre du colloque des auteurs des Pays des Grands Lacs, organisé par Sembura et j’en suis tombée amoureuse, tout simplement. Ma passion a toujours été de découvrir des jeunes auteurs. Or j’ai deviné un pays dont la problématique peut ressembler au mien (Madagascar). Un pays où des auteurs potentiels peuvent être découverts. Un pays de grande culture où la rencontre de la tradition et de la modernité peut faire éclore des talents. Difficilement, mais sûrement pas impossible. C’est la situation que j’ai découverte à Madagascar et on verra bien à la fin de l’atelier d’écriture ce que cela donnera…
Le terrain de l’écriture est encore vierge au Burundi. Il y a beaucoup plus de musiciens que d’écrivains, par exemple. A quoi vous attendez-vous réellement ?
Je ne m’attends à rien. Je ne suis pas arrivée avec des idées préconçues. Je n’ai aucune prétention. J’ai les outils nécessaires pour aider quelqu’un à dépasser la peur de l’écriture. C’est quelque chose que j’ai fait quasiment toute ma vie. On a toujours peur devant la page blanche. J’ai les théories et les pratiques pour aiguillonner les gens à trouver des solutions. Je suis venue apporter ce savoir-faire. Je ne connais pas les gens qui vont participer, leur niveau d’écriture, et, à la limite, ce n’est pas mon problème. Il peut arriver qu’il ne m’en reste qu’un à la fin de la semaine. Cela m’est déjà arrivé à Madagascar de pousser quelqu‘un dans ses retranchements jusqu’à ce que la personne laisse tomber. C’était une jeune slameuse brillante mais qui est revenue plus tard. L’écriture relève de l’intime, ce n’est pas pathologique.
Qu’avez-vous prévu pour l’atelier d’écriture ?
Il n’y aura pas de contacts personnels avec les stagiaires pendant l’atelier. Je ferai l’animation et je leur donnerai les outils afin qu’ils rentrent chez eux apprendre à écrire dans l’isolement le plus totale. Je ne serais pas la bouée de sauvetage. Ce n’est pas une rencontre avec un écrivain, c’est un atelier d’écriture avec obligation de rédiger un texte à la fin de la semaine.
Comment en êtes vous venu à l’écriture ?
Quand on rentre dans un art, c’est qu’il y a une fêlure quelque part, une blessure, on a envie de l’exprimer. J’aurais pu devenir pianiste ; mon père en était un très grand. L’écriture est restée parce que j’étais dans un milieu de gens qui aimaient les livres et l’écriture. C’est pour cela que je dis qu’il faut toujours accompagner l’écriture par les bibliothèques car le rôle d’une bibliothèque dans un pays est fondamental. Un enfant qui lit est un enfant sauvé. Un livre, même ceux pour les enfants, c’est l’expérience de plusieurs personnes. Un écrivain, c’est quelqu’un qui a lu cent livres et qui a mis dans ce petit récit toute une expérience. Un très bon livre peut aider à débloquer l’imaginaire. Vous pouvez être le roi de France, un avocat, un prêtre, se retrouver en Thaïlande… Un adolescent qui lit s’ouvre au monde.
Vous avez connu l’exil à un moment donné de votre vie. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
Je devais avoir 25 ou 26 ans et j’ai dit tout haut ce que tout le monde pense et murmure tout bas et j‘ai dû m’exiler.
Cela a-t-il eu un impact sur votre carrière d’écrivain ?
L’exil… (profond soupir) c’est extrêmement dur, et si on ne fait pas attention c’est destructeur. J’ai eu une chance extraordinaire de croiser une femme qui s’appelait Françoise Digier. Elle m’a proposé de travailler sur les concours littéraires et mon exil est devenu un enrichissement. J’ai pu rencontrer beaucoup d’auteurs avec des textes riches et différents. Puis un jour, une jeune femme m’a dit, en parlant de la France : « Dans ce pays, dis-toi qu’il y a beaucoup de gens comme toi. Tu as perdu ton pays, rejoins un autre pays qui est celui de tous ces exilés. » Je me suis reconstruite différente et une fois l’exil fini, je suis rentré chez moi. J’ai bouclé ce cycle et je ne veux pas me voir comme une nationalité exilée. La dernière partie du parcours, je n’étais plus exilée. J’étais une Malgache qui vivait en France. C’est très différent. L’exil, c’est quelque chose de fondamentalement destructeur.
Que représente pour vous l’écriture ? A vous entendre parler, on dirait que c’est un sacerdoce…
L’écriture est une folie. Je ne peux pas arrêter d’écrire. L’écriture est ma vie ou peut-être que l’écriture me quittera. C’est plutôt ça. A un moment donné, l’écriture vous quitte mais avant, il faut la transmettre pour qu’elle passe aux autres. Je commence à avoir l’âge ou sereinement je passe la main.
Quel est votre rythme de travail en général ?
Y a des moments de grands vides et des moments où j’écris beaucoup et là c’est terrible car je suis cyclique. Je me lève à 7h, je lis les journaux pendant une demi-heure et je regarde la télé jusqu’à 12h. Les après-midi, je regarde de nouveau la télé et je m’occupe d’autres choses jusqu’à 19h. Je dors jusqu’à 23h et à partir de cette heure, j’écris.
Et s’il y a une perturbation dans ce cycle ?
Je perds le texte pendant un mois. C’est pour ça que c’est maniaque, c’est de la folie. Cela a l’air complètement fou comme ça mais c’est passionnant.
Pour vous, quel est actuellement le rôle de l’écrivain dans une situation politique telle qu’au Madagascar (crise politique)? Ou du moins quel est votre rôle en tant qu’écrivain ?
Avant je pensais que l’écrivain avait un rôle de dénonciation politique. Mais non ! L’écrivain a son travail d’écrivain à faire. Écrivain, c’est un travail de recherche, un travail de profondeur, de construction de soi, de construction de l’autre. Je n’ai pas de leçon politique à donner. Je ne donnerai jamais de leçon politique aux Burundais comme je n’en donne plus à Madagascar. Je ne confonds plus les deux mais j’apprends à écrire. En écrivant, en analysant, en lisant on arrive à comprendre les raisons profondes de la crise. C’est là le travail de l’écrivain, poser des questions là où il faut les poser. De plus en plus loin, de plus en plus pointu. C’est là le travail de l’intellectuel.
L’écriture est-elle pour vous un exutoire ?
Un exutoire et une construction. Mais en vous reconstruisant vous reconstruisez aussi celui qui va vous lire. Un livre à mes yeux ne doit pas être haineux. Avant, dans mes livres, il y avait beaucoup de colère. Mais une fois rentrée à Madagascar, j’ai oublié la politique. Je n’ai vu qu’un peuple malheureux, un peuple à qui j’avais envie de dire « we can do it » (Nous pouvons le faire) parce que souvent les peuples du tiers-monde sont des peuples à qui on ne le dit jamais. À la place on leur dit: « Vous êtes sous développé » et j’ai souvent tendance à répondre : « Et alors ? ». J’ai envie d’ajouter : « Si vous pouviez vivre dans les conditions qui sont les nôtres, et bien bravo ! » S’ils survivent, s‘ils tiennent … c’est qu’il y a une force extraordinaire derrière. Allons donc voir dans cette force-là plutôt que dans la faiblesse.