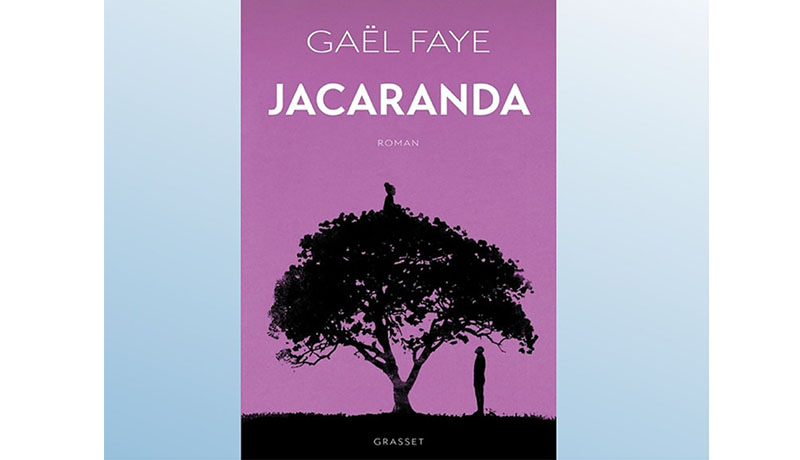Notre collègue de la Rubrique Culture, Roland Rugero vient de boucler le tournage de son premier long-métrage Amaguru n’Amaboko – Les pieds et les mains. Nous vous proposons l’interview accordée par le journaliste d’Iwacu à un confrère d’Afrique.fr.
Adolphe B.: Journaliste culturel, auteur de romans, animateur et co-créateur du café littéraire, et maintenant vous vous attaquez au cinéma. N’est ce pas trop pour une seul personne ?
C’est trop du moment que ce serait fait dans le but d’en faire beaucoup… Je pense que notre génération est à une époque extrêmement intéressante de l’histoire du Burundi, et que nous vivons des moments d’urgence : allons nous faire comme nos parents, ou pouvons-nous proposer autre chose à l’aune de leurs erreurs/ expériences? Dans un monde lui-même qui vit à vive allure (mutations sociologiques, technologiques, l’époque du haut-débit, …), dans l’urgence, nous devons agir, parler, proposer des débats, y participer, pour ne pas toujours rester à la traîne dans le concert des nations. C’est cette impression d’urgence qui peut faire qu’à un certain moment, on porte plusieurs casquettes à la fois. Mais, ne perdons pas de vue qu’avec l’âge, la prudence face l’aventure arrive. On se rend compte de plus en plus que l’on ne peut tout faire… Les autres prennent la relève, et le train continue.
Qu’est ce qui vous a poussé à écrire ce scénario? Sur le point de votre second roman, pourquoi avez vous choisi cette fois ci le cinéma comme moyen d’expression?
Parfois, les plus belles aventures ne commencent que par le hasard. J’avais écrit la première mouture de ce scénario en 2009 sur une idée originale d’un ami, devenu depuis animateur radio. C’était en pleine euphorie de la première Coupe du monde de football en Afrique, et l’histoire du personnage central de ce long-métrage en allait être un talent. Malheureusement, nous avons manqué de financement pour le tourner. Une année après, je l’ai proposé à Papy Amani, un jeune burundais très actif dans le cinéma (autant dans la formation que dans la production) et premier participant burundais à la Berlinale. Je lui ai proposé mon projet de film, et il l’a lui aussi trouvé intéressant. Sans moyens de financement, il l’a lui aussi déposé dans ses tiroirs. Quand est venu le concours proposé par la Deutsche Welle Akademie (Allemagne) à travers le World Fund Factories, en coopération avec la Berlinale, laquelle compétition a été soumise au Collectif des Producteurs de l’Audiovisuel et du Cinéma du Burundi- Co.Pro.D.A.C, nous nous sommes dit : « Pourquoi ne pas tenter?» Et voilà où nous en sommes !
Pourquoi le titre ? Pourquoi “amaguru”, pourquoi “amaboko”? De quoi parle le film ”?
Pour résumer, c’est l’histoire d’un jeune talent de football (amaguru) qui a une bourse de formation professionnelle. Mais son oncle veut la récupérer en usant de la corruption (amaboko) afin de la donner à son propre fils…
De ce film il en sort un pays hautement et profondément corrompu, un pays désastreux quasi irrécupérable ou inguérissable, le Burundi est il ainsi réellement ainsi selon vous ?
Je pense que ce serait simpliste de déduire de ce film une pareille vision. Malheureusement justement, on aime la simplicité… Pour revenir sur mon long-métrage, il faut d’abord considérer le cadre-même de son lancement. Si tout se passe bien, {Amaguru n’amaboko} sera projeté pour la première fois en 2012, soit exactement 50 ans après l’Indépendance. Le long-métrage que je propose est un regard sur un aspect de la réalité d’un peuple, qui ne peut pas, bien évidemment, être réduit à une seule facette. Et de cette lucarne, je pose la question des valeurs : comment dans un pays où nous chantons tous les jours le « respect », « l’amour des siens », le respect de l’héritage de nos aïeux, en est-on arrivé à des cas où un père de famille vole la bourse d’un de ses neveux ? La plupart des acteurs (burundais, tous) qui ont lu ce film m’ont dit : « Mais je connais cette histoire! » Des cas pareils sont donc nombreux dans la mémoire collective. Et face à nos 50 ans d’Indépendance (ou d’autonomie décisionnelle, dirons les autres), rappeler la question des valeurs est interpeler sur l’essentiel : quand il n’y a plus de sacré, que l’on ne respecte plus son enfant (neveu), quand l’argent devient roi alors que le respect du prochain devrait être la norme, il y a matière de s’interroger. Et il est urgent d’en parler, en utilisant un vecteur de débat jusqu’ici peu entraîné dans la fiction: le cinéma. Sinon, le Burundi reste une société riche, complexe, malade, mais avec ses beautés, aussi! Ce n’est pas pour rien que le film a été tourné en grande partie à Buyenzi …
“Amaguru n’amaboko” c’est du vécu ou il s’agit tout simplement d’une fiction ?
C’est une fiction, de bout en bout. Mais la plupart des gens y retrouvent une histoire connue…
Dernièrement, de nombreux films produits au Burundi et qui circulent dans de nombreux festivals du monde affrontent ou présentent la face sombre ou obscure du pays (la guerre, le conflit-hutu tutsi, la colonisation, etc. Ici je fais allusion à «Na wewe», «Histoire d’une haine manquée»,… Et «amaguru n’amaboko» emboite le pas des autres films en présentant à la face du monde un Burundi corrompu. A quand un film qui présente la face positive du Burundi? C’est à croire qu’elle n’existe pas.
Je pense que «Amaguru n’amaboko» est un film destiné premièrement aux Burundais. Nous avons tenu à ce que la langue de jeu soit le kirundi. Des Burundais (ainsi que des non-Burundais) sont assez intelligents pour voir, savoir que tout le pays n’est pas corrompu! Il y a longtemps que nous n’existerions même pas… Mais certainement, à la vue de certains personnages, on sera emmené à s’interroger sur la place de la corruption (qui peut revêtir de très nombreuses formes) dans notre vie. C’est mon souhait. Si vous sous-entendez que le film développe des clichés du « Burundais corrompu », je vous comprends : toute œuvre d’art porte en lui le risque d’une caricature. C’est le risque majeur du métier. Enfin, le choix d’un « traitement de la face positive du Burundi » ne revient pas, en tant que tel, à un artiste. A un communicateur, oui. Une société n’avance pas parce qu’elle s’accroche à ses beautés, mais parce qu’aussi, elle sait se regarder dans un miroir et reconnaître ses petites tâches de laideurs… Je n’ai pas de prétention à être un communicateur donc. Et il y en a qui sont chargés de cela, ne vous en faites pas. Même si leur travail est souvent contestable : la preuve, il n’y a pas de film qui « présente la face positive du Burundi »…
Le film affronte le phénomène de corruption à tous les échelons, vu l’importance du thème dans l’actualité politique, est-ce que ça été facile de faire passer le projet auprès des autorités? Si non quels problèmes avez-vous rencontré ?
Nous avons été présenter le scénario au Ministre en charge de la Culture, qui a accueilli le projet avec enthousiasme. Il était heureux que le film place au centre la jeunesse, avec un accent particulier sur les valeurs de notre culture… Nous avons été présenter aussi le scénario à la Police, pour avoir les autorisations de tournage, la sécurité sur les différentes sites de tournages, ainsi que des tenues policières exigées dans certaines scènes du film. Pour nous accorder tout cela, on nous a recommandé de revoir notre scenario pour préserver l’image de la police, engagée elle-même depuis quelques mois dans une phase de lutte contre la corruption. Sans hésiter, nous l’avons fait : «atagasohotse, ntakinjira» – Sans rien qui entre, rien ne sort – , nous conseille la sagesse burundaise.
Mais il y a eu une suspension par le CNC de votre tournage ?
Oui, et c’est le plus gros des soucis, avec le Conseil National de la Communication qui a suspendu le tournage une semaine et quatre jours après les débuts. Motif : une loi qui stipule que tout scénario doit être présenté au CNC avant tournage. Laquelle loi était tellement méconnue que nous avons dû nous rendre nous-mêmes au siège du CNC pour de plus amples éclaircissements… Il nous a fallu près de deux semaines pour avoir l’autorisation de tournage. Et maintenant, c’est fait. Sincèrement, on espère un débat sur l’opportunité de cette loi qui peut très facilement s’apparenter à la consécration de la censure. Ce « détail » sera saisi avec plus d’efficacité s’il est abordé par les grandes structures du cinéma burundais comme le Festicab ou le Co.Pro.D.A.C.
Quel rapport y a t-il entre vous et le COPRODAC ?
Le film que nous tournons a été choisi pour être techniquement soutenu par la Deutsche Welle Akademie (Allemagne) à travers le World Fund Factories, en coopération avec la Berlinale à travers un concours de scénario organisé par le Co.Pro.D.A.C. Et j’espère fortement qu’il y aura pleins d’autres projets de cette plate-forme destinés à rassembler les producteurs de cinéma burundais pour mieux défendre leurs intérêts. Et, il faut le souligner: dans un secteur où la compétition est si forte, c’est une structure très rare en Afrique pour qu’il n’y ait pas de bailleurs pour soutenir de plan de développement à moyen et long terme… Et tout cela dépendra des producteurs burundais, de leur volonté de travailler en commun!
Le film affronte le phénomène le problème corruption, sans toutefois proposer clairement une solution ou une voie de sortie. Pourquoi? Quels seraient les solutions selon vous au de-là de ceux envisagées par loi ou l’appareil étatique? Ne croyez vous pas qu’il faudrait surtout changer de mentalités ?
C’est l’éternel question sur le prisme de vue de l’artiste si chère à l’opinion burundaise (et ailleurs aussi, peut-être) : puisqu’il pose souvent des questions, à l’artiste de proposer des solutions. Je dis très rapidement non! Car, souvent, les solutions aux problèmes que nous soulevons sont d’ordre politique. N’ayons pas cette prétention de le devenir. Très concrètement, avec Amaguru n’amaboko, j’offre, c’est vrai, un regard sur le délabrement de valeurs ( corruption, mensonge, …) en prenant soin de montrer que tout cela ne part des « hautes sphères » comme on aurait l’habitude de le penser, mais de nos familles! Et peut-être, la solution au problème est à chercher de ce côté-là. Et soyons clairs : nulle solution ne pourrait avoir d’effet global s’il n’est envisagé par un discours politique authentique (c’est à dire qui allie l’argument/la communication à la loi et à la sanction). Le changement de mentalités, nécessaire, est un processus de longue haleine, inscrit dans le temps, et qui touche à ce que l’État a de plus précieux pour modeler la société : la culture. Et, pour être aussi un journaliste culturel, j’observe des détails clairs qui me laisse penser qu’on y est, au Burundi, dans ce « remodelage » de notre culture…
Non seulement vous êtes l’auteur du scenario de «Amaguru n’amaboko» mais vous en êtes aussi le réalisateur. Parlez nous de cette première expérience. Est-ce une expérience revivre prochainement? Quels sont vos projets pour l’avenir?
Ce fut une expérience certes très enrichissante, mais aussi dure parce qu’elle appelle à être sûr de soi, à s’imposer. Sinon la vie du plateau devient une anarchie, où les voix se corrompent dans un brouhaha qui détruit le tournage. Mais grâce aux encouragements des uns et des autres (et j’avais tenu à signaler à tout le monde que j’étais un novice en la matière), et surtout aux conseils de Papy Amani, mon producteur, de Pascal Capitolin, responsable de l’équipe son ainsi que de Jean-Marie Ndihokubwayo, Directeur de Photographie, j’ai pu vraiment intégrer la peau d’un réalisateur après quatre jours de tournage. Maintenant, ça va. A revivre ? Je ne sais pas. Mais sûrement, des projets d’autres films peuvent apparaître. Et il y a des pistes de réflexion, notamment sur des sujets moins » lourds « …
«Amaguru n’Amaboko» n’épargne presque aucune catégorie sociale de ce «fléau» de corruption. Tout le monde est coupable? Si oui personne n’osera donc jeter la première pierre ?
Tout le monde n’est pas coupable. Mais tout le monde est interpelé ! Et dans cette histoire de corruption, qui touche à des processus qui ont pris des années et des années pour s’installer (souvent, on en fait inconsciemment la caricature de réduire le phénomène de la corruption au pouvoir actuel), qui ont nourri et font subsister des familles entières; en d’autres termes, face à un phénomène de société, il faut éviter de dire : » Tel mérite de jeter la pierre sur les autres! » La seule personne qui est appelée à jeter la première pierre et même la dernière, à ceux qui usent de la corruption, c’est la loi. Soyons donc les serviteurs obéissants de la loi et le reste viendra.
A quand la sortie de «Baho»? Quelques anticipations à propos de votre second roman ?
Mon second roman paraîtra vraisemblablement au début de l’année prochaine. Il offre un regard sur la question de la justice populaire, dans un langage de cœur et de mémoire que je voudrais être le plus proche du kirundi… Il est essentiel que nous apprenons à parler de nous, les Burundais.
Merci pour l’entretien …
Merci à vous, de vous intéresser à notre travail. Comme disait l’autre, Vive le Burundi!