D’après un docteur en droit et chercheur, la loi de 2003 portant répression du crime de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité est sans équivoque. L’enquête et la qualification des crimes commis au Burundi depuis le 1er juillet 1962 jusqu’à la promulgation de cette loi relèvent de la Commission d’Enquête Judiciaire Internationale.
Qui peut qualifier un crime de génocide ?
Il existe une démarche judiciaire de qualification et une démarche politique, non pas de qualification, mais de reconnaissance. Les deux sont complémentaires. L’on oublie souvent que lorsque l’on parle du génocide, l’on parle avant tout d’une INFRACTION et non d’un phénomène politique vague aux contours imprécis.
Mais quel juge et quel politique ?
Excellente question. Commençons par la qualification, donc par la question : quel juge ? Lorsque la loi du pays le permet, le juge pénal interne est la première autorité habilitée à qualifier. Il nommera les faits et déterminera la responsabilité individuelle d’une personne déterminée. Cela se fait donc dans le cadre d’un procès pénal.
Lorsqu’il y a un juge pénal international compétent pour le cas en question, il pourra être saisi, généralement lorsque le système interne aura été défaillant. Les deux ne pourront pas connaître du même cas successivement. La double condamnation est interdite (non bis in idem).
Dans l’ordre juridique international, il existe même une possibilité d’engager la responsabilité de l’Etat lui-même, sur un champ non pénal. Ainsi, l’article IX de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, que le Burundi a ratifiée, donne le droit à n’importe quel Etat partie de saisir la Cour Internationale de Justice (CIJ) portant plainte contre un autre Etat partie qui est en train de commettre le génocide contre une partie de son propre peuple ou qui ne prend pas des mesures suffisantes pour prévenir ce crime. C’est un mécanisme de solidarité humaine.
L’idée est que les Etats ne possèdent pas les composantes de leur population, fussent-elles des minorités (ethnique, religieuse, etc..). Ils ne pourraient donc pas s’en débarrasser, même lorsque cela les arrangerait politiquement.
Est-ce que ceci n’est pas de la pure théorie, excusez-moi, du «blabla» du droit international fait pour dormir dans les livres?
Pas du tout. Dans l’actualité récente, un brave Etat africain, la Gambie, a porté plainte contre un Etat asiatique, la Birmanie, parce que celui-ci commettait/échouait à prévenir un génocide contre une minorité ethnico-religieuse dans ce pays, à savoir les Rohingya.
Mais vous disiez, à propos du juge interne, qu’il faut que le droit national le permette. Est-ce possible que tel ne soit pas le cas ?
Malheureusement si. En droit burundais, par exemple, nous avons bien sûr des dispositions sur le génocide dans nos lois pénales, mais elles nous sont inutiles pour la tragédie de 1972, tout comme d’ailleurs pour celle de 1993.
Comment cela ?
Le premier texte légal promulgué au Burundi parlant de génocide est la loi n°1/004 du 8 mai 2003 portant répression du crime de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité.
L’article 32 de ce texte dispose que l’enquête et la qualification des actes de génocide, des crimes de guerre et des autres crimes contre l’humanité commis au Burundi depuis le 1er juillet 1962 jusqu’à la promulgation de cette loi seront confiées à la Commission d’Enquête Judiciaire Internationale.
Donc, le législateur burundais, suivant l’Accord d’Arusha, a décidé de confier la qualification des crimes de ces périodes troubles du passé aux Nations unies.
Le label ’’génocide’’ est alors indisponible au juge burundais qui aurait à connaitre des crimes de 1972, de 1988, de 1993, bref de tout crime commis avant le 8 mai 2003.
Quid de la reconnaissance politique ?
La reconnaissance politique est possible. Elle aura cependant la fragilité de ne renvoyer à aucun acte judiciaire qui en renforcerait l’autorité morale. Ce ne serait cependant pas la première fois que cela arrive dans l’histoire.
Pour prétendre à une quelconque autorité morale, la reconnaissance politique d’un génocide doit résulter d’un mécanisme qui inspire confiance. L’on ne va plus dans cette direction lorsque l’on passe à côté de la voie voulue par les Burundais et exprimée, non seulement par le biais de l’Accord d’Arusha, mais aussi dans les consultations populaires sur la justice transitionnelle. Parce qu’il y a des questions qui surgissent immédiatement : pourquoi procède-t-on ainsi ? Pourquoi se fout-on des formes ? Que cache-t-on ?
Au fond, qu’a-t-on à opposer à ceux qui disent que c’est justement par peur de découvrir la vérité que l’on trace ses propres voies, non consensuelles ? N’est-ce pas pour faire valoir sa propre vérité, écrite d’avance ?
Vous parliez des différentes dates, pourquoi justement, d’après vous, il y a un focus sur 1972 ?
Je ne vais pas spéculer. Il faudra poser la question aux responsables du Sénat et de la CVR. Mais justement des autres dates, il faudra en parler. La principale personne-ressource du Sénat pour les conférences en train de se tenir en sait quelque chose, mieux que quiconque.
Pourriez-vous être plus précis !
Dans une autre qualité, celle de président de la République, M. Sylvestre Ntibantunganya a saisi les Nations unies pour enquêter sur l’assassinat du président Melchior Ndadaye et sur les massacres qui s’en sont suivis. Cette Commission, créée par le Conseil de Sécurité, a établi le rapport S/1996/682. Le Secrétaire Général des Nations unies a adressé ce rapport au président du Conseil de Sécurité en date du 25 juillet 1996.
Quel était le contenu de ce rapport ?
Ce rapport a détaillé le rôle du Commandement de l’armée de l’époque dans l’assassinat du président Ndadaye et de ses collaborateurs.
Mais il a également fait deux autres affirmations très importantes. La première est que les éléments de preuve dont elle disposait suffisaient à établir que « des actes de génocide ont été perpétrés au Burundi contre la minorité tutsie le 21 octobre 1993 et les jours suivants à l’instigation et avec la participation de certains militants et responsables hutus du FRODEBU, y compris au niveau des communes » (paragraphe 483 du rapport).
La deuxième affirmation était que « des éléments de l’armée et de la gendarmerie burundaise et des civils tutsis ont perpétré un massacre aveugle d’hommes, de femmes et d’enfants hutus. » (Paragraphe 486 du rapport). Il va bien falloir que la CVR en dise quelque chose.
Quelle a été la réaction des acteurs politiques burundais ?
Ce rapport a suscité des réactions diverses au sein de la classe politique. Compte tenu du contexte politique dans lequel il est sorti (retour du Major au Buyoya au pouvoir par la force, sanctions régionales, timide début des négociations à Mwanza en Tanzanie, avant Arusha…), un consensus s’est dégagé entre politiciens pour ne plus en parler.
Il faut juste se souvenir du contexte politico-militaire de l’époque pour découvrir pourquoi le voile sur ce rapport arrangeait tous les acteurs majeurs de l’époque.
Ceux que le rapport ne pointait pas du doigt pour le génocide des Tutsi, il les indexait pour l’assassinat du président Ndadaye et des massacres dits de vengeance perpétrés contre la communauté ethnique Hutu.
Croyez-vous que la CVR et le Sénat se trouvent aujourd’hui au-dessus de cette mêlée ?
C’est ce que nous allons voir. Le président du Sénat dit qu’aucune période de l’histoire ne sera épargnée. Accordons-lui le bénéfice du doute et attendons.
On le jugera sur les actes, comme aurait dit le Prince Louis Rwagasore. Lorsque je dis ‘’on le jugera’’, je parle de lui personnellement, de la chambre qu’il dirige, de la CVR, des institutions dirigeantes en général.
Revenons à ce rapport de l’ONU, est-il toujours dans les tiroirs?

Il faut relever un point de l’actualité judiciaire du Burundi. Dans son arrêt rendu dans l’affaire RPS 97 du 19/10/2020, plus connue comme « Affaire NDADAYE II », la Cour Suprême cite abondamment des extraits de ce rapport dans ce qu’il contient comme informations factuelles sur l’assassinat du Président Melchior Ndadaye et surtout sur le déroulement de la nuit fatidique du 21 octobre 1993. Elle s’y base même pour condamner les officiers cités dans l’affaire. La Cour, ce faisant, cite bien sûr, le Ministère public.
Quelque chose cloche ?
Le gouvernement burundais a-t-il alors entériné le contenu de ce rapport? Les institutions devant être présumées cohérentes, la déduction peut être raisonnablement faite.
Une prise de position explicite serait quand même la bienvenue. Si le gouvernement disait ne pas reconnaitre ou rejeter le rapport alors que la Cour Suprême vient de l’utiliser dans l’affaire RPS 97, il donnerait une image pitoyable de lui-même. La position serait éminemment problématique.
On prend un rapport, on le met dans les tiroirs. Selon les besoins d’une certaine cause, on le reprend, mais uniquement pour en extraire des éléments utiles à sa cause politique et après, on va le renier pour tout ce qu’il peut avoir de politiquement dérangeant. Espérons que tel ne sera pas le cas.
Existe-t-il des avantages ou inconvénients selon que la reconnaissance vient d’une autorité nationale ou internationale ?
Les reconnaissances politiques nationale ou internationale ne s’excluent pas mutuellement. Au contraire. Elles se conditionnent et se complètent. Il y a plusieurs raisons derrière la nécessité d’une reconnaissance internationale.
Même lorsqu’un Etat a déjà renoncé – comme le Burundi malheureusement – à la solidarité internationale en vue d’obtenir justice, la reconnaissance nationale devra s’accompagner d’un mécanisme de réparation.
L’on voudra ré-analyser certains pans de l’histoire et donc vouloir accéder aux archives non disponibles au Burundi. L’on voudra demander des comptes à des acteurs étrangers, et même à des Etats qui auraient joué un certain rôle. Tout cela est inaccessible dans un processus à portes fermées.
Que faire alors ?
Le plus important, cependant, l’on ne doit pas se voiler la face, l’implication de la communauté internationale donnerait de la crédibilité à ce processus et le validerait aux yeux d’une partie des Burundais. Il ne faut pas banaliser cette considération.
Ce n’est pas que les Burundais croiraient excessivement ou exclusivement les Etrangers. Ce ne serait pas juste de voir la chose de cette manière. Ce n’est pas par démission que les négociateurs d’Arusha avaient voulu impliquer la communauté internationale dans les mécanismes de justice transitionnelle. C’était plutôt par souci d’impartialité.
Le propre des crimes comme le génocide, c’est justement de déchirer le tissu social, de faire que les différentes communautés ethniques ne se fassent plus confiance. Refuser de reconnaître cela, c’est se voiler la face et s’engager dans un processus qui est alors tout le contraire d’une recherche de la vérité.
Au final, que risque-t-on avec un processus qui ne prend pas toutes ces précautions ?
En se privant de tous les moyens permettant de rendre le processus crédible, on ratera l’objectif. C’est aussi simple. L’on aura perdu du temps, de l’argent, mais plus important que cela, l’on aura perdu une chance de nous réconcilier. En cristallisant et en scellant des faussetés ou des demi-vérités, le risque est même pire que du sur place dans la marche vers la réconciliation. L’on aura davantage divisé la société.
Propos recueillis par Fabrice Manirakiza















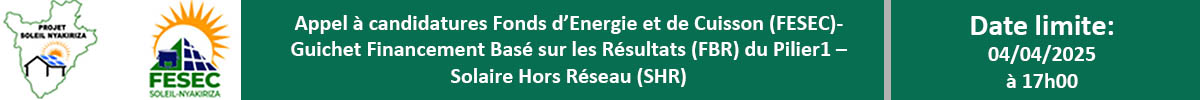






Le « génocide » par essence est un cime imprescriptible dans le temps et dans l’espace. Tôt ou tard les chaines établies par une petite clique de Barundi pour se prémunir de ce « génocide » ont commencé et finiront par être totalement brisées et les responsabilités établies pour le bien des générations actuelles et futures.
« Le label ’’génocide’’ est alors indisponible au juge burundais qui aurait à connaitre des crimes de 1972, de 1988, de 1993, bref de tout crime commis avant le 8 mai 2003. »
N’est-ce pas dans les prérogatives des élus d’élaborer et voter de nouvelles lois ou d’abroger/modifier des articles de lois qu’ils jugent obsolètes ou injustes? Ce fameux articles 32 de la loi du 8 mars 2003 peut être abrogé et modifié pour rétablir ce que les élus de l’époque ont voulu occulter ou camoufler.
L’ Accord d’ Arusha signé le 28 août 2000 traite longuement sur la question du genocide et de l’ Exclusion dans son protocole I, sur les principes et mesures relatifs au problème du genocide’ de l’ exclusion et leurs solutions en son article 6 , et sur les principes et mesures relatives à la réconciliation nationale, notamment sur les missions de la Commission nationale pour la vérité et la réconciliation (CVR) en son article 8.
Sur ce je pense qu’ il est inexact d’ affirmer “ qu’ il y aurait eu un consensus entre politiciens pour ne plus parler du Rapport de l’ ONU S/1996/682 du 22 août 1996.