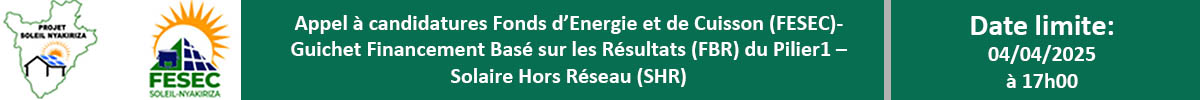En attendant l’ébauche finale du projet de loi sur la presse burundaise en cours de révision et la prochaine tenue des états généraux de la presse burundaise, Gérard Ntahe, spécialiste du droit des médias, s’est entretenu avec Iwacu. Il revient sur les points qui doivent faire l’objet de discussion.
Sous peu, l’actuelle loi sur la presse burundaise sera révisée. Selon vous, est-ce opportun ?
On ne peut que saluer cette volonté du gouvernement de vouloir apporter un coup de neuf au niveau de la législation du secteur des medias. Mais, pour que cette initiative soit la plus bénéfique possible, il faut que dans ce processus de révision, tous les professionnels des medias et d’autres personnes concernées, à l’instar des cinéastes, soient associés. Si l’on remonte dans le passé, l’adoption et la promulgation de la loi sur la presse de 2003 avaient été précédées par une large consultation de tous les intéressés sous l’impulsion du ministre de l’Information d’alors, Albert Mbonerane.
A cette époque, toutes les parties prenantes du secteur des médias avaient contribué dans l’élaboration de cette loi. A mon avis, un élément essentiel qui explique sa qualité et sa relative longévité par rapport à d’autres lois qui l’ont précédé ou suivi (elle sera abrogée en 2013, NDLR). C’est cet esprit-là qui devrait prévaloir.
Actuellement, les journalistes sont, en cas de délit de presse, sanctionnés conformément au code pénal. Compte tenu de la spécificité de leur métier, ne devraient-ils pas jouir d’un traitement spécifique ?
Au sortir des Etats généraux de la presse de 2011, les professionnels des medias et le gouvernement s’étaient entendus sur le principe de la dépénalisation des délits de presse. Un principe selon lequel, dans la loi en gestation, les peines de servitude pénale seraient remplacées par des peines alternatives comme des amendes.
Une parole qui a failli être jointe aux actes en 2013. Dans la loi sur la presse de 2013, les peines de servitude pénale ont été effectivement supprimées. Néanmoins, elles ont été remplacées par des amendes pouvant aller de 2 millions à 6 millions de BIF. Si l’on s’en tient aux revenus des journalistes ou budgets de fonctionnement de certains medias, des sommes astronomiques. Pour tout dire dans la pratique, cela revenait à ramener sous une forme déguisée la servitude pénale prétendument supprimée.
Concrètement ?
Il suffit de lire le code pénal alors en vigueur. A défaut du paiement d’une amende dans la huitaine qui suivait la condamnation devenue exécutoire, l’amende pouvait être remplacée par une servitude pénale subsidiaire pouvant aller jusqu’à 12 mois. Il en est d’ailleurs de même dans le Code pénal de 2017. Il s’agit donc d’une fausse dépénalisation que les professionnels des medias ont vigoureusement dénoncée.
Quid de la répression des délits dans l’actuelle loi sur la presse ?
Aujourd’hui, les choses sont plus claires. En matière de répression des délits de presse, la loi de 2018 stipule qu’il est fait application des dispositions du Code pénal. Mais cela pose un problème. Il se fait que certains faits qui étaient considérés comme des infractions dans les lois antérieures à celle aujourd’hui en vigueur, échappent à la répression car on ne les retrouve nulle part dans l’actuel code pénal. Il s’agit par exemple du respect du droit à la vie privée. Ce droit interdit à tout individu, notamment aux journalises et aux médias de s’immiscer dans la vie des gens sans leur consentement. On peut également citer l’atteinte à la présomption d’innocence, principe selon lequel toute personne qui se voit reprocher une infraction est réputée innocente tant que sa culpabilité n’a pas encore été prouvée et établie par une décision de justice régulière et définitive.
Qu’en est-il au juste ?
Dans l’état actuel des choses, s’immiscer dans la vie privée d’une personne ou la présenter comme coupable avant un jugement définitif ne constitue pas une infraction, en vertu du principe de la légalité des délits et des peines. On peut donc, en toute impunité, piétiner ces droits pourtant garantis par la Constitution et les différents instruments internationaux auxquels le pays est partie.
Il en va de même de la divulgation de l’identité des victimes des viols. La loi de 2013 sanctionnait ce fait par une amende pouvant aller à 6 millions de BIF. Comme l’actuel Code pénal n’en fait nulle mention, ce fait ne constitue pas une infraction et n’est pas donc pas sanctionné pénalement. Même la loi de 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre n’en parle nulle part alors qu’il s’agit de toute évidence d’une violence particulièrement grave à l’endroit des femmes et des hommes, qui en sont victimes.
A mon avis, le législateur pourrait pénaliser ces faits sans que la liberté de la presse soit mise en péril. En retour, la paix et l’harmonie sociale y trouveraient leur compte.
Plus de 200 médias enregistrés au niveau du Conseil national de la communication (CNC). D’après vous, une bonne chose ?
Une bonne chose en soi car cela montre la vitalité du secteur médiatique au Burundi. Surtout, cela témoigne le degré d’évolution de la culture démocratique au Burundi. Mais, une question me taraude : « Parmi ces médias combien sont viables ? Combien peuvent mensuellement s’acquitter de leurs obligations envers leurs employés (salaires, cotisations à l’INSS, couverture des soins santé) ? ». Au regard de tout cela, j’estime que le CNC devrait être plus regardant lorsque vient le moment de délivrer les autorisations d’exercer ou procéder à des inspections régulières. Sinon, le risque est grand que le secteur médiatique soit l’apanage de tous aventuriers qui créent des médias et recrutent des jeunes à la recherche d’un emploi sans pour autant être capables de les rémunérés.
Votre commentaire par rapport à l’imputation dommageable ?
L’imputation dommageable ou diffamation est une infraction qui consiste à imputer ou publier sur une personne déterminée un fait précis de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération. Il s’agit d’une infraction pour laquelle les journalistes sont le plus souvent poursuivis et sanctionnés dans le monde.
En tant que « chien de garde de la société », le journaliste peut parfaitement être poursuivi et condamné quand bien même l’information publiée est vraie.
Sur ce point, le législateur pourrait s’inspirer d’autres législations qui ont institué l’exception ou l’excuse de la vérité. Ce principe reconnaît au journaliste le droit de ne pas être condamné s’il parvient à prouver la vérité de ce qu’il a publié, sauf si cela concerne les faits de la vie privée ou les faits prescrits ou amnistiés. Si l’excuse ou l’exception de la vérité était inscrite dans la future loi sur la presse, je pense que cela permettrait aux professionnels des medias de travailler dans la sérénité, sans craindre d’être à tout moment poursuivis et condamnés au seul motif qu’ils ont mis au grand jour des manquements, pourtant prouvés, à l’instar des détournements des deniers publics.
Propos recueillis par Hervé Mugisha