L’institut géographique du Burundi (IGEBU) a annoncé des fortes pluies dès octobre. Les habitants des zones ont été appelés à se préparer. Mais comment ? Sommes-nous préparés à faire face aux conséquences de ces fortes pluies? Avons-nous tiré des leçons du passé ? Peut-on craindre le pire ? Jean-Marie Sabushimike, géomorphologue et professeur d’universités, fait le point.
L’IGEBU a déjà prévenu qu’il y aura des fortes précipitations. Comment avez-vous accueilli cette annonce ?
Comme expert, il faut rappeler ici que ce n’est pas la première fois qu’il fait cela. Je me rappelle qu’il l’avait fait en 2019 et en 2021. Je me rappelle aussi que ces fortes pluies ont été enregistrées au Burundi, principalement dans la partie occidentale. Et les impacts ont été graves.
Par exemple ?
Citons les inondations de Gatumba. D’une manière générale en commune Mutimbuzi et en mairie de Bujumbura, Rumonge, etc. Même au niveau des plateaux centraux, des dégâts ont été enregistrés. Ces pluies ont provoqué aussi des mouvements de terrain mortels.
On n’oubliera jamais les évènements malheureux des éboulements sur les collines de Nyempundu, dans la commune Mugina, en commune Cibitoke.
S’il advenait que les pluies annoncées aujourd’hui tombent de façon exceptionnelle, avec des quantités qui dépassent largement la moyenne pluviométrique connue dans nos régions, on risque d’assister aux -mêmes évènements climatiques, météorologiques extrêmes.
Ce qui provoquerait des inondations et glissements de terrain. Il est question de savoir les leçons tirées dans la gestion des secours, en fonction des étapes bien connues.
C’est-à-dire ?
Les premières urgences, le déplacement des personnes, leur installation, etc. On peut prévoir comment des personnes pourront être déplacées. Et ce, en fonction de l’expérience du passé.
Concrètement, est-ce que les Burundais ont tiré des leçons de ces évènements antérieurs ?
Je ne le pense pas. Si on a déjà enregistré un déplacement de plus de 50 mille personnes, est-ce qu’on ne peut pas s’attendre à un déplacement de 100 mille personnes ? En matière de risques, il faut maximiser les possibilités de réponses en fonction de l’impact élevé, de la sévérité encore plus élevée.
A Gatumba, les zones inondables continuent à s’élargir car l’occupation du sol connaît une croissance spatiale non contrôlée. Regardez comment le site à haut risque continue à occuper de l’espace dangereux.
Qu’est ce qui a manqué pour que ces zones ne continuent pas à être occupées ?
Il a manqué le courage de prendre une décision de délocaliser carrément ces personnes qui vivent dans des zones ayant été frappées par les inondations à maintes reprises. Et ce, en attendant de probables aménagements plus durables. Sinon, on expose les vies des personnes.
Je regrette de devoir me répéter que la première chose qui nous manque c’est la culture du risque. On sait que ce risque existe mais on ne met pas tous les moyens pour l’appropriation de ce que nous appelons la préparation et la réponse.
A qui la première responsabilité ?
D’abord, cela doit être le rôle de l’Etat. Bien entendu en collaboration avec les citoyens qui sont acteurs et victimes à la fois. Mais, il y a d’autres secteurs très importants comme les organisations de la société civile qui peuvent intervenir efficacement. Au Burundi, on a encore seulement la Croix Rouge qui joue un rôle très important dans l’organisation des secours.
Pour Gatumba, je les ai vus à plusieurs reprises. Mais, il y a d’autres organisations qui peuvent intervenir rapidement. J’ai l’impression que mêmes les agences onusiennes ne sont pas préparées à l’avance.
Comment ?
On attend que la catastrophe arrive et c’est la panique. C’est pourquoi on gère très mal ces situations une fois que la catastrophe se produit. Et là, c’est un problème de préparation et d’organisation de la réponse. On a vu que les potentialités existent. Seulement, nous créons nous-mêmes les contraintes pour ne pas bien organiser ces secours.
Que faire alors, selon vous ?
Evitons d’abord de parler uniquement de catastrophe. Il faut plutôt privilégier les actions préventives. Cela nous permettrait d’entrer dans les objectifs de développement durable en rapport avec le changement climatique.
Quelles sont ces actions ?
Il est important d’identifier le risque dans son étendue. Ensuite, il faut analyser les impacts potentiels. La probabilité est déjà connue. Les conséquences sont à prévoir pour essayer de comprendre à quel niveau la catastrophe serait sévère. Cela nous manque.
Est-ce qu’il n’y a pas confusion entre risques et impacts ?
Je pense qu’à ce niveau-là nous avons encore une fois des difficultés de bien classer les risques des catastrophes conformément aux normes internationales.
Concrètement ?
Les risques naturels sont bien connus. Il y a des risques géologiques tels que les éruptions volcaniques, les tremblements de terres, etc. Les risques climatiques sont la catégorie la plus importante et qui nous préoccupe aujourd’hui. Ils sont classés en fonction des évènements météorologiques extrêmes : sécheresses, inondations, vents violents aigus, etc.
Curieusement, dans les plans de contingences, on constate que l’insécurité alimentaire est considérée comme un risque. Quel risque ? Naturel ? Anthropique ? Non. C’est plutôt une des conséquences des risques météorologiques. Ils peuvent provoquer l’insécurité alimentaire.
En parlant de l’insécurité alimentaire comme risque, c’est vraiment dommage. Cela ne se trouve nulle part dans la classification internationale.
Qu’en est-il du choléra, par exemple ?
Pour le choléra, on parle de risques biologiques qui peuvent être associés au changement climatique. Et ce, à travers ces évènements météorologiques qui entraînent le déplacement massif des populations. Une fois que les gens sont déplacés massivement, suite aux inondations, vous pouvez avoir des risques biologiques, comme le choléra, le VIH Sida, le paludisme, etc. Mais on n’appelle pas cela un risque comme tel.
Le gouvernement prévoit la réhabilitation des sites de SOBEL et Kinyinya pour se préparer aux prochaines fortes pluies. Est-ce suffisant ?
Je ne comprends pas le terme « réhabilitation ». Dans quel sens ? J’aurais aimé qu’on utilise le terme « aménagement ou réaménagement » pour accueillir les déplacés potentiels de Gatumba.
Pourquoi ?
Cela signifie que vous avez un plan d’urgence vous permettant de dire que vous pouvez prévoir un déplacement de personnes en termes de nombre plus ou moins qui se rapprocheraient plus ou moins de la réalité. Et là aussi, c’est quel aménagement ? Puisque le grand problème, ce sont des déplacés qui arrivent dans des endroits sans abris. Vous les amenez dans cet endroit pour qu’ils se débrouillent dans le montage des tentes.
Cela n’est pas vraiment un réaménagement. Il faut d’abord se départir de ces solutions temporelles et envisager la résilience effective pour l’installation durable. Sinon, on va continuer à jouer au yo-yo. Il faut savoir se décider pour prendre des solutions durables.
Mais, à Gatumba, c’était prévu la construction des digues. Mais, rien ne bouge. Qu’est-ce qui s’est passé ?
Je dois vous dire que l’aménagement des digues est une opération qui coûterait très chère. Déjà en termes d’études de faisabilité, il faut rendre disponibles des spécialistes avec des complémentarités rassurantes. Cela peut-être des géologues, des géomorphologues, des climatologues, des hydrologues, des ingénieurs géotechniciens. Il faut qu’ils se mettent ensemble pour prendre une décision, pour aboutir à un résultat durable.
Vous pouvez aménager des digues mais pourront-elles acheminer toutes les eaux de la Rusizi dans le lac Tanganyika. Ces digues seront à quelle hauteur pour maintenir cette quantité dans le lac Tanganyika ?
Bref, c’est une action qui mérite beaucoup d’attention pour qu’on fasse des aménagements cohérents et respectueux de l’environnement.
On parle souvent de la mise en place des plans de contingence. Est-ce qu’il y a des séances d’évaluation?
Un plan de contingence consiste tout simplement à identifier les risques majeurs qui existent dans un pays, à savoir le profil des risques du pays. Il y a des critères d’hiérarchisation.
Lesquels ?
C’est d’abord la probabilité, l’impact, comment ce risque pourrait être classé sévère en cas de crise. Le plan de contingence, c’est l’identification, la hiérarchisation des risques et la manière de gérer ces différentes contingences, c’est-à-dire les risques. Le problème reste de bien les identifier.
N’oublions pas qu’un plan de contingence devrait avoir une durée de vie d’au moins deux ans. C’est un document de planification sectorielle ou multisectorielle. Très souvent on confond le plan de contingence et le plan d’urgence.
Le plan d’urgence doit être uniquement sectoriel. Il n’y a pas de plan d’urgence pour tous les secteurs. Par exemple, on devrait avoir un plan d’urgence inondations au Burundi. Le plan d’urgence sécheresse, c’est différent du plan d’urgence inondations, idem pour le plan d’urgence incendie, médical, etc. Je l’ai déjà dit à plusieurs reprises mais cela passe encore très difficilement.
A voir ce qui se passe dans le pays en matière de prévention et de gestion des catastrophes, est-ce que les pouvoirs publics évaluent à leur juste valeur le danger ?
Oui. Le Burundi a ratifié même des conventions internationales, notamment la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), l’Accord de Paris, la Convention des Nations Unies pour la biodiversité, la Convention des Nations Unies pour les zones humides, etc. Donc, tous les textes internationaux qui concernent le changement climatique.
Au niveau national, il y a des lois qui sont bien écrites. Mais en termes d’exécution, cela devient autre chose. Notamment le code de l’eau.
Comment ?
Ces inondations sont favorisées par quoi ? C’est, entre autres choses, à cause de la violation du code de l’eau. C’est lorsqu’on détruit systématiquement les zones tampons du lac Tanganyika, des rivières, comme Ntahangwa, Kanyosha, etc.
On avait prévu des zones tampons mais aujourd’hui elles n’existent presque plus. Je n’oublierai pas le débat sur Muha. Comment on a détruit sa zone tampon avec les conséquences directes sur son pont en aval, sur l’avenue du Large.
Bref, le Burundi a des bons textes sur la prévention des risques. Seulement, il y a un texte qui nous manque.
Lequel ?
Une loi sur la gestion des catastrophes. On pourrait tout prévoir, y compris les sanctions possibles pour les contrevenants. Il y a une loi sur le plan de prévention des risques. Normalement, chaque commune de la mairie de Bujumbura devrait avoir son plan local de prévention des risques.
Etes-vous inquiets ?
La seule chose qui m’inquiète, c’est de ne pas être capable de tirer des leçons des évènements malheureux du passé. Que cela soit des risques de catastrophes naturelles, technologiques, biologiques, on se réfère au passé et on tire des leçons pour préparer les réponses appropriées à un tel risque déjà bien connu ou attendu.
Il faut avoir le courage de continuer à sensibiliser, à informer, à communiquer, à éduquer la population pour bien se préparer dans la lutte contre les évènements météorologiques majeurs, comme ces fortes pluies attendues. Il faut aujourd’hui un débat ouvert. Mettre en place un panel spécial pour la gestion de cette période annoncée me satisferait.
Propos recueillis par Rénovat Ndabashinze

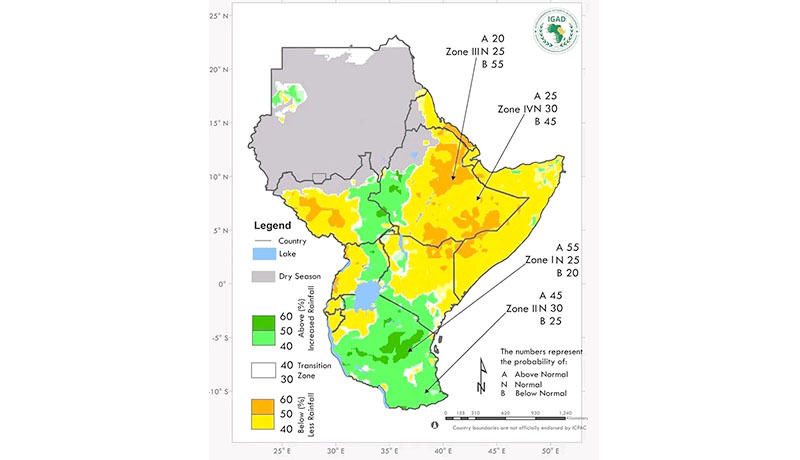



















Bravo, très bonne intervention