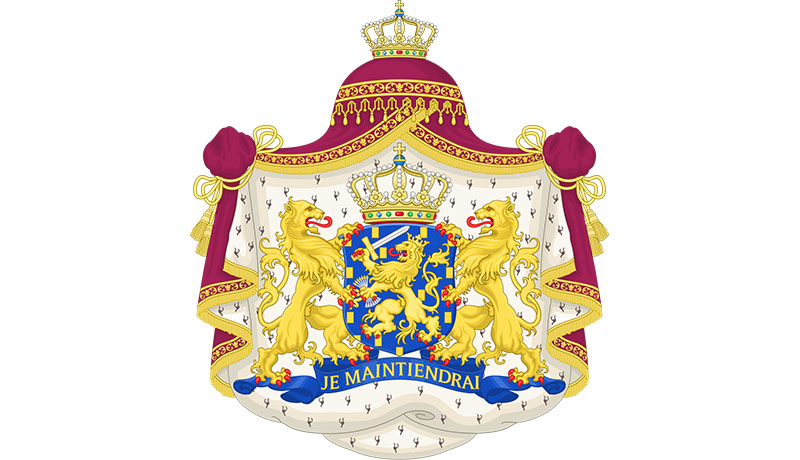Ce mardi, le Burundi a dit adieu à un grand homme : Mgr Jean Louis Nahimana. Brillant, mais très humble et attachant, il laisse un grand vide autour de lui. Mgr Jean-Louis Nahimana avait souhaité laisser un témoignage pour la postérité à travers un livre. Il m’avait fait l’honneur et la confiance de me confier sa parole. Il y a plus d’une année, nous nous sommes retirés pendant une semaine dans un monastère à Freiburg dans le sud de l’Allemagne. Pendant plusieurs jours, il m’a raconté sa vie, depuis son enfance, son parcours sacerdotal, ses différents engagements, ses doutes, ses convictions… Il a évoqué son passage à la tête de la CVR et les défis qu’il a rencontrés. J’ai découvert un homme libre, courageux, profond, attaché à la réconciliation de son pays. En décembre dernier, nous allions nous retrouver à Bruxelles pour avancer encore sur ce beau projet qui lui tenait tant à cœur. Mais il n’a pas pu voyager. En ce moment de deuil, l’heure est à la retenue. Avec la famille, nous verrons la suite à donner à son projet. Je me permets juste de partager quelques extraits où il évoquait son enfance, ses blessures,sa maman qui a élevé ses enfants dans l’amour du pardon. Que sa résilience soit pour nous tous, une inspiration. Repose en paix, Monseigneur, mon ami. Antoine Kaburahe

Pourquoi voulez-vous témoigner, vous savez que vous prenez le risque de vous exposer à la critique ?
Je suis un citoyen, j’aime mon pays. J’ai surtout envie de partager mon expérience à la tête de la CVR. Je pense en toute modestie que mon témoignage peut contribuer à enrichir le débat sur un enjeu crucial pour le Burundi : la recherche de la vérité.
Parlons d’abord de vous. Alors, il semble que vous êtes né en France !
(Rire) Oui, c’est vrai… A Rennes où mon papa faisait ses études de médecine. Il était arrivé en France en 1962. Mon papa appartient à la première génération des médecins burundais, il avait obtenu une bourse pour la France après une formation initiale à Astrida au Rwanda. C’est ainsi que je vais naître en France en 1964. Mais contrairement à mes quatre grandes sœurs aînées qui elles étaient déjà scolarisées, j’ai peu de souvenirs de cette vie en France. Quand en 1967 la famille rentre au pays après les études de notre papa, moi je n’ai que trois ans. Mais c’est un peu drôle, quand j’ai besoin d’un document, un extrait d’acte de naissance par exemple, c’est dans une commune de Rennes que je le demande et sur ma carte d’identité c’est écrit : « Né en France » (Rire) .
Votre famille vient d’où ?
Elle a une histoire un peu compliquée, c’est une famille nomade. Originaire de la région de Gitega, mon grand-père, du nom de Mushahu, était m’a-t-on dit, du clan hutu appelé « Abahanza ». Proche des grandes familles princières, mon grand-père va quitter la région du centre, le Kirimiro, pour s’installer dans le nord, au service grand prince Baranyanka. Homme de confiance, bien introduit à la cour, il est proche du prince. Avec les intrigues courantes à la cour et le danger des empoisonnements, il paraît que c’est même lui qui goûtait les repas du prince. C’est ainsi que mon papa, Nahimana, va naître à la cour du prince à Rabiro, près de Kayanza.
Naître à la cour du prince Baranyanka, un homme puissant, est une situation privilégiée…
Absolument, mon papa va grandir à la cour avec les enfants du prince Baranyanka. Cette proximité avec la famille princière va lui donner la chance d’étudier et même d’aller comme les enfants du prince au Rwanda, à Astrida, une école destinée aux enfants de l’élite de l’époque. Mon papa va s’orienter vers le secteur de la santé. Il obtiendra son diplôme de médecine à Astrida. Il va exercer comme médecin un peu partout au Burundi. Ma famille va le suivre au gré des affectations : Bubanza, Muramvya, etc., jusqu’au départ pour la France en 1962.
En 1967, le docteur Nahimana rentre de France donc.
Papa revient au pays auréolé de son diplôme de médecin obtenu en France, à Rennes. Dès son arrivée, il est affecté à la clinique Prince Louis Rwagasore, à l’époque, l’hôpital le plus prestigieux. Papa est le 3e médecin diplômé burundais. Il est très respecté et choyé par l’Etat . Le pays met à sa disposition une maison de fonction à l’avenue Pierre Ngendandumwe, en face de l’actuel « Jardin public. »
Vous êtes dans les beaux quartiers !
Oui, dans ces temps-là, c’est un quartier huppé. Une belle villa, un quartier chic, papa possède une voiture, une Peugeot 304 je me souviens bien. Nous faisons partie de la petite bourgeoisie aisée de l’époque. Mes grandes sœurs à notre retour de France ne parlent même pas Kirundi. Papa semble promis à un bel avenir. Effectivement, après une année, le docteur Nahimana est nommé médecin-directeur de l’hôpital de Ngozi.
Vous quittez Bujumbura, la capitale, pour Ngozi à l’intérieur du pays, est-ce vraiment une promotion ?
Mais c’est une promotion inouïe ! Pour la première fois, un médecin burundais accède à un poste jusque-là tenu par un médecin blanc, un Belge ! Certes, Ngozi est une petite ville, mais nous sommes toujours des privilégiés, nous appartenons à la haute société. Là aussi, Papa reçoit une grande villa de fonction, à notre disposition nous avons un personnel de maison. Entretemps, papa a troqué sa petite Peugeot 304 contre une puissante Jeep Land Rover. Nous ne manquons de rien. A Ngozi, la famille du médecin est très en vue, nous recevons beaucoup. Je me souviens par exemple que la villa disposait de deux salons : un pour les adultes et un autre pour les enfants.
Comment était votre papa ?
Un homme de principe, droit, strict, très croyant, toujours chic et propre. Mais en même temps très simple. Il lavait lui-même sa voiture. Il menait une vie rangée, allait très peu au cabaret et lisait beaucoup. Une vie apparemment bien réglée, tranquille, jusqu’au 10 octobre 1969.

Qu’est-ce qui se passe cette date ?
Cette date est ma première blessure. Les images me sont restées. Ce soir, des militaires débarquent chez nous. Ils nous disent que « le docteur Nahimana est convoqué par l’administration. » Alors que papa s’apprête à les suivre, maman, un peu inquiète, demande aux militaires d’attendre qu’elle lui apporte un pull. Ngozi est une ville froide. Les militaires lui répondent que ce n’est pas la peine, que cela ne va durer que le temps de lui « poser quelques questions et qu’il va vite rentrer. » Il ne rentrera plus.
(Long silence)
Quel était le climat politique à ce moment-là ?
Un climat très mauvais, pourri à Bujumbura. La capitale bruissait de rumeurs de complots, de coup d’Etat fomenté contre le président Micombero. Plusieurs jeunes officiers hutus rentrés de formation en Europe avaient été arrêtés, condamnés et pendus après des « parodies judiciaires », des procès expéditifs organisés par des cours militaires. Les conjurés n’avaient eu droit à la moindre défense. On ne parle pas beaucoup de cette tragédie, occultée par ce qui s’est passé après, en 1972.
Quel est le lien entre ces événements en cours à Bujumbura avec le docteur Nahimana, votre père ?
Mon papa était médecin, à son poste à Ngozi. Il n’était même pas politique. J’ai cherché, interrogé, j’ai essayé de comprendre, de trouver un quelconque lien avec une éventuelle conjuration, je n’ai rien trouvé. J’ai lu les archives, votre papa, le journaliste Damien Kaburahe dirigeait le journal Ndongozi qui a couvert cette affaire. Nulle part le nom de mon papa n’apparaît. Pourtant, malgré l’absence de la moindre accusation, le docteur Nahimana est condamné à 20 ans de prison.
Excusez-moi, mais vu les circonstances, je suis tenté de dire qu’il a eu la chance ?
Oui, vous avez raison, car les autres personnalités, toutes hutues, accusées de « comploter contre le président Micombero » ont été vite exécutées. Mais les massacres de 1972 commencent alors qu’il est en prison. Il sera « emporté par les événements », comme on disait pudiquement.
Vous avez eu le temps de le revoir avant qu’il soit « emporté » ?
Par deux fois. A la prison de Gitega , puis en soins intensifs à l’hôpital Prince Régent Charles où il avait été admis. Mon papa était diabétique. C’est de là qu’il sera extrait de son lit d’hôpital pour être emmené . On le reverra plus. Je ne sais même pas où son corps a été enterré.
Un choc pour la famille…
Un chef de famille qui part ainsi, du jour au lendemain, c’est épouvantable. Les conséquences ont été directes sur notre vie. D’abord, on ne pouvait plus rester dans la maison de fonction à Ngozi. La villa devait être restituée à l’Etat et notre famille dégager. Maman était femme au foyer. Elle n’avait aucun revenu. Complètement dépassée et démunie elle décide de nous ramener à Bujumbura. Papa avait acheté une maison dans l’actuel quartier Rohero II. Pourtant, même si le quartier Rohero était relativement peu cher, sans aucun revenu, la famille ne pouvait pas tenir. Maman va décider de faire louer la maison familiale de Rohero et de nous installer dans un quartier populaire, plus accessible dans le nord de la capitale. C’est ainsi que la famille du docteur Nahimana va atterrir dans Kamenge.
Une situation qui va bouleverser toute la famille, j’imagine…
En très peu de temps, notre monde s’écroule et notre vie change du tout au tout. A notre retour de France, famille de médecin, nous habitons un quartier chic de Bujumbura. Après son affectation à Ngozi comme médecin-directeur, nous faisons partie de la petite bourgeoisie de campagne. Et voilà que soudainement la famille se retrouve dans une cité populaire, très modeste, Kamenge. Mais heureusement les enfants s’adaptent vite. Le choc, je pense, a été plus dur pour mes grandes sœurs , plus âgées.
Vous voulez dire que, malgré tout, vous allez vous plaire à Kamenge ?
A huit, neuf ans, le petit gamin que je suis se pose peu de questions sur ce que l’on était et ce que nous étions devenus. Tant mieux d’ailleurs. J’ai cette innocence de l’enfant qui se contente juste de vivre, de jouer. C’est plus tard que l’on s’interroge. La cité est un immense terrain de jeu, les gamins gambadent , jouent au football dans la rue. Je découvre un nouveau monde moi qui étais jusque-là habitué à un milieu codifié, bourgeois, une vie confinée entre les clôtures. A Kamenge, les habitations ne sont même pas clôturées (Rire). Les voisins passent allègrement, sans façon, d’une parcelle à l’autre, les femmes font la cuisine sur des braséros fumants posés devant les maisons et s’invectivent à tue-tête de part et d’autre de la rue . Kamenge est un monde ouvert, spontané. Dans cette cité exubérante, je n’ai pas le temps de m’apitoyer sur mon sort. Je vis simplement, je joue, j’apprends le swahili. Les petits de la cité se moquent en effet du « citadin » qui ne parle pas la langue de la cité.
Quid de la population de Kamenge ?
Kamenge était un véritable « cocktail » en termes de population. Il y avait des Burundais, des Congolais, des Rwandais, des Tanzaniens, etc. On y parlait d’ailleurs plus swahili que kirundi. Avec le recul, je pense que maman a eu une bonne idée de nous installer dans ce melting-pot bigarré qui nous a permis de vivre sans être repliés sur nous. Kamenge nous permettait de nous fondre, de nous faire oublier dans ce pays qui nous avait ravis notre papa. La cité nous a aidés à revivre, à noyer, dépasser notre chagrin. Mais malgré notre « chute », maman a gardé la dignité. Surtout, elle n’a jamais transigé sur une chose : les études. Etudier était non négociable. Dans cette cité, beaucoup de gamins n’allaient pas à l’école, ou arrêtaient très tôt pour se lancer dans des petits métiers. Maman a tenu à ce que l’on fasse des études.
Parlons justement de votre mère…
Maman est d’origine rwandaise, c’est une Tutsie de la vieille aristocratie de Butare, l’ancienne « Astrida » où papa a fait ses études. Probablement d’ailleurs qu’ils se sont connus là-bas, je n’ai pas eu la curiosité de chercher. Ma mère aide-accoucheuse de formation a quitté le Rwanda avant les pogroms de 1959 pour s’installer au Burundi, à Ngozi. Elle épousera mon père et ne retournera plus au Rwanda où d’ailleurs une grande partie de sa famille a été massacrée lors de la « révolution sociale » de 1959.
Quelle a été l’ incidence de toutes ces tragédies sur votre maman ?
Les drames ont changé et forgé notre maman. Après l’exécution de notre papa, elle va se métamorphoser quasiment. Jusque-là « l’ épouse du docteur », femme du monde, élégante, elle va changer sa garde-robe. Désormais, elle ne portera que des jupes longues. Elle abandonne les parures, les boucles d’oreille, etc. Elle cesse de mettre les chaussures avec de haut talon… C’est cette femme qui va nous élever dans Kamenge.
Une maman aigrie?

Non, je dirais austère plutôt. Avec le recul, je pense que c’était une manière de se protéger. N’oubliez pas qu’elle se retrouve seule, veuve à 39 ans à peine. N’oubliez pas aussi qu’elle élève huit enfants, dont cinq jeunes filles dans Kamenge. La cité pouvait être un milieu de perdition pour les jeunes filles. J’ai souvenir que dans le voisinage, beaucoup de jeunes filles, à peine pubères, se retrouvaient enceintes. Par cette autorité, cette austérité vestimentaire notamment, je crois qu’elle voulait prêcher par l’exemple une vie stricte, dépouillée. Ma mère était de facto « chef de famille », dans un pays profondément macho, je crois qu’inconsciemment elle voulait s’affirmer aussi.
Et comment vivait-elle la question ethnique, l’assassinat de votre papa par des Tutsis ?
Maman, une Tutsie, a perdu une partie de sa famille dans les pogroms contre les Tutsis de 1959 au Rwanda. 1972 lui a pris son mari hutu, le père de ses huit enfants. Elle a été victime des deux ethnies : les Hutus au Rwanda, les Tutsis au Burundi. Mais je ne l’ai jamais entendu tenir de propos haineux . Je pense que cette double tragédie a donné une autre dimension à notre maman. Un recul, de la hauteur vis-à-vis de la question ethnique. Elle a toujours refusé la globalisation, elle était sensible, ouverte à la souffrance, d’où qu’elle vienne. Mieux, elle a tout fait pour éviter de nous « contaminer ». Ainsi, à ce jour maman a refusé de nous dire la personne derrière l’arrestation de notre papa. A un moment, on voulait savoir qui est venu tirer le docteur Nahimana d’une chambre des soins intensifs à l’hôpital Prince Régent Charles pour cet aller sans retour. Mais elle a refusé de nous dire qui. Je pense qu’elle voulait nous protéger de la haine. Elever ses enfants sans la haine était une forme de dignité, de résistance. Et c’est ainsi que nous n’avons pas grandi dans le ressentiment. En fait, maman a mené un double combat : pour notre survie d’abord et notre éducation, mais aussi en nous préservant de la haine, de la victimisation.
Que voulez-vous dire par « victimisation »
Je ne veux pas juger ou m’exprimer sur la gestion de la douleur, c’est toujours une question personnelle. Je ne veux pas comparer, seulement, je remarque qu’il y a certains qui s’appuient sur les crimes dont ils ont été victimes pour, à leur tour, se montrer revanchards en globalisant. Paradoxalement, ce ne sont pas les personnes qui ont le plus souffert qui sont les plus vindicatives. Je dois dire que nous avons eu la chance d’avoir une maman qui a résisté au ressentiment. Mais cette résistance, je pense qu’elle la doit aussi à sa foi, profonde, solide. Après 1972, je connais des veuves qui sont devenues dépressives, alcooliques. La foi lui a permis de tenir. La foi de ma mère n’était pas résignation, mais espérance, une vertu chrétienne. Et maman a été récompensée. Nous avons grandi sans l’emprise de la haine. Ainsi, alors que notre papa a été tué par des Tutsis, toutes ses filles mariées à des Burundais ont des maris de cette ethnie. Et joie suprême, un de ses garçons, moi, je suis devenu prêtre. Et si je le suis devenu, c’est elle qui m’a inspiré.
Finalement, vivre à Kamenge ne vous a pas anéanti…
Au contraire. Kamenge a été une excellente, une rude école de la vie. Une petite anecdote : pour moi, l’initiation a commencé par des coups. (Rire) Sitôt déménagé à dans cette cité, un soir un groupe de gamins m’a emmené dans un bois soi-disant pour jouer. Arrivé là, je me suis rendu compte que l’on devait se battre en duel. Je me suis battu comme un petit lion, j’avais compris que c’était le seul moyen de me faire accepter. C’était une sorte de baptême. Malgré tout, je crois que beaucoup de jeunes de notre âge mieux nantis, qui n’avaient pas perdu leur papa n’ont pas eu notre parcours. Tous les huit enfants du docteur Nahimana, nous avons fait un bon cursus. La famille compte deux médecins spécialisés dans leurs domaines, un chercheur attaché au Centre Hospitalo Universitaire de Lausanne. Quel meilleur hommage pouvait-on donner à notre papa ? Grâce à la vigilance de maman, nous avons gardé la barre très haut. Nous n’avions plus certainement le prestige d’antan, nous habitions un quartier modeste, mais nous avions l’essentiel : la dignité et l’ambition. Globalement, même si par la force des choses nous nous sommes retrouvés à Kamenge, nous n’avons manqué de rien. Nous avons vécu une expérience inhumaine avec l’assassinat de notre papa, mais après nous avons découvert une humanité édifiante. La situation n’était pas facile et je pense qu’il faut saluer toutes les personnes qui sont restées simplement humaines durant cette barbarie. Certes, par peur de la répression ambiante les gens ne protestaient pas ouvertement, mais, discrètement, des solidarités se mettaient en place. Je vois cela aussi aujourd’hui. Nous avons été très entourés. Des familles amies, des collègues de mon papa, ici je pense aux docteurs Devenge, Sebatigita, et bien d’autres nous ont toujours apporté assistance. Je me rappelle aussi que des condisciples de mon papa à Rennes en France voulaient adopter deux de mes sœurs pour alléger la charge de notre maman, mais elle a refusé. Elle ne voulait pas disperser notre famille. Elle voulait s’occuper elle-même de l’éducation de ses enfants.
Comment avez-vous fait l’école primaire ?
J’ai fréquenté l’école primaire Saint Joseph à Ngagara, puis j’ai été orienté à l’athénée de Bujumbura. J’étais un élève moyen, pas très assidu. Je dois avouer qu’à un moment j’ai même failli décrocher. Je m’interrogeais sur l’utilité de faire des études si c’est pour disparaître comme mon papa. En fait, malgré tout l’encadrement, je pense que sa disparition pesait sur moi. Maman a été très vigilante, très présente, j’ai dépassé cette mauvaise passe.
Qu’est-ce qui a marqué cette vie d’adolescent à l’athénée ?
D’abord, je me souviens du désespoir de ma mère quand j’ai été orienté à l’athénée après l’école primaire. Jusque-là, la plupart des écoles secondaires étaient tenues par l’Eglise catholique. L’athénée était une école publique, laïque, hors du giron de cette Eglise très puissante. Crime de lèse-majesté à l ‘époque pour maman, le cours de religion n’était pas obligatoire à l’athénée, mais optionnel ! Ma mère a tout fait pour me trouver une autre école, notamment le très catholique collège du Saint-Esprit. En vain. Mais moi je me suis beaucoup plu dans ce milieu très ouvert. Certes, le taux d’échec était plus élevé que dans les écoles tenues et encadrées par les prêtres, mais il flottait un air de liberté extraordinaire. A la place du cours de religion, les élèves pouvaient apprendre la morale . C’est au cours de ces années aussi que je vais découvrir le Karaté. Cet art martial va m’aider dans mon édification. Le Karaté, c’est plus qu’un sport, une discipline.
Est-ce qu’inconsciemment il n’y avait pas cette envie de vous protéger ?
Peut-être…A l’époque je ne me suis pas posé cette question, mais j’habitais une cité difficile, j’étais l’aîné des garçons, quatre grandes sœurs, vulnérables, en me lançant dans le Karaté peut être que c’était sans le savoir une réponse à ce besoin d’être un rempart pour ma famille . Je vais pratiquer le Karaté à fond, jusqu’ à la ceinture noire. Cette discipline m’a appris à acquérir et développer la concentration notamment, mais aussi la persévérance. Le Karaté, c’est plus que donner des coups, c’est toute une philosophie.
Quid de l’appel de Dieu ?
Dans le très laïque athénée, je gardais néanmoins ma foi inculquée par ma mère. J’ai le souvenir qu’en 9eme , avec un groupe de jeunes élèves nous sommes allés demander au directeur de l’école, un certain Lazare Naniwe, l’autorisation de célébrer une messe le samedi. Le directeur, lui-même catholique pratiquant a accepté. Nous étions heureux. En seconde, je suis allé participer à une retraite spirituelle à Gitega. Je pense que c’est à ce moment que j’ai eu le déclic. J’ai découvert ma vocation. Je voulais devenir prêtre. Après la première, je vais demander l’entrée au séminaire. Inutile de vous dire la joie de ma mère et du curé de notre paroisse, Saint Joseph. Une nouvelle vie commençait pour moi.
Ce sont quelques extraits du livre qui était en préparation avec Mgr Jean-Louis Nahimana, partagés avec l’accord de la famille que je remercie beaucoup. Je profite de l’occasion pour exprimer ma reconnaissance à la communauté des Sœurs Bénédictines de Sainte Lioba ; monastère de Gunterstall ( sud de l’Allemagne) pour l’ hospitalité offerte durant cette retraite d’écriture avec Mgr Nahimana. Merci au Père Maruhukiro et ses collègues. Ma gratitude va aussi au cameraman Evrard Niyomwungere qui a filmé tous nos entretiens.
Antoine Kaburahe.
Réactions et / ou commentaires
E-mail: [email protected]