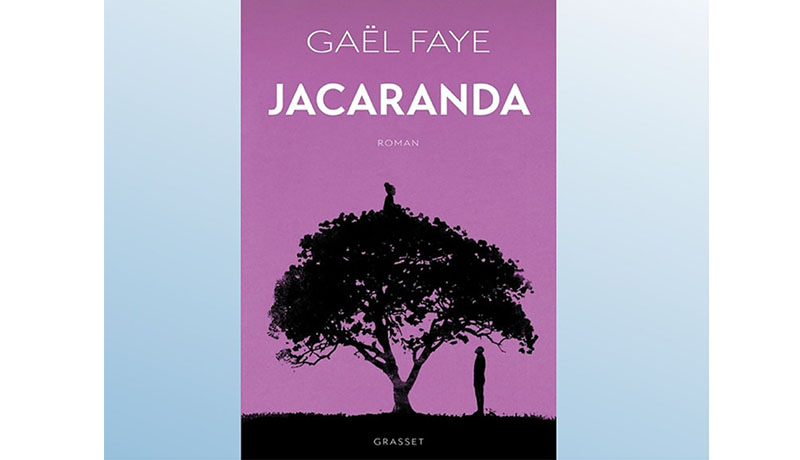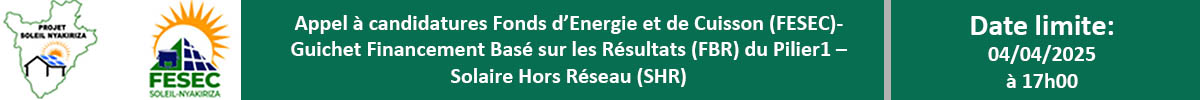A l’occasion du 18ème anniversaire de la Radio Publique Africaine, Iwacu republie un papier du professeur Marie-Soleil Frère. La spécialiste des médias soulignait l’importance de la radio au Burundi. Une analyse toujours d’actualité
Que pensent aujourd’hui ces milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers d’auditeurs burundais qui se trouvent privés des radios indépendantes qu’ils écoutaient chaque jour ? Que pensent ces habitants de Bujumbura, dont le parcours radiophonique hebdomadaire était soigneusement établi : tous les jours à 10h, Kabizi puis le journal parlé sur la RPA, le samedi Kunama sur Isanganiro, le dimanche Tribune Bonesha, et, pour les mieux équipés, à 20h, le journal de Télé Renaissance ? Que pense ce vieux grand-père, croisé sur une colline de Muramvya, qui retirait soigneusement les piles de son transistor après avoir écouté le journal parlé des radios privées, afin de les économiser pour le lendemain ? Que pensent ces jeunes gens qui écoutaient, dans la plus grande intimité, les oreillettes de leur téléphone portable vissées sur les oreilles, les conseils sentimentaux prodigués dans l’émission Nomukura he ? Que pensent tous ceux qui, comme en 2005 et en 2010, attendaient que la Synergie puisse, cette année encore, accompagner leur parcours d’électeur ?
Aujourd’hui, tous sont orphelins (et des orphelins, il y en a déjà tant au Burundi !) : orphelins de l’information. Tous sont orphelins de ces voix qui les ont aidés depuis des années, à avancer dans leur vie de citoyens, retrouvant, clopin-clopant, le chemin de la stabilité, de la normalité, d’une vie sans coups de feu et sans couvre-feu. Orphelins des voix d’Innocent Muhozi, de Domitille Kiramvu, de Jean-Nepo Bironkwa ou d’Olivier Nkengurutse.
S’il est commun de dire que la radio est “le média de l’Afrique”, elle n’occupe pas partout la même place dans la formation des identités collectives et dans les évolutions politiques. De la négociation de l’accord d’Arusha à la victoire électorale du CNDD-FDD en 2005, et jusqu’au matin du 14 mai 2015, où les dernières stations d’information indépendantes se sont tues à Bujumbura, la radio a constitué la fenêtre privilégiée à travers laquelle des millions de Burundais ont pu regarder leur propre histoire, et, pour certains, en être pleinement acteurs.
De tous les pays d’Afrique francophone, le Burundi se démarque par le respect et la gratitude que des dizaines de milliers de citoyens expriment à l’égard des journalistes. “Ils nous aident à comprendre les réalités politiques”, “Ils nous donnent la parole”, “Ils osent poser aux politiciens les questions qui nous préoccupent”, “Ils sont courageux”, “Ils n’ont pas peur d’aborder tous les sujets”, “Ils aiment leur métier”, “Ils disent la vérité”, “Ils parlent au nom du peuple” : autant d’expressions révélatrices collectées auprès d’auditeurs burundais au cours d’une récente enquête sur la perception des journalistes[1].
Et c’est bien cette admiration et cette reconnaissance si particulières qui donnent aux journalistes cette fierté d’accomplir leur métier le mieux possible, qui les poussent à éviter le piège des “per diem” (le journalisme rémunéré) dans lesquels tombent tant de confrères qui exercent leur métier dans le contexte difficile de l’Afrique. Cet engagement et cette volonté de bien faire son travail et, à travers ce travail bien fait, de contribuer à remettre son pays sur la voie de la paix et de la liberté pour tous, ne sont certes pas seulement présents au Burundi ; mais ils y sont particulièrement manifestes.
La mise hors d’état de fonctionner des radios privées a rendu nombre de Burundais orphelins de cette information indépendante et de ces opinions plurielles, mais elle les a également privés de leur propre voix. Tout comme les journalistes se sont tus, leurs auditeurs ont aussi perdu leur vecteur d’expression. “Je n’aime pas les émissions qui ne permettent pas aux auditeurs de participer”, proclamait un enquêté lors de l’étude évoquée plus haut. Et en effet, à travers toute une série de programmes participatifs, les radios privées burundaises ont constitué des tribunes d’expression pour nombre de citoyens à présent réduits au mutisme. Il reste bien sûr les réseaux sociaux, mais qui y accède si ce n’est quelques milliers de citadins suffisamment nantis et équipés pour être connectés ?
Enfin, avec la fermeture des radios, dix millions de Burundais sont aujourd’hui orphelins de leur société civile. Car une société civile qui ne peut pas agir dans l’espace public, y être visible, y faire circuler ses messages, ne peut plus jouer son rôle actif de porteuse des préoccupations des communautés.
Et pourtant, dans cette situation difficile, il faut garder l’espoir et se dire que ces quinze années où le Burundi a été le laboratoire du “journalisme de paix” ont laissé des traces indélébiles qui rendent impossible un retour total en arrière. Même si les radios se sont tues, on voudrait croire que plus rien ne sera jamais comme avant, comme il y a vingt ans quand seule résonnait la voix de la radio nationale. Car aujourd’hui, au Burundi, même le paysan illettré vivant sur sa colline sait ce qu’est le pluralisme de l’information : il sait que les médias peuvent proposer des lectures différentes, voire divergentes (et même conflictuelles), de ce qui se passe dans le pays. Il sait même que ce concert de voix différentes, s’il lui paraît parfois discordant ou menaçant, est le signe d’une vie plus libre et plus démocratique. Voilà pourtant quelque chose qui n’est pas évident à saisir : la contradiction, si elle se joue dans les limites du droit, en particulier du respect de chacun, ne conduit pas forcément au conflit, mais peut évoluer vers un consensus, une coalition, ou une alternance. C’est ce possible que le pluralisme radiophonique a amené aux Burundais depuis 15 ans.
Et c’est ce possible qu’il faut aujourd’hui à tout prix essayer de recréer au Burundi, pour que les voix plurielles des journalistes, des auditeurs et de la société civile puissent à nouveau être entendues, sans menaces et sans peur, et que, pour une fois, chose peu commune dans l’histoire de ce pays, les orphelins retrouvent leurs parents.
Par Marie-Soleil Frère
[1] Etude d’auditoire menée pour l’Institut Panos Paris dans le cadre du projet “Ondes des Grands Lacs” (2011-2012).
Marie-Soleil Frère est Maître de recherche au Fonds national de la Recherche scientifique et chargée de cours à l’Université Libre de Bruxelles. Ses recherches portent sur la place et le rôle des médias dans les évolutions politiques en Afrique francophone. Experte associée durant 10 ans à l’Institut Panos Paris et aujourd’hui membre de l’Institut Panos Grands Lacs, elle s’est impliquée dans la mise en œuvre de nombreux projets d’appui aux médias en Afrique. Elle a publié Presse et Démocratie en Afrique francophone (Paris, Karthala, 2000), Afrique Centrale. Médias et Conflits. Vecteurs de guerre ou acteurs de paix (Bruxelles, Éditions Complexe, 2005) et Elections et médias en Afrique centrale. Voie des urnes, voix de la paix ? (Paris, Karthala, 2009). Depuis 2009, elle enseigne au master spécialisé en Journalisme de l’Université de Bujumbura.
Vingt-cinq ans de liberté médiatique en Afrique francophone
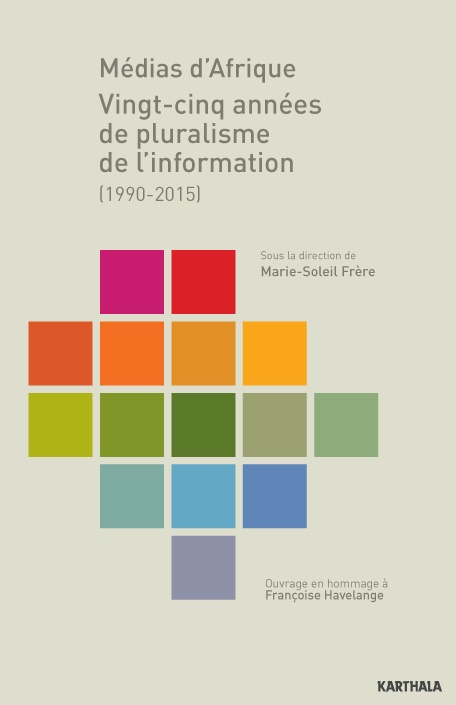 Les éditions Karthala viennent de publier un ouvrage collectif, sous la direction de la chercheuse Marie-Soleil Frère, Maître de recherche au Fonds national de la Recherche scientifique (FNRS) et Professeur de journalisme à l’Université libre de Bruxelles (ULB), qui propose une série de réflexions sur la liberté des médias en Afrique francophone au cours de ces vingt-cinq dernière années.
Les éditions Karthala viennent de publier un ouvrage collectif, sous la direction de la chercheuse Marie-Soleil Frère, Maître de recherche au Fonds national de la Recherche scientifique (FNRS) et Professeur de journalisme à l’Université libre de Bruxelles (ULB), qui propose une série de réflexions sur la liberté des médias en Afrique francophone au cours de ces vingt-cinq dernière années.
Avec les « transitions démocratiques » du début des années 1990, qui ont ramené le pluralisme politique et médiatique en Afrique subsaharienne, les médias « ont connu des transformations spectaculaires, avec l’apparition de milliers de journaux privés, puis de centaines de stations de radio et de télévision. Plus récemment, l’arrivée du téléphone portable et le développement d’Internet ont contribué à bousculer davantage la circulation de l’information. Et le mouvement des « révolutions arabes » a entraîné des mutations dans un certain nombre de pays du nord du continent », indique l’éditeur.
« Médias d’Afrique, 25 années de pluralisme de l’information » propose un ensemble de réflexions d’une quinzaine de spécialistes, universitaires, chercheurs, journalistes ou acteurs du développement des médias. Leurs contributions portent sur la presse écrite, la radio communautaire, les technologies numériques, les médias internationaux, le rôle des médias dans les confits, les processus de paix et les mouvements de contestation politique, les instances de régulation de la communication, la professionnalisation des journalistes… Parmi les contributeurs, Johan Deflander, Tidiane Kassé, Jean-Paul Marthoz, Pierre Martinot, Tristan Mattelart, François Pascal Mbumba Mpanzu, Diana Senghor et Cyprien Ndikumana, fondateur de l’Institut Panos Grands Lacs à Bujumbura.