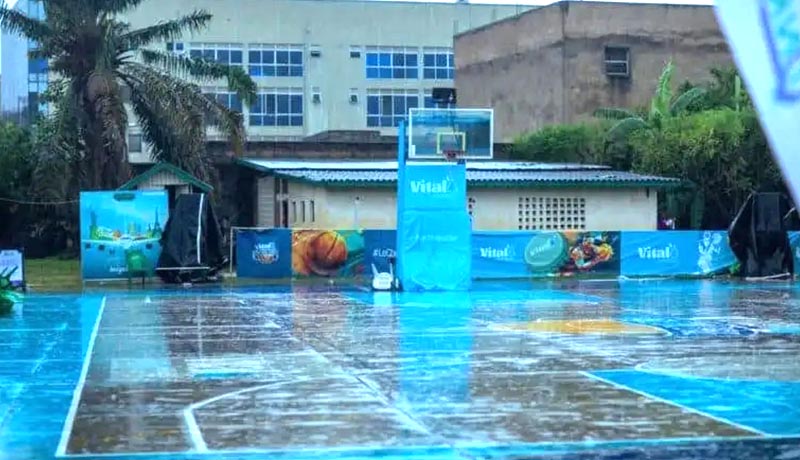Il y a quelques semaines, avec un style et un français délicieux, Roland Rugero nous délivrait pour la nième fois un fond à la fois simple et provocant.
[Il nous parlait d’un «ntaco » qui est tellement omniprésent->www.iwacu-burundi.org/spip.php?article3216], il fait à la fois parti de notre lexique quotidien et d’un code national qui nous tient esclaves du sous-développement … au Burundi.
Tiens, notre voisin nordique – lui qui se fait parler comme modèle pour le développement – lui, il a pu se défaire de ce « ntaco » maléfique. Nous autres, au Sud de l’Akanyaru, comme peuple maudit, continuons à nous bercer dans cet adage médiocre comme quoi {« Umwera uva i bukuru ugakwira hose ! »}. C’est cette dernière partie qui continue à retenir mon attention.
Comme par hasard, il s’est fait que le weekend avant l’apparition du « ntacoisme » en ligne, je me retrouvais sur un terrain de basketball avec un chargé-d’ affaire à l’ambassade du Rwanda à Washington. Il me racontait une histoire qui s’est déroulé très récemment sur Twitter; une histoire dont les acteurs principaux sont le président rwandais et avide utilisateur de Twitter, un rwandais de Floride, et le personnel de l’ambassade rwandaise à Washington.
Le rwandais du Floride avait envoyé un dossier à Washington pour renouveler son passeport. Comme le paquet trainait à faire chemin retour, il appela l’ambassade pour s’enquérir de l’avancement de son dossier. La réponse fut que le particulier rwandais n’avait pas encore payé les frais et envoyé les reçus requis à l’ambassade et que par conséquent son dossier ne pouvait pas avancer. Sûr qu’il s’était acquitté de tous ses dus, le Floridien se mit à contacter le président rwandais sur Twitter pour se plaindre de la lenteur observée dans le traitement de son dossier. La réponse du numéro un rwandais a été immédiate. Il assura le particulier qu’il allait suivre le dossier de près.
Comme le compte @PaulKagame est actualisé en temps réel, le personnel de l’ambassade qui suit religieusement les « tweets » de Son Excellence a reçu le même message. D’un coup, à l’ambassade, il fallait trouver le dossier, il fallait comprendre rapidement qui avait trainé à faire quoi…on rappela le rwandais de Floride. Il leur confirma qu’il avait payé les frais et que si quelqu’un à l’ambassade avait perdu les reçus, cela n’était pas son problème. Le lendemain, le passeport dûment renouvelé se retrouvait dans un courrier express vers la Floride. Quelques jours après, le « tweet » de la Floride lisait « Merci Mr. le Président ». Au Nord, cette pratique s’appelle « accountability »… Chacun doit s’acquitter de ses taches convenablement sinon il y aura des conséquences ! Le chef de l’Etat en reste garant.
C’est dans ce même contexte qu’une autre institution rwandaise, le Rwanda Development Board, une agence rwandaise pour le développement qui est directement sous la tutelle de la présidence de la république, vient de lancer la campagne « Na Yombi », court pour {«Akirana Urugwiro Abakugana Na Maboko Yombi »} — ce qui pourrait être traduit comme « Accueillez tes clients chaleureusement et à bras ouverts ».
Cette campagne qui compte toucher 1 million de Rwandais avant la fin de l’année fait suite à une autre qui avait comme but de renforcer les capacités et d’inculquer la « politesse » et le « sens du service » dans la conduite des affaires à 18.000 employés des secteurs publics et privés.
Je ne suis pas spécialiste sur le Rwanda et ne m’aventurerais même pas à discuter de ce qui est de la politique là-bas (seulement, il se fait que le Rwanda s’invite immanquablement dans chaque discussion sur le développement au Burundi).
Néanmoins, ce que ces deux anecdotes semblent indiquer, c’est que quand M. Rugero m’invite à me demander : « A quel prix cette étape de développement est-elle atteinte [au Rwanda] ? » Ma réponse est que les rwandais ne sont pas allés de « ntaco » au « non-ntaco » directement. – Le schéma semble avoir été : « ntaco » – {« Umwera uva i bukuru ugakwira hose ! »} – « accountability ». Il y a eu et il y existe des efforts explicites et transformationnels engagés depuis le sommet ou « i bukuru ». Cette étape intermédiaire aurait joué un grand rôle. Le changement a été façonné d’ « en-haut ». Et cet exemple rwandais ne serait pas atypique. Il suffit de lire des ouvrages sur les grandes entreprises qui ont pu changer positivement leurs cultures. Bien qu’il y ait une responsabilité de tout en chacun, le leadership au sommet y a toujours été pour quelque chose — quelque chose de décisif.
L’exposé de M. Rugero était éloquent sur le rôle citoyen de chacun dans ce chemin vers le développement (ou changement de mentalités). La sagesse burundaise est d’accord avec lui. Elle qui nous rappelle que {« Wiba uhetse ukigisha uwuri mu mugongo »} ( Vole en portant un enfant dans le dos, et tu lui apprendras à cette même occasion comment voler »). Néanmoins cette même sagesse ne nous a pas seulement enseigné que {« Umwera uva i bukuru ugakwira hose »}, elle nous a de surcroit mis en garde comme quoi «{ Ifi mukubora ihera mu mutwe »} (« Pour pourrir, le poisson commence par la tête »). Il ne faudra pas l’oublier.
Et comme les Burundais restent convaincus qu’ils sont politiquement avancés par rapport à leurs voisins du Nord, il s’en suit que les efforts actuels – appelant la population à une participation active dans la demande de leurs droits et services de la part de leurs gouvernants – sont à saluer. De cette mobilisation populaire, nous arracherons l’accountabilty et des projets concrets d’ « i bukuru » et le reste suivra.