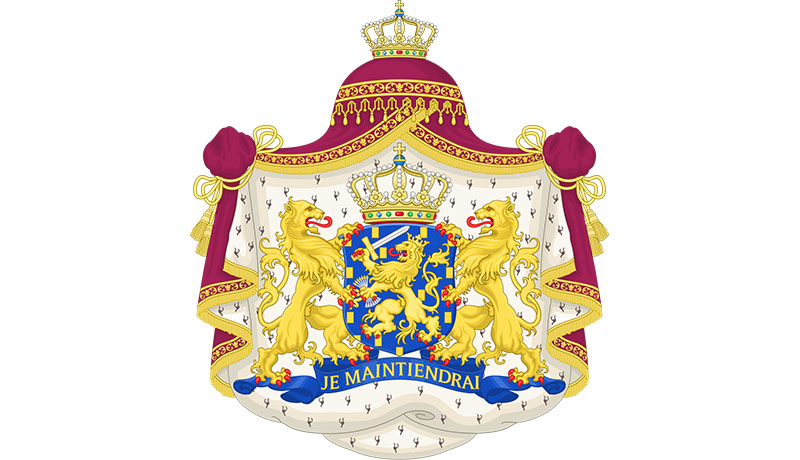Les rideaux sont tombés sur la Journée internationale des droits des femmes et sur les cérémonies riches en couleurs. Les porte-étendards ont rangé leurs banderoles de mobilisation pour la cause féminine, les porte-flambeaux ont mis en veilleuse leur flamme en attendant d’autres journées pareilles.
Du thème choisi cette année, ─ à la mode, un peu réservée pour une certaine classe de privilégiées, le ’’happy few’’ ─, « Un leadership engagé pour une digitalisation innovante en faveur de l’égalité du genre », il ne reste que quelques échos.
Des droits certes, mais futuristes pour certaines braves dames, car étant aux antipodes des tristes réalités du quotidien des milliers de Burundaises ou des préoccupations de ces battantes. Il faut avoir des rêves, des visions, mais il ne faut pas rêver, il faut pour le moment parer au plus pressé.
Il y a des droits les plus élémentaires des femmes bafoués, ignorés, gommés, il y a des abus perpétrés, des violences rapportées qui ne trouvent pas d’échos chez les plus militantes des défenseures acharnées des droits des femmes.
Triste quand des droits des femmes sont violés ou des vies de femmes sont emportées dans un silence assourdissant : pas de prise de position pour protester, pas de communiqué pour condamner ou s’indigner.
Peut-être que cela se fait dans des cadres restreints, privés ou consignés dans des rapports avec mention : « pas au large public ». Non, ce sont des maux absolus à condamner avec la dernière énergie mais les voix sont devenues atones, inaudibles. Il y a mort d’homme, …plutôt de femme. Il faut monter aux créneaux, élever la voix.
Abbas Mbazumutima, Iwacu
Des cas dits de féminicides : Aline, un cas emblématique
Près de 500 personnes se sont réunies ce mardi 7 mars au cimetière de Mpanda où se sont déroulées les obsèques d’Aline Inarukundo, morte dans la nuit de ce 21 janvier dans des circonstances non élucidées.
Un cas dit de féminicide par les proches de cette mère de famille. C’est au moment où des membres de la belle-famille s’y opposent et réclament l’autopsie sur le corps de la victime et la libération de Claude Arakaza, son mari, aujourd’hui mis en examen.

Autour de la tombe, les deux familles se sont assises séparément. Les 4 enfants d’Aline dont un petit d’un an sont avec leurs tantes paternelles. Le bébé commence à s’ennuyer et pleure. Des émotions sont suscitées dans la foule.
Sous cette ambiance morose, la chorale glisse des morceaux des Cantiques. « Continuez de chanter, nous attendons quelqu’un pour commencer », lance le modérateur des cérémonies.
Après plus d’une quarantaine de minutes, une voiture débarque à bord de laquelle un policier à l’avant et deux autres dans les sièges à l’arrière avec au milieu, Claude Arakaza en costume. Sa présence semble gêner quelques-uns dans l’assistance. Certains éclatent en sanglots, d’autres murmurent. Les chants se poursuivent, visiblement pour couvrir les sanglots.
« Perdre Aline, c’est une blessure grave »
Le modérateur a donné le coup d’envoi après l’arrivée de Claude. « Tous les discours seront orientés dans le cadre de remerciements », a-t-il insisté.
Entre-temps, au moment de se recueillir devant la tombe d’Aline, Claude et les enfants sont partis en premier lieu bien sûr. De retour, des femmes l’ont hué et Claude a fondu en larmes jusqu’à perdre les pédales, il a trébuché et ses sœurs l’ont aidé à mieux s’asseoir. Tout autour de lui, des femmes l’essuyaient le cou, la tête, … il était tout en sueur. Elles ont même essuyé ses larmes.
Avec un regard dirigé vers le cercueil d’Aline, le représentant de la belle-famille a souhaité à madame Aline de reposer en paix, d’éclairer ceux qui connaissent la vérité, ceux qui la cache, et d’éclairer ceux qui l’ignorent pour qu’un jour la justice soit rendue à cette disparue.
Quant à la Bancobu, l’employeur d’Aline Inarukundo depuis 2010 ; elle était, selon lui, une employée sociable et courageuse. “ Elle n’a jamais été en retard et elle a toujours fait preuve de retenue”.
Le grand frère d’Aline n’a pas mâché les mots. “Disons qu’elle se repose, la vie n’a pas été facile sur ce bas monde. Nous sommes devenus orphelins étant jeunes. Nous nous sommes occupés de nos frères et sœurs dans une parfaite harmonie. Perdre Aline, c’est une blessure grave. Quand tout le monde m’appelait pour me demander quoi faire, je me retrouvais en train de composer le numéro d’Aline”, regrette-t-il.
Pour lui, pouvoir enterrer sa sœur, c’est comme si elle ressuscitait. « Imaginez ! elle est morte en janvier et nous sommes au mois de mars. Quand nous avons eu l’autorisation de l’inhumer, nous avons poussé un ouf de soulagement. On dirait qu’elle revenait parmi nous ».
Avant de clore son discours, il a plaidé pour le bien-être des enfants. Il a également demandé aux familles de faciliter les uns et les autres l’accès à ces « petits anges ».
Pour rappel, quatre femmes de la commune de Ntega, à Kirundo, deux à Rumonge et une à Kayanza et une autre à Makamba sont mortes depuis janvier de cette année. Elles ont été assassinées par leurs maris ou partenaires.
Jusqu’ici, aucune association militant pour les droits de la femme n’a levé un petit doigt pour s’exprimer sur ces cas de féminicides qui se propagent comme un virus dans le pays. La plupart sont souvent orientées dans les violences sexuelles basées sur le genre.
Dorine Niyungeko, Iwacu
Recrudescence des cas d’homicides conjugaux : l’heure de la levée de boucliers ?
Peur de parler, mouvement associatif faible, impunité… En milieu rural qu’urbain, les victimes des violences sexuelles basée sur le genre ont plus de mal à dénoncer les auteurs.
L’omerta autour de ces violences, souvent commises dans des milieux intimes ou isolés, engendre une sorte de tolérance ou de banalisation de ces actes ignobles.
Le centre Seruka spécialisé dans la prise en charge des victimes de violences sexuelles basées sur le genre recense depuis décembre 2022 jusqu’à fin février 2023, 241 cas de victimes de viols dont 227 sont de la gent féminine, et 185 sont des mineurs.
Dans ce même registre, 38 cas (dont 37 femmes) ont été accueillis par ce centre, après avoir subi des violences physiques, émotionnelles et économiques.
Si l’on était habitué à ce genre de violences à l’égard des femmes, le plus surprenant est que la tendance actuelle frise l’ignominie. Aux tortures, supplices… s’ajoutent désormais des homicides conjugaux dont les femmes sont les seules victimes.
Plus récemment, un reportage mené par notre confrère en commune Ntega de la province Kirundo, faisait état de 5 femmes tuées par leurs maris en une année, dont 4 en seulement deux mois, de décembre 2022 à janvier 2023.
Un phénomène qui tend à se répandre dans d’autres localités des provinces de Kayanza, Rumonge, Bujumbura, … où l’on dénombre plusieurs cas d’homicides conjugaux. Même si les auteurs sont parfois punis, les faits ne semblent pas alerter l’opinion d’une façon générale.
Certes, la justice essaie de jouer son rôle en réprimant les auteurs, mais d’autres actions comme le plaidoyer, des campagnes de communication, des pétitions, marches manifestations, … ne sont-elles pas nécessaires pour condamner ces actes ignobles qui tendent à se normaliser ? Est-ce que l’heure de la levée de boucliers n’a-t-elle pas sonnée ? Sinon, quand ?
Inès Kidasharira : « C’est bon de parler d’un problème qui est là. Mais il faut des solutions »

Influenceuse sur les réseaux sociaux en matière de protection des droits de la femme, Inès Kidasharira a essayé de répondre à nos questions sur le sujet de la recrudescence des cas d’homicides conjugaux.
Nous sommes dans une semaine dédiée aux droits des femmes et il s’observe des cas d’assassinat de femmes dans les différentes localités. Quelle est l’explication que vous donnez à ce phénomène ?
Les explications pour moi sont multiples et à plusieurs dimensions de la question. Primo, c’est la culture burundaise qui encourage, valorise la femme qui sait se taire même quand sa dignité est menacée au sein de son foyer. Cette culture-là est tellement encrée qu’une femme qui ose dénoncer ce qui lui arrive dans son mariage, dans son ménage est vue comme une femme qui n’a pas su faire son mariage, qui n’a pas su garder son mari, qui n’a pas su comment être une bonne femme.
Et ce regard là, ce poids-là de la société ou de la culture, fait que les femmes ont peur de dénoncer ce qui leur arrive, de peur d’être stigmatisée dans la société et d’être traitée comme des déviantes. Si elle ose dénoncer par exemple, la loi va lui dire, ces violences déjà, voilà, c’est constaté, le monsieur on va lui punir.
Alors, c’est quoi la suite ?
La suite généralement et légalement, devrait être le divorce. Personne ne veut divorcer parce que c’est trop lourd, c’est trop de stigmatisation, on n’arrive pas à comprendre qu’il y’a des raisons parfois vitales qui peuvent pousser quelqu’un vraiment à quitter le mariage violent.
L’autre explication peut se trouver au niveau de l’ignorance des lois. Les femmes surtout rurales ne savent pas qu’il y’a des lois qui interdisent, qui protègent contre les violences physiques, morales, être privé de ressources.
Qu’il y’ait des lois qui les protègent. Donc elles ne sont pas au courant et partant ne peuvent pas saisir les instances pour pouvoir jouir de leurs droits.
Et pour celles qui savent, cela pose un autre problème. Si la femme n’a pas accès aux ressources, n’a pas un compte, n’a pas de ressources financières à elle propre, comment est-ce qu’elle va divorcer de quelqu’un qui va, et va porter plainte contre quelqu’un qui pourvoit tout. Cela devient une équation difficile pour ces femmes-là. Elles préfèrent rester et se consolent en se disant, c’est pour les enfants.
Mais le fait de porter plainte contre ton conjoint, même le fait d’être séparé n’influe pas sur la prise en charge des enfants. Parce que les enfants, même séparés, vous avez le devoir en tant que parents de subvenir à leurs besoins.
Et l’autre explication pour moi et qui est triste, c’est le manque d’engagement visible des instances de décision, malheureusement il faut qu’on le dise.
Si une femme, deux femmes, trois femmes sont tuées dans une localité, pour moi c’est inconcevable que le ministre chargé du genre, le ministre de la Justice, le ministère de l’Intérieur ne se lèvent pas pour dire halte à ces violences doivent cesser, prendre des mesures, des positions fortes, décourager ces gens-là, les emprisonner, faire que la justice vraiment soit rendue comme c’est écrit, cela fait de manière je dirais constante, cela va faire que ces violences régressent.
Sinon, quand on voit que l’on peut tuer sa femme et que l’on peut continuer à vivre, ou sans s’en tirer avec une amende et bien cela va continuer à augmenter et notre société ne va pas s’étonner d’aller à la dérive.
Cela c’est un des piliers des valeurs, de l’humain, de respecter la vie de la femme comme on aime le dire « le sang de la femme ne devrait couler que quand elle donne la vie. Seulement dans cette condition ».
Parmi les instances de prise de décision, au sein des associations féminines, il y’a silence radio, comment vous expliquez cela ?
Je pense que les explications sont peut-être politiques de se dire que si on parle « est-ce qu’on va être entendu ou écouté ? Ou elles se disent que peut être on va en parler et puis après ? ».
Parce que c’est bon de parler d’un problème qui est là. Mais c’est aussi bien de pouvoir contribuer dans la résolution d’un problème en offrant des solutions.
Alors peut-être que c’est décourageant pour ces associations-là. Elles se disent « après qu’est-ce qu’on va faire peut-être ?» On ne pourrait pas répondre pour ces associations là mais aussi pour moi, c’est grave et c’est dommage qu’elles se taisent aussi.
Parce que c’est en criant, en lançant des alertes qu’on éveille les consciences, qu’il y’a quelque chose d’anormale qui se passe et qu’on peut aider les instances de prise de décision à se rendre compte qu’il y’a un besoin à tel point, à tel autre pour y répondre de façon adéquate. Parce que les associations sont là aussi pour alerter les instances de prise de décision.
Christian Bigirimana et Adiel Bashirahishize, Jimbere
« Des cas de féminicide deviennent monnaie courante au Burundi, c’est inquiétant ».
Il s’observe ces derniers jours une recrudescence des violences basées sur le genre, allant jusqu’au meurtre des épouses. Très récemment, en commune Ntega de la province Kirundo, au nord du pays, cinq femmes ont été tuées par leurs conjoints entre décembre 2022 et janvier 2023.
Paradoxalement, ces chiffres qui augmentent du jour au jour, semblent passer inaperçus. Pire, une culture de la violence est en train de s’installer, due à l’impunité.

Selon Anne Spés Nishimwe, chargée du plaidoyer au sein de la Concertation des collectifs et associations féminines de la région des Grands-Lacs (COCAFEM), « la meilleure stratégie à adopter pour lutter contre les violences faites aux femmes, est de sensibiliser les couples à propos de la communication non-violente, la bonne cohabitation et d’autres thématiques susceptibles de renforcer l’entente dans le couple ».
Pour cette activiste, c’est l’ignorance de certains couples et la mauvaise préparation à la veille de la fondation du foyer qui pourraient être à l’origine des violences conjugales qui s’observent essentiellement chez les jeunes couples : « Ces cas de féminicides deviennent monnaie courante au Burundi et c’est inquiétant ».
D’où, l’intérêt, dit-elle, de mener des sensibilisations à la masculinité positive et à la bonne cohabitation. « Au sein du COCAFEM, nous menons un combat quotidien afin de changer les mentalités. Petit à petit, nous espérons que dans le futur, on ne parlera plus de violences basées sur le genre ».
Ange-Providence Niyogusabwa, Yaga
Et si on n’attendait pas que ce soit trop tard ?

La dénonciation des violations des droits de la femme ne concerne pas seulement les activistes des droits de la femme. C’est plutôt un devoir de tout citoyen responsable. Cela est d’ailleurs la façon la plus sûre de prévenir les tueries entre conjoints. Tel est le point de vue du sociologue Patrice Saboguheba.
« Les tueries entre conjoints résultent de la dégradation des mœurs », regrette le sociologue Patrice Saboguheba. Pour lui, les conjoints n’arrivent pas à l’étape de s’entretuer en un seul jour. Cela résulte plutôt du cumul des querelles quotidiennes qui se passent malheureusement au vu et au su des voisins. « Mais pourquoi attendre que la mort suive pour se lever enfin et dénoncer ces violences ? »
Selon ce sociologue, lutter contre les violences faites aux femmes ne devrait pas être un devoir des activistes des droits de la femme seulement, car, la plupart des associations de défense des droits de la femme ne fonctionnent que grâce à des financements qui peuvent s’arrêter à tout moment. Non plus ces activistes ne peuvent pas être partout. La lutte contre les violences entre conjoints est plutôt un devoir de tout citoyen responsable.
Une irresponsabilité partagée
M. Saboguheba regrette que ces cas de violences se multiplient en cascade du jour au lendemain. Ce que ce sociologue trouve anormal c’est que les violations des droits de la femme se multiplient exponentiellement au moment où cela était supposé s’arrêter.
Il fait allusion aux médiateurs collinaires et aux différents comités qui s’occupent des questions sociales qui sont actuellement présents sur toutes les collines du pays. Pour M. Saboguheba, si chacun faisait correctement son devoir, sûrement que les violences pourraient être prévenus avant qu’il ne soit trop tard.
Et si on attend que ce soient les activistes des droits de la femme seulement qui dénoncent les cas de violences faites aux femmes, attendons-nous à des enterrements quotidiens des victimes des violences conjugales », fait-il savoir. Il appelle les Burundais à adopter l’habitude de secourir avant que le pire ne se produise.
Florence Inyabuntu, Burundi Eco
Sixte Vigny Nimuraba : “Le rôle de la CNIDH est consultatif en matière des droits humains ”

“Chaque fois qu’il y a des allégations de violation des droits humains, nous menons des enquêtes pour savoir ce qui s’est réellement passé. Notre troisième mandat décrit bien notre rôle consultatif en matière des droits humains”, explique le président de la CNIDH (Commission nationale indépendante des droits de l’Homme), Sixte Vigny Nimuraba sur la question des droits de la femme.
Il ajoute qu’après, la commission analyse la loi et donne des conseils ou orientations au gouvernement ou aux différentes structures de l’Etat pour prendre des décisions nécessaires.
Sixte Vigny Nimuraba déplore qu’il y ait des gens qui infligent des sanctions corporelles, qui torturent ou font du mal aux êtres humains alors que la personne humaine est sacrée.
Dorine Niyungeko, Iwacu