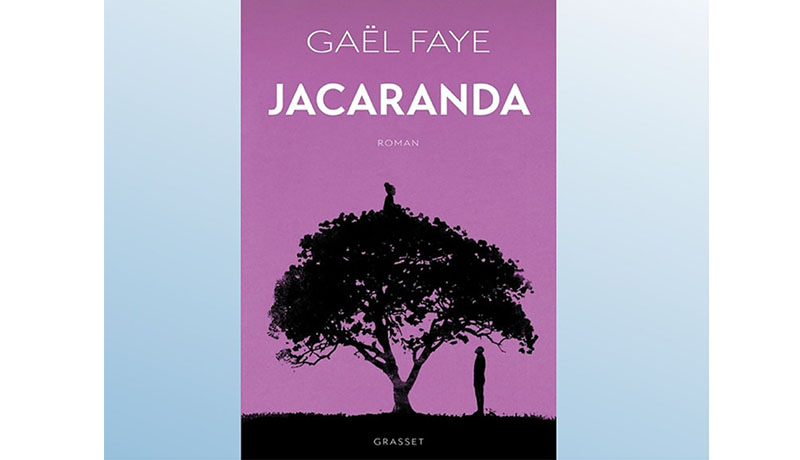… qu’on nous épargne cette potion amère sous forme d’une loi sur les médias qui ne manque rien d’autre que ce que l’on nous reproche justement, à nous journalistes : le bon-sens. Même s’il y a la nécessité de fournir à la presse burundaise les outils d’un changement de fond. Ce long article (car la question est complexe) est spécialement dédié à nos sénateurs, ne fut-ce que pour leur souhaiter une bonne semaine …
Il est temps que le Cndd-Fdd ouvre les yeux et reconnaisse qu’en s’accrochant, jusqu’au vote à l’Assemblée, à ce projet de loi servi pour la toute première fois par la première vice-présidence de la République, il s’est fait rouler comme un bleu jusqu’au cou par l’Uprona. Car désormais, avec l’abstention en bloc des députés upronistes (moins « la brebis gâleuse » Bonaventure Niyoyankana, la majorité présidentielle se retrouve avec, collée au dos, l’ignoble étiquette d’un parti qui « veut tuer la presse libre et indépendante », celle-là même qui participa subrepticement à son accession au pouvoir en 2005.
Initialement, l’idée derrière ce texte était de serrer la vis aux journalistes, de leur faire comprendre que « s’ils ont de la gueule, eh bien !, nous pouvons la fermer avec la loi », dixit une source haut-placée, comme on dit joliment de nos jours… Sauf que les choses ne sont pas aussi simples que ça : nos élus se sont perdus entre le fond et la forme de la chose, embrouillés par un discours de propagande sous-jacent actuel qui veut que la presse burundaise soit purement et simplement de l’opposition.
Et ont donc voté un texte qui manque de bon-sens. Sous trois aspects :
– contrairement aux autres professions libérales (le droit, la médecine, l’architecture, la consultance et même de plus en plus l’art) ((Je note celles qui sont couramment pratiquées au Burundi)), le journalisme est un métier qui repose sur le principe de l’efficacité, sans pour autant que la preuve de celle-ci induise nécessairement la possession d’un diplôme. C’est ce que testent les Directions de Rédaction à travers le monde entier, avant d’intégrer un journaliste : « Dans ce métier, rien ne vaut le terrain, l’expérience et surtout une grande morale » notait un confrère, qui a eu à embaucher des journalistes, et à remercier certains …
Et l’efficacité d’un journaliste englobe son degré de curiosité et sa capacité d’analyse, de synthèse, de contact avec les sources ou son lectorat/auditorat/audimat, de création de réseaux, d’anticipation. Toute une série de qualités qui ne découlent pas d’emblée d’un diplôme (surtout issu de l’actuel système éducatif burundais). S’il n’en tenait qu’à des licences, masters et doctorats pour avoir de bons journalistes, cela se saurait. Même si une formation académique solide permet de partir au déchiffrage de l’actualité avec, {a priori}, de meilleurs outils conceptuels.
– le problème fondamental avec cette nouvelle loi de la presse, c’est qu’elle veut réduire le journalisme burundais au fonctionnariat. C’est à dire l’octroi d’une fonction (symbolisée par la carte de presse délivrée par le CNC) eu égard à ce que l’on prétend pouvoir faire (résumée sur le CV et les diplômes obtenus). Or, il existe une énorme différence entre ce que l’on peut faire, et ce qu’on fait réellement. C’est le paradigme des professions libérales.
Ainsi, les députés ne se sont donc pas posé la question des stagiaires : toute rédaction ((Dans le cas du Burundi, en attendant un organe commun qui délivre la carte de presse)) teste l’efficacité d’un futur journaliste en lui accordant, pendant un délai, du temps pour prouver ses competences. Attention : il n’est pas encore du métier ! Si l’on suit la logique de la nouvelle loi sur la presse, il serait désormais impossible pour une radio ou un journal de passer par cette étape de test avant embauchage, et donc aux rédactions de se renouveler, puisque les stagiaires ne pourraient pas interviewer des administratifs ou des officiels, par exemple …
– Restreindre l’octroi de la carte de presse à un dossier déposé au Conseil National de la Communication est un pas de plus de fonctionnarisation du métier. Sans ajouter le fait que les journalistes seraient désormais assermentés par des membres d’un corps désignés par décret présidentiel … Autant dire une bénédiction bien étrange, alors que la presse a justement vocation à être libre de tout pouvoir institutionnalisé.
Posé ce tableau, qui concerne la forme que l’on veut donner au changement souhaité au niveau de la qualité du contenu de la presse burundaise, passons maintenant au fond.
En tant que lecteur et journaliste, c’est vrai qu’il y a lieu de répertorier une série de « menaces » qui pèsent sur la bonne pratique du métier. J’en dénombre six :
– Le risque de plus en plus présent de politisation du métier : le retrait de l’opposition de la compétition électorale de 2010 a laissé un paysage politique burundais bien dégarni : depuis, le Cndd-Fdd n’a en face que les médias (eux-même composante de la Société civile) comme véritable contre-pouvoir. Le Burundi étant en principe une démocratie à régime parlementaire, l’ADC Ikibiri, en refusant d’entrer au Parlement, a laissé à ses membres le micro comme seule vraie arme pacifique face au rouleau-compresseur cndd-fddien. Ajoutez à cela le manque de courage du FNL pour assurer le leadership de l’opposition, une justice décrite comme étant sous la botte de l’exécutif et un État burundais défaillant côté communication, et vous avez une situation où les médias sont vus et vécus par certains comme l’opposition de fait.
Au lieu de se plaindre auprès d’un député ou de porter une affaire devant les juridictions, on se précipite à la radio pour dénoncer un cas de corruption, une menace, une parcelle que l’on veut extorquer, un crime, etc. Le risque à la longue est que la presse s’identifie finalement (consciemment ou pas) à un corps d’opposition politique, ou tout au moins, se réduise à l’une des tâches du journalisme : la dénonciation. Il est d’ailleurs courant d’entendre, parmi des confrères, certains expliquer leur travail en disant être là pour corriger le pouvoir !
– Le manque de spécialisation des journalistes burundais : la faiblesse structurelle de l’opposition ne saurait faire oublier celle des médias burundais eux-mêmes. La plus grave réside au niveau-même de ses acteurs : la complexité d’un monde globalisé, des enjeux économiques et sécuritaires du développement, de l’intégration sous-régionale ou encore le simple jeu politique interne du pays demandent de plus en plus des journalistes pointus, à l’esprit ouvert à la critique du monde qui les entoure, cultivés, qui lisent, qui ont Internet.
Or, j’ai l’impression que la plupart d’entre nous restons dans l’évènementiel : c’est à dire la description de l’actualité. Reportage d’un incendie, d’un match de football à Ruyigi, le boycott des élections, une grève, une session parlementaire où l’on dormait, la dernière visite du président qui plantait du haricot avec la population d’un coin où la pluie a dernièrement fait des ravages, un atelier de validation d’une étude sur une maladie du manioc, le sacre houleux d’une Miss ou la corruption sur les routes du pays, etc.
Tout cela est fondamentalement important pour notre métier : mais la mise en perspective manque cruellement.
Rarement, un journaliste burundais aborde une question sous l’angle d’une critique large, profonde, avec une remise en question historique. L’exemple le plus frappant pour moi reste la question de la CNTB : comment expliquer la complexité de la question en faisant intervenir au premier plan la direction passée ou présente de l’Uprona ou du Frodebu, et en oubliant que quelque soit la position que ces partis vont prendre, elle sera liée à leur responsabilité dans l’histoire des migrations forcées au Burundi ?
C’est d’ailleurs l’une des raisons fondamentales de la monotonie des différentes éditions du Club de la presse, une émission censée refléter la diversité des opinions au sein du journalisme burundais. Outre un timing inadapté, il est très rare d’y découvrir de véritables débats contradictoires entre collègues : tous nous y avons souvent les mêmes avis, à quelques nuances près (parfois sur des sujets par ailleurs commentés par des acteurs de la vie publique dont nous ne faisons que répéter les propos.)
– La tutelle de la société civile : évidemment, cette situation fait des malheureux (dont une certaine catégorie de la population qui, au fond, ne sait qui croire ou pas) et des heureux : les activistes de la société civile.
Celle-ci a, au fil de l’histoire du Burundi, acquis dans le monde urbain (grand consommateur et « façonneur » du produit médiatique) l’image d’un groupe de personnes qui, « puisqu’ils ne cherchent pas d’intérêts politiques ((L’expression exacte et populaire en kirundi est inyungu za poritike)) veulent nécessairement le bien de tous. » La réalité est, à mon avis, nuancée : en effet, si les activistes de la société civile (à travers l’action associative) concourent à créer une « tension » autour des enjeux de la vie nationale et par là, à porter le débat et l’action politique vers l’intérêt du plus grand nombre, il n’en demeure pas moins qu’ils défendent aussi certains intérêts (ne fut-ce que, de manière psychologique, leur image et prestige dans la société).
Tant que le journaliste burundais ne se sera pas affranchi de la tutelle de l’activiste des droits de l’homme qui doit impérativement lui faire son analyse de la situation pour qu’un article sur la sécurité à Kabezi paraisse, et bien, la presse ne sera jamais totalement indépendante. On entre dans un cycle où les médias ont besoin de la société civile pour apporter le regard critique qu’ils sont difficilement capables de fournir, contre la pérennisation d’un certain mode de pensée qui, à la longue, devient malheureusement politiquement marquée.
Je précise (cela n’est jamais de trop dans notre cher pays et sur ce sujet) : la présence de la société civile est fondamentale dans la construction et la vie d’une démocratie. Irremplaçable. Et c’est justement parce qu’elle revêt un caractère chimérique, qui fait sa force et sa faiblesse comme on le rappelle au département de sociologie de l’Université d’Ottawa ((Lire THÉRIAULT, J. Y, La société civile ou la chimère insaisissable. Essai de sociologie politique, 1985)) que le journalisme, considéré clairement dans le cas burundais comme un quatrième pouvoir, doit voir autant sur elle que sur les autres composantes du pouvoir un regard et souvent une expertise indépendante.
A la veille de l’extraction du nickel, de l’arrivée du chemin de fer et de la fibre optique, avec l’intégration du Burundi dans un espace anglo-saxon (EAC), nous avons besoin des journalistes-économistes, des journalistes spécialisés dans les questions minières, environnementaux, maîtrisant l’anglais, en non dépendant d’une association pour la défense du nickel, ou d’une Coalition des amoureux du train au Burundi, etc pour raconter l’actualité dans ces domaines.
C’est à ce seul repère que l’on dira que nous avons une presse réellement indépendante, capable de penser d’elle-même. Un responsable du master en journalisme en Belgique rappelait, il y a peu à Bujumbura, que l’enjeu pour le journalisme n’est pas de plaire, de critiquer, de persuader, ni de légitimer …
– Une politisation extrême de l’actualité : sans briser le secret de la Rédaction, en 2010 le journal Iwacu proposait un numéro plongeant au cœur de la hausse des prix au Burundi. Une dizaine de journalistes mobilisés, le reste de l’actualité mise au banc de touche, etc. Le numéro fut pourtant un flop commercial, alors qu’il touchait l’essentiel des ménages : leurs bourses. Pourtant, avec « 1972 », « Rwasa » ou « les équipées entre Upronistes », les ventes furent assurées. La question qui s’est posée ici est de savoir si la presse est derrière la société ou si elle est devant elle, appelée à l’éclairer.
Dans le premier cas, nous aurons toujours des bulletins d’informations et des journaux commençant par l’énième assassinat quelque part à Rumonge, la énième déclaration de Manassé qui n’hésite plus, d’ailleurs, à se dédire frontalement (de toutes les façons, la population a besoin de sensationnel), l’énième fait sordide à Gatumba, le dernier scandale à la Mairie, etc. Nous titrerons seulement en fonction de l’émotion que peut susciter tel bulletin radio, tel article à la Une. Nous nous plierons à la dure loi du public qui veut du vif, du scandale, du sanglant … Or au Burundi, encore aujourd’hui, c’est ce que peut offrir la politique si on ne veut la regarder que sous cet angle, exactement comme le ferait n’importe quel Burundais dans un cabaret X.
Mais si on veut quitter cet aspect des choses, et proposer un autre regard à la population, si on entend que la presse éclaire l’opinion (et non la suive) pour que celle-ci, le jour des urnes, fasse un choix cohérent, alors on doit être devant elle. Traiter des questions froids, la santé des femmes, l’épineuse problématique des déchets au Burundi, le contexte politique burundais pris dans l’ensemble sous-régional, éduquer l’opinion à demander des comptes, à avoir un esprit civique, à être propre, à avoir une sexualité responsable. Je rêve d’une synergie des médias sur la question de la sexualité dans les écoles burundaises ou sur l’importance de l’assurance au 21ème siècle. Évidemment, cela demande que l’on laisse de côté les joutes politiques (dont on sait souvent l’issue à l’avance, d’ailleurs).
– Un certain « désamour » des chiffres … : l’autre défi de la presse burundaise reste la question des chiffres dans le traitement de l’information. Prenons par exemple la phrase : « Signalons que des voix s’élèvent pour annoncer une nouvelle guerre, suite aux nombreuses parcelles arrachées à leurs possesseurs par la CNTB.» C’est une formulation de l’actualité possible dans la presse burundaise. Mais ce n’est pas un énoncé journalistique, car il ne diffère en rien des propos d’un bistrot burundais quelconque (où plus on entretient le flou dans les propos, notamment par le recours à la rumeur, plus on est sûr de provoquer d’effet sur son auditoire). Le journaliste est celui qui nous dit : « Sur 1000 familles de Rumonge enquêtées, 600 estiment qu’une guerre peut surgir à Bururi suite à 700 cas de parcelles données aux rapatriés par la CNTB. »
L’usage des statistiques et des chiffres réduirait considérablement certaines polémiques vides à de vrais débats de fond. C’est au prix de l’introduction du chiffre dans le quotidien du Burundais qu’on arrachera peu à peu l’opinion aux rumeurs, aux approximations, aux suspiçions qui, toutes, se nourrissent de l’imprécision.
– Notre public change … : le dernier défi pour la presse constitue la société burundaise en elle-même. Les Burundais voyagent de plus en plus : des ménages sont connectés au monde grâce à la télévision numérique, on surfe désormais sur Internet au Burundi (quoique à des pourcentages minimes) et ceux qui s’intéressent au pays nous lisent et nous écoutent des quatre coins du monde sur des smartphones, nous raille ou nous encense sur Facebook …
Nos jeunes partent par centaines et par an vers l’étranger faire leurs études, des citoyens s’investissent dans le commerce et se rendent en Tanzanie, au Rwanda, en Ouganda ou à Dubaï, des réfugiés qui ont vécu des dizaines d’années ailleurs rentrent au Burundi avec des référents culturels autres que burundais, alors que la diaspora s’intéresse de plus en plus au pays, notamment avec des projets d’investissement.
Tout ce public, qui consomme l’information livrée par les médias burundais, est exposé à des types de presse évolués (notamment au niveau de la presse écrite et télévisée). C’est un auditorat/lectorat bien différent du « paysan » burundais qui n’a pas encore vu le Tanganyika, de loin mieux formé, ouvert au monde, curieux, et donc exigeant.
Il suffit de se rendre sur le forum de notre site web pour découvrir des ingénieurs, des docteurs, des journalistes, des étudiants ou de simples citoyens qui, armés de leur culture générale et non contents de lire l’information que nous leur proposons, critiquent notre manière d’écrire et interrogent le contenu de nos papiers.
L’histoire du Burundi dans 5, 10, 30 ans ne peut que renforcer ce changement générationnel de notre public : si nous souhaitons rester à l’avant-garde de la société, alors nous, les journalistes, devons être mieux outillés intellectuellement. C’est la dure loi de la presse. Sinon nous risquons de faire (souvent de manière inconsciente d’ailleurs) la propagande de ceux qui sont en avance sur nous. Et ils existent, parfois sous des formes déguisées.
Pourtant, tirer sur la presse burundaise est facile : ces six points qui menacent de l’intérieur son travail ne sauraient faire oublier le contexte très difficile dans lequel les journalistes évoluent.
– La précarité rend impossible la spécialisation : prenez Thomas, un jeune étudiant qui termine sa licence en économie et qui se lance dans le journalisme économique. Au terme d’un test d’embauche, il est intégré dans une Rédaction X d’une radio privée, avec comme tache le suivi des sujets liés à l’économie du pays.
Premier écueil : l’impossibilité d’avoir un contrat sur plus d’une année. « Aucun médium burundais n’a de visibilité sur plus de 24 mois. Tous sont en permanence en danger de cessation d’activités, parce que dépendant des financements externes », m’expliquait il y a peu Antoine Kaburahe, directeur des publications du Groupe de presse Iwacu. Face à un marché publicitaire locale faible, les responsables des médias vivent dans la hantise de faire tourner leurs boîtes : ils courent derrière les bailleurs de fonds, passent un temps fou à imaginer des stratégies de survie alors qu’ailleurs, le directeur de la rédaction reste collé à l’actualité, travaille en permanence avec les journalistes.
Dans ce contexte, Thomas, qui rêvait de devenir un bon journaliste, découvre qu’il ne pourra jamais avoir de contrat à durée indéterminé. Sa passion se réduit à des questions existentielles : désormais il passe sont temps en essayant de trouver une ONG ou une institution internationale (Bnub, HCR, etc.) plus stable, mieux rémunératrice.
Et dans ces conditions, impossible d’avoir des journalistes spécialisés, car c’est un processus qui demande du temps : « Conséquence : les rédactions recrutent régulièrement pour remplacer ceux qui partent, et les formations de journalistes se répètent à l’infini, et la qualité du travail est toujours à réinventer… », observait Désiré Niyondiko journaliste intermittent à la Radio Isanganiro, dans des réseaux médiatiques des pays des Grands Lacs depuis plus de sept ans.
– Une solide méfiance entre le pouvoir et les médias
Alors, que faire concrètement ?
– avant tout, saluons les initiatives de renforcement des capacités des journalistes (expression un peu barbare, mais signifiant avec exactitude certaines actions en cours, comme le Pacam et le Master en journalisme.
Par ailleurs, certaines rédactions sont clairement engagées dans le douloureux travail de spécialisation, avec des rubriquages, des éditions spéciales, des enquêtes de fond, etc.
– ensuite, si nos élus burundais veulent offrir à la population une belle presse, qu’ils commencent par quelque chose de fort, de positif. Par exemple, une loi statuant sur la non-imposition de l’importation de tout matériel de travail par un organe de presse burundais. Cela incitera implicitement les Rédactions à mieux s’équiper et compensera les fortes amendes appliquées aux délits de presse (que je préfère de loin à l’emprisonnement, autant en termes de dissuasion que de rapport à la liberté d’expression)
– par ailleurs, pour répondre à la question des compétences intellectuelles des journalistes, puisqu’elle semble tant hanter le Parlement burundais : au lieu de vivre tout un débat pour 50 maigres millions de Fbu accordés à la presse (20 médias), qui se traduit par la distribution d’ordinateurs sans garantie de marcher plus d’une année (car sans anti-virus, ni maintenance), procéder autrement. Pour les meilleurs journalistes choisis annuellement et primés sous l’égide du CNC, demander au gouvernement de chercher des bourses d’immersion pour neuf d’entre eux. Et je suis prêt à parier que les bailleurs ne manqueraient pas.
Trois journalistes dans la sous-région, deux en Afrique de l’Ouest et australe et les autres envoyés dans une rédaction en Amérique du Sud, du Nord, en Europe et en Asie. Quatre mois de travail pour chacun d’eux dans des contextes différents, et on aura donné l’essentiel aux rédactions burundaises : la possibilité de voyager et de rencontrer d’autres manières de penser, de raconter le monde.
Et en cinq ans, on est sûr d’avoir créé une dynamique d’auto-changement/évaluation à long terme.
– enfin, puisqu’on nous dit que le Parlement est là notamment pour contrôler l’action du gouvernement, exiger que celui-ci communique mieux sur ses actions, car c’est sur le silence des officiels et les maladresses de leurs propos que se construisent les rumeurs, les intoxications et la désinformation qui polluent la vie de tous … Et ici, il n’y a qu’un seul remède : recruter des professionnels de l’information auprès des institutions, et non se complaire dans le trop-déjà-vu et vulgaire « faveur aux militants. »
Pour rappel (mais est-il nécessaire de le rappeler à nos Honorables ?) : au 21ème Siècle, le succès politique, économique, culturel appartient à ceux qui ont les idées et qui savent les diffuser et les défendre …
Le muscle de notre époque est cérébral.