Au moment où le mal-vivre gagne du terrain, dans les quartiers de Bujumbura, la peur diffuse de l’empoisonnement s’est installée. Les cas se multiplient, alimentant des suspicions généralisées.
Les tradipraticiens voient affluer dans leurs officines des patients convaincus d’avoir été victimes d’un acte malveillant, le sociologue Dr Aloys Toyi alerte sur une « culture de la mort » qui s’enracine dans la société, une réalité inquiétante.
La peur de l’empoisonnement est devenue une obsession. « Mon fils n’a plus d’appétit, il est devenu faible. Je suis venue vérifier s’il n’a pas été empoisonné », confie une mère à la sortie d’un cabinet de tradipraticien.
Ce mercredi 29 janvier, des patients visiblement inquiets accompagnés de membres de leurs familles convergent au centre « Ubuvuzi Kama », situé à Rohero II, pour des consultations. Le centre offre des soins à moindre coût et distribue des médicaments en fonction de l’âge et de l’état de santé des patients.
« La consultation est à 2 000 FBu et les médicaments sont donnés selon l’âge et l’état du malade. Un bébé ne reçoit pas les mêmes médicaments qu’un adulte, et un jeune n’a pas le même traitement qu’un vieillard », explique un tradipraticien du centre interrogé.
Chaque jour, plus de ’’200 patients’’ se rendent au centre Ubuvuzi Kama. Parmi eux, plus de 100 sont diagnostiqués comme étant victimes ’’d’empoisonnement’’. Ceux dont l’état reste préoccupant, mais qui ne sont pas empoisonnés, sont orientés vers l’hôpital pour des examens approfondis.
Les témoignages de la plupart des patients illustrent la peur grandissante de l’empoisonnement. Une mère, venue faire consulter son fils de trois ans, confie : « Mon enfant tousse beaucoup. Normalement, sa grippe ne dure pas plus de trois jours, mais cette fois, sa toux persiste. La nuit, il devient faible. J’ai pensé que c’était peut-être un empoisonnement ».
Une autre patiente, sceptique face à certaines pratiques, raconte son expérience chez un tradipraticien à Kamenge. « Il se met à lécher les mains de ses clients pour établir son diagnostic. Il m’a dit que mon fils a été empoisonné. Mais comme j’ai entendu d’autres personnes douter de lui, je suis venue ici pour la confirmation. Les résultats sont identiques. J’attends d’avoir de l’argent pour acheter le médicament, car les prix ont augmenté de 30 000 à 40 000 FBU suite à une forte demande ».
Ces centres, souvent rudimentaires, ont mis en place un protocole bien rodé : test de dépistage, consultation payante et prescription de traitements à base de plantes dont le coût varie entre 10 000 et 40 000 FBu. Certains y voient un commerce florissant basé sur la peur.
Les tradipraticiens prescrivent des traitements variés, souvent à base de plantes. Une mère de trois enfants témoigne : « Ma première fille perdait l’appétit et dépérissait. Après plusieurs tentatives de soins à l’hôpital, une voisine m’a conseillé un tradipraticien à Kamenge. Il a léché sa main et a vite conclu qu’elle était empoisonnée. Il lui a donné un traitement à base de feuilles séchées. Après trois jours, elle avait retrouvé l’appétit ».
Pour son deuxième enfant, hospitalisé en urgence, elle a également eu recours à un tradipraticien. « Il m’a prescrit des médicaments pharmaceutiques, comme Eno et Peni V. Mon fils a survécu grâce à ce traitement ».
Pour le sociologue Aloys Toyi, il y a de quoi s’inquiéter. Selon lui, l’empoisonnement n’est pas nouveau, mais il prend aujourd’hui une ampleur alarmante. « Ce qui était autrefois un phénomène isolé devient un véritable problème de société », observe-t-il.
Il avance plusieurs raisons. La première est la banalisation de la mort dans le discours social. « Avec le développement de certaines idées sur la démographie et la contraception, on a inconsciemment promu ce que le Pape Jean-Paul II appelait la culture de la mort », estime-t-il.
Ce sociologue indique aussi que l’impunité des violences de masse est un facteur qui accentue l’empoisonnement. « Quand des tueries politiques répétées restent sans conséquence, la vie humaine perd de sa valeur. On tue pour tuer, sans crainte de sanctions », déplore le Dr Aloys Toyi.
Enfin, une hypothèse plus troublante circule : l’existence d’un réseau entre empoisonneurs et guérisseurs. « Certains prétendent que des tradipraticiens envoient leurs propres empoisonneurs pour attirer des patients ou des clients. Mais cela reste à prouver », nuance-t-il.
Face à cette situation, ce sociologue appelle à un changement radical. « Il faut une volonté politique forte pour transformer le discours social et promouvoir une culture de la vie », insiste-t-il.
En attendant, la peur continue de dicter les comportements. L’empoisonnement est devenu une angoisse omniprésente qui façonne le quotidien de la plupart des Burundais.














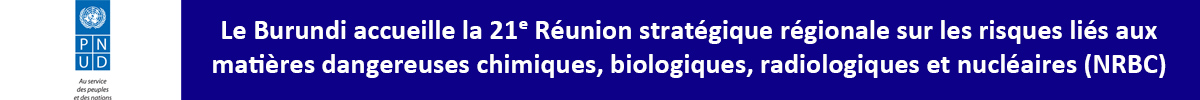


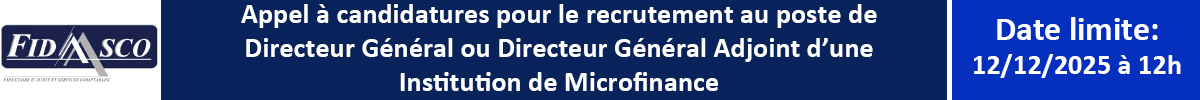






1. Mwanditse muti:« Ceux dont l’état reste préoccupant, mais qui ne sont pas empoisonnés, sont orientés vers l’hôpital pour des examens approfondis… »
2. Ico ndabivuzeko.
Mukirundi bavugako uwuza gukira ingara arayirata kugira ngo imenyekane.
None abo bantu badashoboye kugira des examens profondis umurwayi yobizera gute?