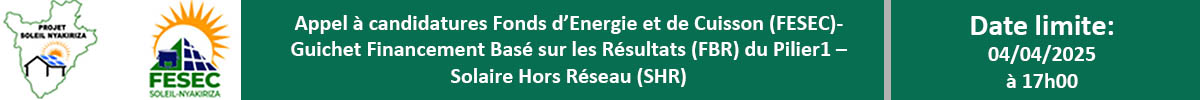Dans le Burundi traditionnel, le soir, au coin du feu, la famille réunie discutait librement. Tout le monde avait droit à la parole et chacun laissait parler son cœur. C’était l’heure des grandes et des petites histoires. Des vérités subtiles ou crues. L’occasion pour les anciens d’enseigner, l’air de rien, la sagesse ancestrale. Mais au coin du feu, les jeunes s’interrogeaient, contestaient, car tout le monde avait droit à la parole. Désormais, toutes les semaines, Iwacu renoue avec la tradition et transmettra, sans filtre, la parole longue ou lapidaire reçue au coin du feu. Cette semaine, au coin du feu, Jean-François Bastin.
Votre plus beau souvenir ?
Avoir atteint le sommet du Mont Meru, 4.566 mètres, avec mon fils et deux guides tanzaniens, à l’aube du 26 mai 2012. Avoir vu le soleil se lever sur le dôme du Kilimandjaro, une émotion inoubliable. L’expérience de la plénitude.
Votre plus triste souvenir ?
La mort de mon père il y a 47 ans et la mort de ma sœur il y a 7 ans.
Quel serait votre plus grand malheur ?
Perdre ma liberté d’action et de pensée, mais cela n’arrivera jamais.
Le plus haut fait de l’histoire burundaise ?
Après mûre réflexion, je choisis l’Accord d’Arusha, signé après des mois de négociations et des années de guerre fratricide. Accord « pour la paix et la réconciliation », qui n’a peut-être jamais été apprécié à sa juste valeur, ni appliqué totalement comme il le méritait. Ce haut fait est donc aussi l’histoire d’une occasion manquée.
La plus belle date de l’histoire burundaise ?
Quoi de plus beau que l’indépendance ? Je choisis donc le 1er juillet 1962, même si la joie n’a pu être complète en ce jour de libération, encore marqué par le deuil, 9 mois après l’assassinat de Rwagasore.
La plus terrible ?
Le 21 octobre 1993, car les tueurs d’un soir n’ont pas seulement assassiné le président et d’autres personnalités, ils ont fait le malheur de tout le peuple burundais, et pour longtemps.
Le métier que vous auriez aimé faire ? Pourquoi ?
Inspecteur de police judiciaire. Je suis un obsessionnel de la vérité, c’est le métier qui va le plus loin dans cette démarche, les recherches peuvent durer 20 ans et plus. Le journalisme est moins tenace.
Votre passe-temps préféré ?
Un puzzle avec mon premier petit-fils.
Votre lieu préféré au Burundi ?
Dès la montée vers Bugarama, on a des vues splendides sur le paysage burundais, je ne m’en lasserai jamais. Mais chaque colline est une petite merveille et j’ai un faible pour Ijenda.
Le pays où vous aimeriez vivre ? Pourquoi ?
J’ai vécu dans 4 pays (Belgique, Congo, Algérie, Burundi), j’ai beaucoup voyagé, je me sens bien partout, et d’abord dans un avion. Si je pouvais (et s’il n’y avait pas le problème de l’empreinte-carbone), j’aimerais vivre partout.
Le voyage que vous aimeriez faire ?
Aller sur la Lune, bien sûr.
Votre rêve de bonheur ?
Être polyglotte.
Votre plat préféré ?
J’adore cuisiner et manger, j’ai des goûts très éclectiques. Au Burundi, j’aime trancher cru un filet de capitaine frais pêché, en fines lamelles que j’assaisonne d’huile d’olive, de jus de citron, de ciboulette et de coriandre. Sans oublier le poivre du moulin que j’emporte partout avec moi, y compris au restaurant.
Votre chanson préférée ?
« Free », de Stevie Wonder, magnifiquement chantée en swahili par Khadja Nin.
Quelle radio écoutez-vous ?
Question cruelle depuis le 13 mai 2015. Au Burundi, pour des raisons professionnelles, j’écoutais jusqu’à cette date toutes les radios généralistes (surtout les bulletins en français) et puis RFI qui est une excellente station. En Belgique, bizarrement, j’écoute France-Inter.
Avez-vous une devise ?
Non. Je n’aime pas les devises, elles sont souvent hypocrites et encore plus souvent trahies…
Votre souvenir du 1er juin 1993 ?
De l’incrédulité et un espoir immense (je suis très naïf). Je me disais que le Burundi pouvait ouvrir la voie d’une démocratisation réussie, être un exemple à suivre pour le Zaïre empêtré dans les soubresauts du mobutisme et pour le Rwanda en guerre depuis 3 ans, au bord du génocide…
Votre définition de l’indépendance ?
La dignité retrouvée, la fin de l’humiliation, pourvu que de nouveaux maîtres ne s’en emparent pas à leur seul profit. L’indépendance est la moindre des choses, pourvu qu’on n’oublie pas son complément : l’interdépendance.
Votre définition de la démocratie ?
Pour faire simple, je dirais : l’Etat de droit. La démocratie est en crise partout, et gravement au Burundi, mais c’est quand on la perd qu’on mesure à quel point elle était précieuse. Le pire, c’est évidemment quand la démocratie est détournée, retournée, brandie alors même qu’elle est trahie, quand elle finit par servir de masque à tous les abus de pouvoir.
Votre définition de la justice ?
Cf. la réponse précédente : la justice est la condition de la démocratie. Au minimum elle doit être la même pour tous, et de préférence plus dure avec les forts qu’avec les faibles. Elle doit donc être incorruptible. Sans elle pas d’Etat de droit, pas de confiance citoyenne, pas de démocratie.
Si vous étiez ministre de l’Information au Burundi, quelles seraient vos priorités ?
Libérer l’audiovisuel public, garantir son indépendance et son pluralisme. Par définition le « service public » ne doit pas être au service du pouvoir mais de toute la nation. Idem pour le CNC ! Et bien sûr restaurer la liberté des médias privés.
Si vous étiez ministre de l’Education, quelles seraient vos deux premières mesures ?
Je ne suis pas spécialiste, mais il me semble que l’enseignement technique et professionnel devrait être développé pour créer de nombreux emplois qui manquent au Burundi.
Croyez-vous à la bonté naturelle de l’homme ?
Non, il n’y a pas de bonté ou de méchanceté innées, naturelles. Ni permanentes ou intangibles d’ailleurs, nous en avons tous fait l’expérience. Mais je crois et même je sais que la confiance, la générosité, la foi en l’autre peuvent transformer des gens et des vies.
Pensez-vous à la mort ?
Oui, normalement, inévitablement. À mon âge, on y est confronté chaque semaine. Je supporte mieux l’idée de ma mort que la réalité de celle des autres. Alors, au Burundi, forcément… Je ne parle pas des massacres, ni des disparitions qui sont une double mort, mais de cette omniprésence du deuil, partiel, définitif, qui occupe une grande place dans la vie sociale. J’aime au Burundi ce face-à-face assumé, partagé, avec la mort.
Si vous comparaissez devant Dieu, que lui direz-vous ?
« Do you speak english » ? S’il me répond « yes I do », peut-être lui poserai-je une seconde question pour le déstabiliser : « Urakomeye » ?
Propos recueillis par Antoine Kaburahe