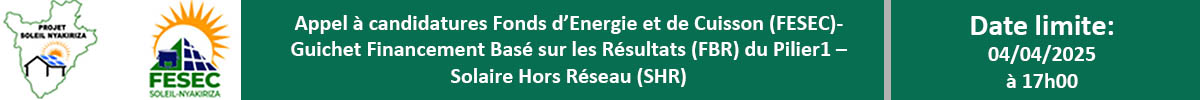Dans le Burundi traditionnel, le soir, au coin du feu, la famille réunie discutait librement. Tout le monde avait droit à la parole et chacun laissait parler son cœur. C’était l’heure des grandes et des petites histoires. Des vérités subtiles ou crues. L’occasion pour les anciens d’enseigner, l’air de rien, la sagesse ancestrale. Mais au coin du feu, les jeunes s’interrogeaient, contestaient, car tout le monde avait droit à la parole. Désormais, toutes les semaines, Iwacu renoue avec la tradition et transmettra, sans filtre, la parole longue ou lapidaire reçue au coin du feu. Cette semaine, au coin du feu, Fabien Cishahayo.
Votre qualité principale ?
La constance. J’ai des amis auxquels je suis attaché depuis plus de 40 ans. Le meilleur compliment que le seul frère qui me reste m’ait donné, c’est que je sais garder précieusement mes amis. À l’université, nous étions trois fils de familles pauvres et il nous arrivait souvent de partager une bouteille de bière (72cl, trois petits verres – nyumbakumi – et puis s’en vont…). Nous appelions ça une larme. Nous partagions cette larme avec beaucoup de joie et, fauchés comme les blés, nous mangions, sans bourse délier …l’odeur de la viande grillée que nous n’avions pas les moyens de nous offrir. J’ai récemment appelé un de ces trois mousquetaires, à l’occasion d’un passage à Bujumbura, et je l’ai invité à mon hôtel pour partager avec sa femme…un ‘’tonneau de bière’’, en souvenir de cette indéfectible amitié…Et de la précieuse larme – akaremve twirashe – que nous partagions à trois. Hein, Laurent Kagimbi ! Cheers !
Votre défaut principal ?
Je confesse un peu d’arrogance. D’intolérance à la médiocrité. Quand j’ai vu par exemple – et c’est arrivé concrètement – des représentants de mon pays sortir en public à Montréal une présentation power point bourrée de fautes, ça m’a révolté, ça m’a révulsé. Je me suis senti blessé dans la blessure que cette désinvolture infligeait à l’image de mon pays.
La qualité que vous préférez chez les autres ?
La passion. L’engagement pour une cause. J’admire les gens capables de mourir pour des idées. J’admire les gens qui, comme Melchior Ndadaye, savaient – et l’ont dit – que si l’on s’attaquait au système qui gouvernait le Burundi avant eux, ils risquaient leur peau, et qui se sont quand même engagés dans ce combat. Et tout en déplorant la mort des innocents qui a suivi la mort de Melchior Ndadaye, je suis d’autant plus révolté par les fous à lier – ou les débiles profonds – ou les deux ! – qui ont soutenu que Ndadaye avait préparé un génocide avant de mourir. Ce discours inadmissible, qui est une insulte à notre intelligence et un mépris de notre souffrance collective, vise à disculper ceux qui nous ont plongés dans la nuit en assassinant ce Juste parmi les nations. Il y a pire que les assassins : il y a les baveurs qui justifient le meurtre du Juste.
Le défaut que vous ne supportez pas chez les autres ?
La malhonnêteté intellectuelle et la fourberie. Les Burundais sont nombreux à pouvoir vous affirmer, sans être daltoniens et en vous regardant dans le blanc des yeux sans sourciller, que le bleu que vous leur montrez n’est pas bleu, mais jaune. C’est cela qui explique la longueur des pourparlers d’Arusha. C’est ce qui rend les négociations interminables (entre minables, comme dirait Alpha Blondy !) chaque fois qu’elles sont engagées, sur quelque enjeu que ce soit. L’intelligence de Bakame, le lièvre, qui consiste à rouler l’autre dans la farine, est considérée chez nous comme un des beaux-arts. Urwenge, akenge, la rouerie, la ruse, est un des traits de l’âme du murundi. Tant que nous valoriserons la fourberie, la duperie, la rouerie, et la ruse, l’akenge en somme, il nous sera difficile d’évoluer, de sortir de l’ornière. Ce trait culturel est ‘’transethnique’’, c’est-à-dire qu’il traverse les lignes de fracture ethnique.
La femme que vous admirez le plus ?
À part ma femme, qui m’’’endure’’depuis plus de 30 ans, et à qui je rends mille hommages, j’ai beaucoup d’admiration pour Rose Ndayahoze, pour sa résilience, pour sa fidélité à la mémoire de son mari, Martin Ndayahoze et ses compagnons d’infortune. Pour son combat pour la justice. Pour la constance de son engagement. Pour les risques qu’elle a pris afin de devenir et de rester cette passeuse de mémoire qui, pendant des décennies, a travaillé à rendre dicible le génocide de 1972, le premier génocide de l’Afrique des Grands Lacs, en vue d’éviter que l’histoire bégaie. Malheureusement elle ne fut pas entendue et nous avons vu, une fois de plus, une fois de trop, notre terre natale, l’Afrique interlacustre couverte par le sang des innocents, pendant cette décennie terrible des années 1990. J’ai dit à Bruxelles et Anvers en mai 2017 que je l’assimile à ces prêtresses de la déesse romaine Vesta, déesse du foyer domestique et public. Les vestales, gardiennes de la mémoire, entretenaient le feu sacré dans le forum, l’enceinte du temple de Vesta, afin d’assurer la pérennité de l’empire romain.
L’homme que vous admirez le plus ?
Frantz Fanon, médecin psychiatre et écrivain (1925-1961), il est né français (de Martinique) et il est mort algérien. C’est dommage que la pensée lumineuse et le verbe volcanique de cet homme ne soient pas plus connus et surtout enseignés aux jeunes générations africaines. On connaît Fanon beaucoup plus dans les universités américaines que sur les campus africains. Engagé à 17 ans pour défendre la France à genoux devant l’occupant allemand, il s’engagera avec la même sincérité dans le combat contre la France, pour l’indépendance de l’Algérie, parce que cette fois-ci, c’est l’Algérie qui ployait sous le joug français : “Chaque fois qu’un homme a fait triompher la dignité de l’esprit, chaque fois qu’un homme a dit non à une tentative d’asservissement de son semblable, je me suis senti solidaire de son acte.” Fanon a fait le lien entre l’Algérie et l’Afrique, mais sa pensée va bien au-delà du contexte algérien et de la conjoncture de la lutte contre la colonisation française.
Qui aimeriez-vous être ?

Un passeur de culture comme Aimé Césaire. Un homme de culture qui assume ses responsabilités sociales, qui agit comme le levain dans la pâte humaine. Le sel de la terre. Mais je suis fier d’être aussi un professeur apprécié de ses étudiants et un conférencier apprécié de ses auditoires. ‘’Enseigner, disait Michel de Montaigne, ce n’est pas remplir un vase, c’est allumer un feu’’. Je suis fier d’avoir allumé des feux, d’avoir inculqué à des centaines, voire des milliers d’étudiants, burundais et canadiens, la passion du savoir, le goût d’apprendre.
Votre plus beau souvenir ?
J’en ai beaucoup, certains liés à la vie professionnelle, d’autres à ma vie personnelle. Sur le plan professionnel, je me souviens avec émotion du jour ou un grand blond, jeune candidat officier des Forces armées canadiennes, s’est levée un matin, au début d’un cours de français langue seconde, sur une base militaire canadienne et m’a dit : ‘’Monsieur, on vous aime beaucoup. On vient dans votre cours comme si on allait manger des bonbons’’. Pour quelqu’un qui essayait de leur enfoncer en travers de la gorge les règles de la grammaire française, dont nous savons qu’elle est rébarbative, qu’elle a un caractère difficile, c’était un compliment qui valait tous les salaires, qui valait son pesant d’or.
Sur le plan personnel, paradoxalement, ce n’est pas la date de la soutenance de ma thèse qui est mon meilleur souvenir. C’est quand j’ai réussi le concours national d’accès à l’enseignement secondaire. Ce verrou était terrible, difficile à faire sauter. Quand j’ai appris que j’avais réussi, j’avais envie d’embrasser l’humanité entière avec mes petits bras d’enfant !
Votre plus triste souvenir ?
La nouvelle de la mort de mon père, fusillé par un soldat inconnu d’une institution cependant bien connue. C’était le 28 octobre 1993. Quelqu’un avait dû l’envoyer en mission. On a prétendu que ces militaires intervenaient pour protéger les tutsis victimes de la vendetta des hutus après la mort de Ndadaye. Je ne connais pas de nom de tutsi mort chez nous après la mort de Ndadaye. Deux jours après, mon petit frère mourait dans les mêmes conditions, avec des dizaines de compagnons d’infortune. Ce crime est resté impuni. Mais ceux qui ont guidé les militaires vers nos familles nous sont bien connus.
Quel serait votre plus grand malheur ?
Vieillir seul. J’aime être entouré, par les miens et par mes amis. Vieillir dans la solitude serait le plus terrible des malheurs. J’aime recevoir chez moi autour d’une bonne table, d’un bon vin rouge, et le concert que j’aime le plus, c’est celui de nos éclats de rire qui me comble de bonheur.
Le plus haut fait de l’histoire burundaise ?
C’est évidemment la lutte contre la domination étrangère sous Mwezi Gisabo, la solidarité des Burundais contre l’ennemi commun, les sacrifices consentis en commun pour préserver la souveraineté nationale. Les valeurs des Burundais de l’époque devraient être enseignées aux générations actuelles pour les inspirer dans leurs propres combats.
La plus belle date de l’histoire burundaise ?
Le recouvrement de l’indépendance nationale, le 1er juillet 1962, après la longue parenthèse coloniale. Mais cette date fut précédée par un élan de solidarité inédit, une union sacrée entre tous les fils et toutes les filles de cette nation. Petits et grands, hutus, tutsis, twa, tous ont conspiré pour qu’advienne la lumière, pour que cesse la longue nuit coloniale. Il faudrait retrouver ce temps fabuleux où tout un peuple a conspiré ensemble contre l’oppression. Il faudrait rallumer la flamme de ces héros.
La plus terrible ?
C’est assurément le 21 octobre 1993. Cette nuit fatidique, des écervelés nous ont fait perdre une chance historique d’opérer au Burundi ce qu’on a appelé au Québec dans les années 1960 une révolution tranquille, une révolution sans bain de sang, sans tête qui tombe. Ils ont ouvert les portes de l’Apocalypse pour aussitôt proclamer, comme dans le titre d’un roman québécois – C’est pas moi je le jure ! Depuis, personne n’a été condamné pour ce qui nous apparaît a posteriori, faute de jugement, comme un crime parfait, dont nous faisons collectivement les frais.
Le métier que vous auriez aimé faire ?
Architecte. L’architecte situe son œuvre au carrefour des sciences humaines et des sciences de l’ingénieur. Il est scientifique et artiste en même temps. Il combine ce que Blaise Pascal appelait l’esprit de finesse et ce que le même penseur appelait l’esprit de géométrie. L’esprit de finesse – l’intuition – préside à la création artistique ; et l’esprit de géométrie, la pensée rationnelle, rigoureuse, est à l’origine de l’innovation et de l’invention scientifiques. Michel Ange et Blaise Pascal avaient les deux dons. Je suis en admiration devant les architectes.
Votre passe-temps préféré ?
La lecture des classiques et l’écoute des films radiophoniques. J’adore aussi les voyages qui, soit dit en passant, ne forment pas seulement la jeunesse. De toute façon, entre 7 et 77 ans, on est jeune, comme disait le poète. Je fais aussi du jardinage l’été, et je me prends pour un artiste en montrant fièrement les aménagements floraux que je fais autour de ma maison, pendant la petite fenêtre de soleil soustraite aux rigueurs de l’hiver canadien.
Votre lieu préféré au Burundi ?
La plaine de l’Imbo, autour du lac Tanganyika. Avec un ami, j’ai passé des week-ends mémorables à Mutumba pendant mes études de premier cycle universitaire. Je me souviens avec émotion de la vue imprenable sur le lac Tanganyika, à partir des hauteurs de Mutumba. Et surtout des couchers de soleil sur le lac. Sublime !
Le pays où vous aimeriez vivre ?

C’est assurément la Suisse. Chaque fois que je la visite, je vois l’image de l’invitation au voyage du poète Charles Pierre Baudelaire : en Suisse ‘’tout est ordre et beauté, luxe, calme et volupté’’. La Suisse rappelle aussi le Burundi par ses paysages magnifiques. Elle est l’image de ce que pourrait devenir mon pays si la bonne gouvernance était patiemment, laborieusement installée dans l’ADN national, à la faveur d’une heureuse mutation génétique. Rêvons, c’est gratuit !
On raconte aussi que les piétons suisses s’arrêtent au feu rouge, même à 3h du matin, quand il n’y a pas de circulation automobile. La rigueur, la discipline, au niveau personnel et au niveau collectif, c’est peut-être le cœur de l’évangile du développement humain selon Guillaume Tell, le héros légendaire au cœur de la mythologie fondatrice de la confédération helvétique.
Le voyage que vous aimeriez faire ?
La Chine. Quelque chose se réinvente dans ce pays immense et populeux, qui parvient à nourrir près d’un milliard et demi de personnes, ce qui est en soi un miracle. La Chine s’est assoupie sous les coups de boutoir des dominations coloniales, surtout de la domination anglaise et de ses guerres imposées. Alain Peyrefitte écrivait en 1973 Quand la Chine s’éveillera…le monde tremblera. Cet éveil est en train d’arriver. J’aimerais voir de mes yeux comment ce géant assoupi est en train de redécouvrir sa vocation naturelle : comme l’Albatros de Baudelaire qui se déferait de ses entraves, il reprend son envol. Il déploie ses ailes de géant. Mais en même temps, l’ombre de l’albatros chinois plane sur l’Afrique. Nous devrions comprendre le nid d’où l’oiseau géant s’envole vers les hauteurs pour l’imiter, briser nos chaînes et prendre nous-mêmes notre envol. Et surtout éviter d’être des variables d’ajustement dans la nouvelle économie mondiale, en fournissant à l’ogre chinois – l’atelier du monde – les matières premières dont il a besoin, sans nous-mêmes tirer parti de la nouvelle donne de l’économie mondiale, dont ce pays est devenu le centre de gravité.
Votre rêve de bonheur ?
Le retour au pays natal. Une retraite paisible dans un pays natal pacifié, dans une villa surplombant le lac Tanganyika. Un réveil le matin, avec café et croissant, en regardant ce lac magnifique. Loin de la neige et du brouhaha des villes.
Votre plat préféré ?
La brochette de chèvre accompagnée de bananes. Imbattable ! Mais j’adore aussi la salade grecque, la soupe thaïlandaise Tom Yum, dont je suis devenu spécialiste, le poulet grillé à la portugaise accompagné d’un bon vin rouge.
Votre chanson préférée ?
Je t’aime la vie, de Nana Mouskouri (je suis un peu vieux jeu !). La poésie de cette chanson et sa mélodie me comblent de bonheur.
Je t’aime la vie/Jusqu’à la folie/Jusqu’à la folie/Je t’aime en priant/Comme une enfant/Je t’aime la vie/Je t’aime d’amour/Dans les incendies/Des plaisirs trop courts.
Quelle radio écoutez-vous ?
J’écoute Radio-Canada (surtout quand je conduis). J’écoute RFI, la BBC et la VOA. J’écoute aussi souvent votre web radio.
Avez-vous une devise ?
Fais ce que dois et laisse (les ânes) braire.
Votre souvenir du 1er juin 1993 ?
Afrique adieu de Michel Sardou. Les paroles inoubliables de cette chanson, où Sardou parle des eaux bleues du Tanganyika, me sont venues à l’esprit : ‘’C’est tout un peuple fou qui danse comme s’il allait mourir de joie.’’ Des hommes et des femmes de bonne volonté ont mené une lutte politique avec pour seules armes des faits, des arguments, des promesses ‘’réalistes’’ pour tourner les pages les plus sanglantes de l’histoire nationale. Ils ont gagné non seulement les élections, mais aussi les cœurs et les esprits de millions de burundais épris de paix, de toutes les ethnies. Cela fait un quart de siècle, mais je me souviens de ce moment comme si c’était hier. C’était, comme dirait un spécialiste des mythes, Mircea Eliade, le temps fabuleux des commencements, le temps du rêve. Puis est venu le cauchemar…
Votre définition de l’indépendance ?
La responsabilité. L’indépendance, pour les individus et pour les peuples, c’est la possibilité de répondre de ses actes et non d’en faire porter le blâme à quelqu’un d’autre. L’indépendance, c’est la possibilité de kugira aho uramutswa – d’être maître chez soi. Mais cela implique aussi de prendre soin de soi – pour l’individu – et pour les peuples. Gushinga icumu mu mashinga, se faire entendre, faire entendre sa voix singulière dans le concert des nations, mais cela implique aussi de faire bonne figure, de ne pas perdre la face. Nul ne peut prendre au sérieux l’indépendance d’un individu qui porte des haillons. Umuntu agirwa n’agashambara. Un pays ne peut pas (pro)clamer son indépendance, (pro)clamer sa dignité, s’il garde la main tendue vers les autres pour assurer ses besoins les plus élémentaires. Ubuntu burihabwa.
Votre définition de la démocratie ?
Celle que l’on prête à Abraham Lincoln : le gouvernement du peuple pour le peuple et par le peuple. Ce peuple ne doit pas forcément être instruit : ceux qui ont balancé des sacs de thé à la mer à Boston en 1773 pour signifier aux Britanniques qu’ils voulaient être maîtres chez eux n’avaient pas de doctorats, de licences ou de maîtrises. Mais ils savaient qu’ils écrivaient l’histoire. En refusant la domination, analphabètes mais pas bêtes, ils savaient interpréter leur histoire et, dans une certaine mesure, ils savaient que, comme le dirait plus tard Frantz Fanon, ‘’un fruit ne tombe que quand il est mûr. Mais devant les tempêtes et les ouragans de l’histoire, mûr ou pas mûr, il tombe quand même’’. Ici je vais prendre le risque de défendre aussi un point de vue iconoclaste, de sortir des sentiers battus : la protection des minorités est un des traits de la démocratie, et, qu’on le veuille ou non, la démocratie est le seul système capable de protéger les droits des minorités. L’obsession des minorités de garder la mainmise sur les institutions en excluant les majorités ne peut aboutir qu’à des explosions de violence, toujours plus rapprochées, toujours plus apocalyptiques par leur ampleur. L’Afrique du Sud devrait nous servir de leçon.
Votre définition de la justice ?
D’abord la définition de Salomon. L’équité. Le même poids, la même mesure. Le symbolisme de la balance. La justice, je la vois aussi sous la forme de l’égalité devant les opportunités, des discriminations positives, pour corriger l’histoire. Favoriser ceux que l’histoire – l’histoire avec une grande hache comme dirait un auteur, George Perec, a broyés. Favoriser les défavorisés. Évidemment, cela crée des remous. Ceux qui sont favorisés ne lâchent pas leur morceau, pensent que c’est dans leur nature d’être où ils sont, d’occuper les places qu’ils occupent, peu importe que ces injustices fassent le nid des violences systémiques qui, de façon récurrente, mettent le feu à la république. Je vois avec quelle résistance certains s’opposent à ce qu’il y ait les mêmes chances pour tout le monde dans le recrutement au sein des organisations non-gouvernementales étrangères (ONGE). C’est une question de justice. Il n’y a pas d’ethnie par nature plus intelligente qu’une autre, au point que le personnel d’une ONGE se recrute à 100% au sein d’une seule ethnie.
Si vous étiez ministre de l’Information, quelles seraient vos deux premières mesures ?
Ouvrir l’espace médiatique le plus largement possible, à toutes les voix, à toutes les perspectives, pour alimenter le débat citoyen sur les enjeux auxquels notre pays doit faire face (démographie galopante, paupérisation criante de toutes les couches de la population, hygiène, innovation sociale, création de la richesse, etc…). Promouvoir la liberté de la presse, la diversité et la pluralité des perspectives sur la gestion du bien commun, la Res Publica, la chose publique. Mais en même temps, du même souffle, promouvoir la responsabilité de la presse, notamment en instituant une formation minimale obligatoire (une formation de courte durée, à compléter, sous forme de cours du soir, moins d’un an après l’entrée en fonction) pour tous les professionnels des médias non formés en sciences de l’information et de la communication. Y seraient abordées les questions reliées à l’éthique et à la déontologie des médias, à la responsabilité sociale des journalistes et des entreprises médiatiques, à la responsabilité des professionnels du secteur dans la promotion de la paix et de la concorde sociale, au droit de l’information, surtout dans le contexte de la révolution numérique.
Croyez-vous à la bonté humaine ?
Je ne suis pas rousseauiste pour penser avec Jean-Jacques Rousseau que nous naissons naturellement bons et que c’est la société qui nous corrompt. ‘’L’homme naît naturellement bon et heureux, c’est la société qui le corrompt et le rend malheureux’’ écrivait en 1750 Rousseau dans son Discours sur les sciences et les arts. Je ne suis pas non plus machiavélien, pour penser avec Nicolas Machiavel, que nous sommes naturellement mauvais, fourbes, et que les dirigeants doivent recourir à tous les moyens pour diriger la Cité. ‘’ Les temps où nous vivons sont si remplis de méchanceté et de corruption que, sans avoir des yeux de lynx, on aperçoit plus facilement le mal que le bien’’, écrivait l’auteur florentin en 1517.
Nous sommes des anges et des bêtes, comme le voulait le philosophe Blaise Pascal. Je crois que nous sommes capables de faire des choses admirables – c’est notre dimension angélique – et qu’en même temps, en nous sommeille la bête. Il faut créer les conditions pour que ce que nous avons en nous de plus beau s’exprime. Et, comble des paradoxes, même dans les pires moments de l’histoire humaine, ce que l’humain a de plus beau s’exprime. L’histoire d’Oscar Schindler, racontée par Steven Spielberg dans le film célèbre, La liste de Schindler, en est l’illustration. Comme ces belles fleurs qui poussent sur le fumier le plus abject. Mais je fais le même bilan qu’Albert Camus qui écrivait que les moments des grandes tragédies – comme la peste, nous laissent cette leçon magistrale, à savoir qu’il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser.
Pensez-vous à la mort ?
Pas vraiment, même si je sais que, de son côté, elle pense sûrement à moi. Je pense surtout à la vie. À la célébration de la vie. Quelquefois, lors de funérailles, la mort m’interpelle. Me rappelle sa sinistre existence, comme l’ombre portée de la vie. ‘’Un jour nous mourrons’’, disait Brassens. ‘’Je le sais de source sûre’’, ajoutait le poète, un brin taquin. Je sais qu’un jour je mourrai, comme tout le monde, mais j’essaie, de toutes mes forces, de ne penser qu’à la vie. De la célébrer. De la chérir. Savoir qu’elle a une fin me la rend encore plus chère. Après tout – n’ayons pas peur des mots – peu de gens de mon ethnie, ayant mon niveau de formation, ont eu la chance de vivre aussi longtemps que moi. À vrai dire, ils se comptent sur les doigts d’une main. Alors, la cinquantaine souriante, je mords à belles dents dans la vie.
J’ai l’habitude de rappeler à nombre de mes amis que nous avons terminé le temps que l’espérance statistique nous donne dans l’Afrique interlacustre qui nous a vus naître, et que nous sommes en train de jouer les prolongations. Et qui a la chance de jouer aux prolongations a l’obligation de marquer des points. Donc je vis furieusement. Je savoure chaque seconde de ma vie. Et quand la Grande Faucheuse, cette salope intraitable qui me suit pas à pas, viendra me cueillir comme un fruit mûr, je partirai sans regret…..Contrairement au mourant dont parle la fable de Jean de la Fontaine, La mort et le mourant,’’ je sortirai de la vie ainsi que d’un banquet, remerciant mon hôte…’’
Si vous comparaissez devant Dieu, que lui direz-vous ?
Que j’ai essayé, de toutes mes forces, de vivre comme une bonne personne, en faisant le plus de bien possible et le moins de mal possible, même après avoir perdu la foi. Que j’ai douté de lui, mais que j’ai toujours été guidé par une éthique rigoureuse de la responsabilité envers mes semblables, une éthique de l’altérité telle qu’on la trouve dans l’œuvre magistrale du philosophe Emmanuel Levinas. Que chaque fois, le visage d’autrui me renvoyait à ma propre humanité, à ma propre fragilité, avec une sommation : que la dignité de l’autre, de cet autre moi-même –et sa protection, étaient remises entre mes mains, que cet impératif catégorique s’est imposé à moi jusqu’à mon dernier souffle. Et donc qu’en somme, même sans croire à lui, je croyais fermement, profondément, à ma responsabilité envers ceux qu’il a placés sur ma route. Que, à ma façon, avec mes modestes moyens, à ma modeste échelle, j’ai rendu l’humanité meilleure à mon départ que quand je suis arrivé. Et qu’enfin, si vraiment le ciel, cette Auberge du Bon Dieu que chantait Brassens existe, j’y ai bel et bien une place, même après avoir douté de l’existence d’un père céleste et d’une félicité qu’il nous réserverait… de l’autre côté de la vie, de l’autre côté du chemin.