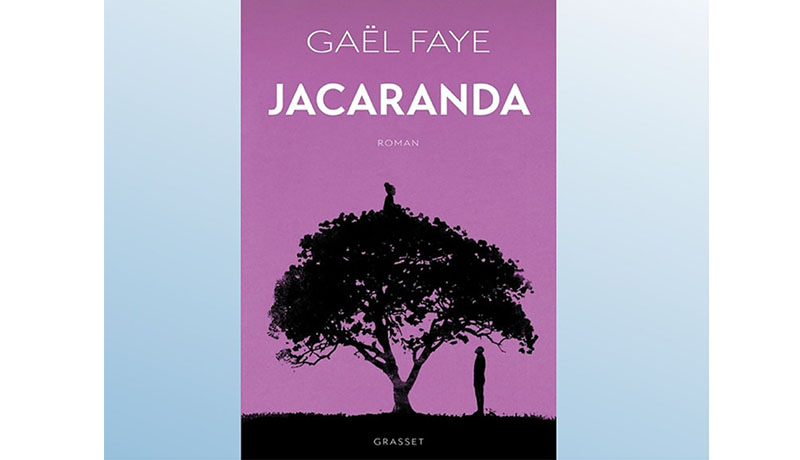Dans le Burundi traditionnel, le soir, au coin du feu, la famille réunie discutait librement. Tout le monde avait droit à la parole et chacun laissait parler son cœur. C’était l’heure des grandes et des petites histoires. Des vérités subtiles ou crues. L’occasion pour les anciens d’enseigner, l’air de rien, la sagesse ancestrale. Mais au coin du feu, les jeunes s’interrogeaient, contestaient, car tout le monde avait droit à la parole. Désormais, toutes les semaines, Iwacu renoue avec la tradition et transmettra, sans filtre, la parole longue ou lapidaire reçue au coin du feu. Cette semaine, au coin du feu, Eric Ndayisaba.
Votre qualité principale ?
Question difficile. Toutefois, je dirais que je suis déterminé. Je poursuis mes objectifs jusqu’au bout sans malheureusement considérer l’ampleur du coût à payer.
Votre défaut principal ?
La naïveté. Je fais trop de confiance au risque de me laisser manipuler.
La qualité que vous préférez chez les autres ?
L’honnêteté. Ce n’est pas toujours facile, car il y a trop de sollicitations.
Le défaut que vous ne supportez pas chez les autres ?
J’essaie de m’ « adapter » à tous ceux qui me sont proches malgré leurs défauts. Mais je dois dire qu’un menteur est difficile supporter. Il s’agit parfois d’un problème psychologique lié à une personnalité faible. Un sérieux problème parce que notre société tolère la légèreté et la duplicité.
La femme que vous admirez le plus ?
Je dirais mes grands-mères, à qui je rends d’ailleurs hommage pour leur amour et leur sens poussé pour l’éducation.
Dans l’histoire de notre pays, je pense qu’Inamujandi, cette femme de Ndora mérite une certaine admiration. Elle a pu résister contre l’administration coloniale belge en 1934 malgré l’inégalité des rapports de forces.
Il faut également parler de toutes ces veuves qui, seules, éduquent dignement leurs enfants dans des conditions souvent précaires.
L’homme que vous admirez le plus ?
Pour l’histoire récente, Nelson Mandela fait plus ou moins l’unanimité. Il a aidé son pays, l’Afrique du Sud à sortir de l’apartheid. On sait qu’il s’est aussi occupé des problèmes d’autres pays dont le Burundi.
Votre plus beau souvenir ?
Je garde quelque trois évènements liés à mon parcours de formation. D’abord, quand j’ai eu l’information de ma réussite au concours national en 1999. J’ai eu une grande émotion. Pour moi comme pour l’ensemble de la société, l’entrée à l’école secondaire (encore plus dans un lycée à internat) était un grand pas pour une vie épanouie. Ensuite, j’ai retrouvé la même joie quand j’ai su que j’avais la note exigée pour entrer à l’Université du Burundi (je ne pouvais pas me payer l’université privée). J’ai eu enfin une joie immense quand en 2015 j’ai lu mon nom sur la liste des boursiers du gouvernement pour poursuivre ma formation en Master.
Votre plus triste souvenir ?
Lorsqu’en 2016, j’ai reçu des nouvelles du décès de ma grand-mère maternelle. Une triste nouvelle qui m’a pris de court. Quelques jours auparavant, on s’était parlé au téléphone. Mais, j’aurais aimé la revoir après plus d’une année d’absence au pays. Cette année, j’étais en France pour mes études.
Quel serait votre plus grand malheur ?
Mais, on dit que « quand on parle du loup, on voit sa queue ». Laissons un peu les malheurs pour nous préoccuper du bonheur. « Quand on parle de la rose, on en sent le parfum !»
Le plus haut fait de l’histoire burundaise ?
Je pense à l’indépendance retrouvée après une période de domination coloniale. Les Burundais y croyaient énormément. Ils étaient heureux, car ils pensaient à des lendemains meilleurs.
La plus belle date de l’histoire burundaise ?
Le 1er juillet 1962 date de la proclamation de l’Indépendance. Elle est symbolique, certes, mais elle marquera toujours l’histoire de notre pays.
La plus terrible ?
Je peux donner deux parmi d’autres.
L’année 1972 constitue un drame, une déchirure nationale, un point culminant dans l’histoire du conflit politico-ethnique burundais. Elle marquera les mémoires des Burundais pour plusieurs années.
De même, le 21 octobre 1993 fut aussi terrible. L’assassinat du président Melchior Ndadaye, nouvellement élu, par un groupe de gens fut un coup dur pour le pays. Cet acte ignoble a mis fin aux espoirs d’une transition politique apaisée. On sait que la suite a été très difficile à gérer.
Le métier que vous auriez aimé faire ?
C’est bien ce que je fais. Je suis historien, enseignant-chercheur en sciences sociales. Vous savez que l’historien a toujours été l’homme de culture et du débat citoyen. Faut-il signaler qu’il y a une demande sociale permanente pour l’histoire. Je le dis souvent à mes étudiants. C’est un métier enrichissant. Je me dis toujours qu’on a une cause noble qui se gagnera, peut-être, dans l’avenir : former, éduquer et éveiller les consciences. Et surtout qu’on a un espace social pour développer et diffuser des idées. Quand on rédige un travail de recherche, on sait bien qu’il y aura des lecteurs. Pareil, quand on enseigne, les étudiants écoutent, approuvent, posent des questions ou donnent leurs avis.
Votre passe-temps préféré ?
Quand j’ai suffisamment du temps libre, je me cherche un bon roman à lire. La plume d’Alain Mabanckou me plaît. Il m’arrive aussi d’ouvrir l’application YouTube pour suivre les interventions des grands penseurs en sciences sociales. Très récemment, j’ai commencé à arpenter ces montagnes surplombant la ville de Bujumbura, le samedi. Une bonne expérience. De là, on a une très belle vue sur Bujumbura et le lac Tanganyika.
Votre lieu préféré au Burundi ?
Dernièrement, j’ai découvert que le trajet Bujumbura-Rumonge-Nyanza Lac est magnifique avec la vue sur le lac Tanganyika. Quand on aura terminé la réhabilitation de cette route, je referai sans doute le trajet (avec des proches) chaque fois que j’aurai le temps et les moyens.
Le pays où vous aimeriez vivre ?
C’est bien le Burundi. Bien sûr, certaines conditions doivent être bien remplies : le travail et la sécurité. Mais, j’ai peur de la ville de Bujumbura dans 20 ans à venir. Elle sera très difficile à vivre, car elle est déjà saturée. Espérons que Gitega va jouer son rôle de désengorgement.
Le voyage que vous aimeriez faire ?
Je n’ai pas encore beaucoup voyagé. Mais, j’aimerais voyager aux Etats-Unis d’Amérique, la Chine et l’Australie.
Votre rêve de bonheur ?
Intégrer un grand centre de recherches et d’animation scientifique, de rayonnement international.
Votre plat préféré ?
Je mange de tout. Mais il y a un fruit que j’aime énormément : l’avocat.
Votre chanson préférée ?
En général ce sont toutes les chansons des clubs culturels comme Giramahoro, Umuhanga, Ihunja,…
Quelle radio écoutez- vous ?
Quand j’étais en France de 2015 à 2019, je suivais régulièrement la télévision France 24 pour le journal. Pour le moment je n’écoute pas de radio. Je suis l’actualité à travers les comptes Facebook.
Avez-vous une devise ?
Non, je n’ai pas une devise fixe. Je me remets chaque fois en cause.
Votre souvenir du 1 juin 1993 (élection du président Ndadaye ?)
C’est vrai que je n’étais pas assez mature pour comprendre la situation. Mais je me souviens qu’il y avait eu des « meetings » chauds. Ma grand-mère était membre de l’UFB (Union des Femmes Burundaises). Le jour de l’élection, les membres de ma famille sont partis très tôt le matin pour voter.
Le jour de la proclamation des résultats, pour la première fois, nous nous sommes rassemblés impatiemment autour du poste radio de mon grand-père. C’était à 19 h. L’ambiance était inhabituelle. Quand la radio nationale a proclamé les résultats, ma tante a poussé un cri de désespoir. Depuis ce jour, on se rencontrait à 19h pour écouter le journal parlé en kirundi.
Votre définition de l’Indépendance ?
L’indépendance est l’état de souveraineté et d’autonomie d’un Etat. Cette souveraineté doit être réelle dans tous les domaines.
Votre définition de la démocratie ?
La démocratie est un régime de gouvernement par des hommes et femmes capables choisis librement pour s’occuper honorablement des intérêts du peuple.
Votre définition de la justice ?
La justice est la reconnaissance, le respect et la promotion des droits de chaque citoyen d’un Etat. En gros, c’est le rôle des services spécialisés de l’Etat. Mais, il faut avoir une société et une culture qui désapprouvent l’injustice.
Petit à petit, les langues de certains se délient pour consigner à travers les livres les évènements de 1972, 1988, et 1993. Pensez-vous que les Editions Iwacu avec la collection « Témoins » peuvent éclairer l’opinion sur ces périodes sombres de l’histoire du Burundi ?
Oui, tous ces témoignages publiés dans les Editions Iwacu jouent un grand rôle dans la connaissance de notre passé mais aussi dans le processus de la réconciliation. Je l’ai bien marqué dans mon intervention à ce sujet, Burundi 1972 : qui a écrit quoi ? Je l’ai repris dans mon dernier article ? De l’historiographie burundaise : qui a écrit quoi et dans quel contexte ? Cette volonté de témoigner essaie de répondre à une demande sociale croissante pour la vérité. En rendant vivantes ces mémoires en débandades, on comprend que les faits historiques méritent d’être dits et commentés. Dans une société globalement connu pour son oralité, les écrits restent rares. L’initiative des Editions Iwacu permet à ceux qui le peuvent de raconter, de témoigner, de pleurer, de se souvenir, …faisant ainsi le devoir de mémoire.
Qu’est-ce qui manque pour que la nation burundaise soit pleinement réconciliée ?
La réconciliation est un long processus. L’historien Raymond Aron développe une théorie de quatre générations d’après un drame : victimes, silence, vérité et réconciliation. Il faudra voir où nous en sommes au Burundi. Je crois que les choses peuvent évoluer de manière positive. Mais, il faudra plus de détermination.
Votre point de vue sur le travail de la CVR ?
Cette commission a une grande mission difficile mais très noble. La recherche de la vérité et la réconciliation des Burundais. Etant seule, la CVR ne pourra pas y arriver. Pour le moment, on constate un vide du côté de la société civile œuvrant dans le domaine des mécanismes de la justice transitionnelle. Ainsi, il est urgent de penser à un large débat citoyen pour échanger sur les différentes questions et les contraintes qui se posent.
Des enseignants des Universités publiques enclins à aller voir où l’herbe est plus verte. Que faire pour freiner ce mouvement ?
Je ne pense pas qu’il s’agit d’un grand problème. Je parlerai plutôt des échanges et des circulations de connaissances et d’expériences, des fois, qui peuvent se révéler fructueux. La plupart de ceux qui partent sont connectés avec ceux qui restent. En plus, la science est universelle. Pour revenir à votre question, je pense que ces institutions doivent voir dans quelle mesure être beaucoup plus attractives. Cela, à travers un contexte général épanoui : meilleures rémunérations, encadrement et animation scientifique dans des centres de recherches, partenariats avec les grandes universités dans le monde…
Plus d’un déplore le système éducatif qui va decrescendo. Est-ce votre constat ?
C’est vrai qu’il y a une conjoncture qui explique la baisse du niveau des élèves. Une décennie de guerre civile, la croissance démographique, le niveau de vie des enseignants …sont parmi les facteurs qui expliquent cette situation.
Quelles mesures phares prendriez-vous si vous étiez ministre de l’Education nationale ?
Le secteur éducatif est très vaste. D’abord, il faudra que la décentralisation soit effective : c’est-à-dire donner aux instances de base (DPE et DCE) l’ensemble des moyens nécessaires pour agir. Ensuite, pour désengorger les classes, la construction de nouvelles écoles est primordiale, y compris des établissements à internat. Ces derniers sont nécessaires pour assurer un encadrement efficace pour les plus nécessiteux.
Il existe aussi des activités complémentaires à l’enseignement mais qui sont largement négligées. À titre d’exemple, pour renforcer la maîtrise des langues, je pense aux clubs de lecture et d’animation littéraire, au théâtre, etc. Enfin, pour assurer l’évaluation de la mise en place des réformes entreprises, une rencontre annuelle (Etats généraux) serait organisée au niveau national.
Croyez-vous à la bonté humaine ?
Oui, j’y crois. Il y a des gens de bonne volonté œuvrant pour le bien de la société. Ce sont ces gens qui sont prêts à aider les autres sans rien attendre en retour. Il existe toujours des « hommes de paix en temps de guerre ». Chacun de nous connaît des hommes et des femmes de cette catégorie. Malheureusement, ils sont peut-être noyés par l’ampleur de la méchanceté des déviants.
Pensez-vous à la mort ?
Pas souvent. En tout cas, elle ne me préoccupe pas, du moins pour le moment. Il m’arrive de penser plutôt au chagrin de mes proches une fois que l’irréparable se commettra.
Si vous comparaissez devant Dieu, que lui diriez-vous ?
Rien ! Je n’ai pas des injonctions ou des recommandations à lui adresser.
Propos recueillis par Jérémie Misago