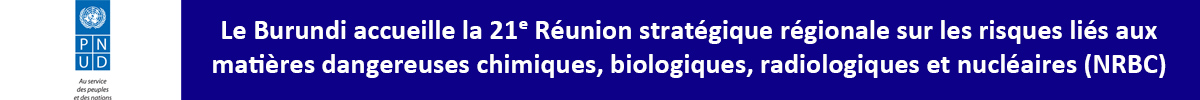Dans le Burundi traditionnel, le soir, au coin du feu, la famille réunie discutait librement. Tout le monde avait droit à la parole et chacun laissait parler son cœur. C’était l’heure des grandes et des petites histoires. Des vérités subtiles ou crues. L’occasion pour les anciens d’enseigner, l’air de rien, la sagesse ancestrale. Mais au coin du feu, les jeunes s’interrogeaient, contestaient, car tout le monde avait droit à la parole. Désormais, toutes les semaines, Iwacu renoue avec la tradition et transmettra, sans filtre, la parole longue ou lapidaire reçue au coin du feu. Cette semaine, au coin du feu, Athanase Karayenga.
Votre qualité principale ?
Je ne sais pas. Seuls les proches et les amis pourraient répondre objectivement à cette question. Mais je suppose que j’ai des qualités comme tout le monde. J’aime penser que la bienveillance, l’optimisme et l’humour constituent mes péchés mignons.
Votre défaut principal ?
Les qualités des êtres humains constituent les lumières qui éclairent notre face éclairée comme la lune. Nos défauts constituent souvent l’envers de nos qualités. Et les obscurités de la face non éclairée de notre lune personnelle constituent paradoxalement les prolongements inattendus de nos qualités. Par exemple, la bienveillance que j’évoque dans mon caractère peut devenir de la naïveté. L’optimisme peut devenir de l’aveuglement et l’humour de la méchanceté. De ce fait, nous sommes une médaille ou une pièce de monnaie. Nous sommes parfois le positif du négatif ou l’inverse.
La qualité que vous préférez chez les autres ?
J’adore les gens bienveillants, accueillants, chaleureux, généreux. J’admire les gens optimistes et néanmoins lucides. J’ai une admiration infinie pour les gens qui savent faire éclater de rire les foules. J’adore Ildéphonse, le jeune comédien burundais quand il imite Pierre Nkurunziza et Paul Kagame. Je pleure jusqu’aux larmes comme un gamin quand il sollicite son soutien à Paul Kagame pour un projet de chanson …. « Gupapapa akana ». Il est absolument génial ce jeune.
Le défaut que vous ne supportez pas chez les autres ?
Je sais le défaut que je ne supporte absolument pas chez les autres et surtout chez les hommes politiques. Le mensonge, le cynisme, l’inhumanité et la cruauté à l’égard des citoyens burundais les plus fragiles me révulsent et me révoltent.
La femme que vous admirez le plus ?
J’ai une infinie admiration pour les femmes burundaises qui depuis des années sont souvent les victimes des violences provoquées par les régimes politiques successifs. Elles continuent malgré tout à porter le poids des ménages et à élever les enfants souvent seules.
Cependant, je sais que toutes les femmes burundaises ne sont pas des héroïnes de courage, de résilience et de bienveillance. Certaines ont même participé activement aux crimes commis pendant les guerres civiles burundaises.
L’homme que vous admirez le plus ?
Louis Rwagasore, Nelson Mandela et Thomas Sankara. Ainsi que mon ami Aloys Kadoyi, dont je n’arrive pas à faire le deuil. Aloys Kadoyi était un homme exceptionnel et complet. Une intelligence vive.
Une habilité au football qui en aurait fait une star internationale aujourd’hui. Un intarissable répertoire de « mazina », de poésies et de chants lyriques mélangés. Une générosité et une disponibilité inépuisable à l’égard des autres.
Votre plus beau souvenir ?
J’ai effectué un voyage avec un Pape canonisé depuis et devenu Saint Jean-Paul, c’est un souvenir professionnel de journaliste à la fois amusant et fantastique. En 1990, au cours d’un périple que le Pape Jean Paul II a effectué en Tanzanie, au Rwanda, au Burundi et en Côte d’Ivoire pour inaugurer la Basilique Notre-Dame de Yamoussoukro, l’avion papal a été violement secoué par les turbulences avant de faire une escale à Malte afin de faire le plein de carburant. Je me suis accroché au fauteuil comme tous les autres passagers et une pensée saugrenue m’a traversé l’esprit : Dieu ne peut pas permettre que l’avion d’un Pape s’écrase en Mer Méditerranée. Autre beau souvenir lié à ce voyage papal aussi. Une inoubliable bagarre entre la centaine de journalistes qui accompagnait Jean-Paul II dans ce voyage. Nous nous battions pour obtenir de lui une interview exclusive en cours de vol. Car le Pape ne parlait jamais aux médias au sol. Pour être aperçu de lui, j’ai dû monter sur le dos de mon siège d’avion. J’avais la tête au plafond de l’aéronef. Et le Pape m’a repéré et a accepté de répondre à mes questions.
Votre plus triste souvenir ?
Après le Séminaire à Burasira, je me suis inscrit dans la Faculté de Philologie Romane à l’Université du Burundi. Après les examens de première session, en juin 1967, j’avais 19 ans et j’avais la tête dans les étoiles comme tous les jeunes à cet âge. Pendant la période où nous attendions les résultats, un couple de Professeurs belges, Mme et M. Mahieux, m’a proposé de me faire faire un tour en ville dans leur VW blanche. Nous avons fait le tour du centre-ville de Bujumbura et à la hauteur du Palais des Arts, ils se sont arrêtés. Je leur ai posé une question qui me brûlait les lèvres. Que me valait l’honneur de ce tour en ville ? « Vous avez réussi vos examens de première session », m’ont-ils indiqué. Evidemment j’étais ravi. « Mais, ont-ils ajouté tout de suite, vous n’avancerez pas en deuxième année d’université. »
Assommé comme par un gourdin, j’ai eu quand même la présence d’esprit de leur poser la deuxième question. « Et pourquoi ? » Leur réponse. « Parce que vous êtes vaniteux »…Ah bon, leur dis-je abasourdi ! « Mais, ne vous en faites pas, ont-ils enchaîné, nous avons parlé au Recteur de l’Université, un Jésuite que les étudiants surnommaient Sembeba en raison de sa petite taille sans doute. Votre bourse sera renouvelée automatiquement. Ce que le Recteur a confirmé plus tard. Je l’ai contacté aussitôt revenu à l’ancien siège de l’Université, en face de l’actuel Supermarché T 2000, sur le Boulevard de l’Uprona.
Mme Mahieux m’a expliqué qu’elle n’avait pas du tout apprécié, que pendant un cours sur un poème de Victor Hugo, « Booz endormi », je me sois permis de protester. Car elle nous imposait sa préférence pour un vers qu’elle considérait comme le plus beau. « Mais Madame, lui ai-je dit, en poésie, est-ce que chacun n’a pas la liberté de préférer le vers de son choix ? ». Cette remarque insolente, me dira-t-elle en face du Palais des Arts, m’a valu le redoublement de la première année de Philologie Romane. Redoublement que je n’ai pas accompli d’ailleurs.
Car, entretemps, l’Etat-major de l’armée du Burundi a fait passer un message sur le campus de Mutanga. Elle recrutait des jeunes qui voulaient devenir Officiers afin de « défendre la République » proclamée le 28 novembre 1966. Je me suis engagé. Je suis parti avec une dizaine de copains pour une formation à l’Académie militaire de Héliopolis au Caire. Cependant, mon objectif était d’apprendre à tirer, revenir ensuite au Burundi et tuer tous les Belges. Une rage folle qui s’est heureusement calmée avec le temps. Surtout, je n’en veux absolument plus aux Belges.
Quel serait votre plus grand malheur ?
Les plus grands malheurs sont évidemment les disparitions progressives des membres de la famille et des amis quand on est loin et qu’on ne peut pas les accompagner ni réconforter leurs familles. En outre, je vis la crise dramatique que traverse le Burundi depuis 2015 et toutes les conséquences qu’elle a entraînées comme un des plus grands malheurs du temps présent.
Le plus haut fait de l’histoire burundaise ?
Je dirais plusieurs hauts faits dans l’histoire mouvementée du Burundi. La résistance victorieuse des Burundais aux esclavagistes arabes de Rumariza, la résistance farouche des Badasigana de Mwezi Gisabo contre l’invasion allemande. Même si le roi a dû s’incliner vaincu car trahi par son demi-frère, Kilima et son gendre, Maconco, et qu’il a signé le traité de soumission de Kiganda en 1903. Cependant, la défaite de Mwezi Gisabo a permis, paradoxalement de consolider le royaume.
Le deuxième haut fait de l’histoire du Burundi est évidemment la victoire du parti de Louis Rwagasore le 18 septembre 1961 qui ouvrait le chemin de l’indépendance acquise grâce au roi Mwambutsa. On ne le dit pas assez. Mwambutsa a soutenu avec intelligence, efficacité et discrétion son fils Louis Rwagasore. L’indépendance a été acquise aussi grâce à des compagnons de lutte du Prince Louis Rwagasore qui provenaient de toutes les couches de la population burundaise et grâce, en particulier au vote massif des femmes burundaises. Et fait absolument remarquable, Louis Rwagasore et ses compagnons ont remporté la victoire de l’indépendance sans tirer une seule balle contre la Tutelle belge.
La plus terrible ?
Le fait que l’histoire du Burundi fut un gâchis monstrueux de la victoire de Melchior Ndadaye, le 1er Juin 1993. Cette formidable avancée démocratique a été gâchée d’abord par une campagne électorale haineuse et virulente dans les deux camps opposés. Elle fut abîmée et ensevelie par l’assassinat du président élu, par les innombrables crimes contre l’humanité et crimes de guerre dont des centaines de milliers de citoyens Hutu, Ganwa, Twa et Tutsi furent victimes et enfin par le génocide des Tutsi attesté par un rapport des Nations Unies. Un désastre absolu.
Le métier que vous auriez aimé faire ?
A la fin de mes humanités gréco-latines, je rêvais de faire des études de médecine. Plus tard, j’aurais voulu devenir ingénieur agronome.
Votre passe-temps préféré ?
L’écriture d’articles, la formation des journalistes, la lecture des livres, l’écoute de la musique, la marche en forêt et, last but not least, le jardinage.
Votre lieu préféré au Burundi ?
C’était chez moi. A Gisha, en commune de Tangara, province Ngozi. C’était chez moi, car depuis la persécution et l’expulsion de ma famille par les militants du Frodebu en 1993, mon plus grand chagrin est que je ne me sentirai plus jamais assez en confiance pour y séjourner pendant plusieurs jours d’affilée.
Le pays où vous aimeriez vivre ?
Dans mon rêve naïf, j’ai toujours espéré vivre alternativement au Burundi et en France. Par la force des choses, je vis en continuité en France devenue ma deuxième patrie. J’ai fui le Burundi que j’ai quitté en septembre 1979. Je n’y suis plus retourné que pour des séjours ponctuels. C’est donc la France où je vis avec bonheur et reconnaissance à l’égard d’un pays qui a été bienveillant et accueillant pour moi.
Le voyage que vous aimeriez faire ?
J’ai effectué de très nombreux voyages professionnels dans presque tous les pays d’Afrique, dans beaucoup de pays d’Europe occidentale, centrale et en Russie, en Amérique du Nord, au Moyen Orient, en Asie dont l’Inde et la Chine. Si je gagnais le gros lot du loto, mais pour cela il faudrait que je commence peut-être à jouer, j’aimerais faire un grand tour planétaire qui commencerait au Japon et se poursuivrait en Australie, au Brésil, au Pérou et enfin au Mexique. Et Christophe Colomb serait battu à plate couture !
Votre rêve de bonheur ?
Mon plus grand rêve est que le Burundi devienne un Etat de droit. C’est-à-dire que le régime politique burundais permette aux citoyens de vivre pleinement tous leurs droits et devoirs et toutes les libertés. De ce fait, mon plus grand rêve de bonheur serait réalisé si le Burundi devenait un pays de paix, de démocratie apaisée, de liberté et de prospérité pour tous les citoyens. Sans exclusive. Mon rêve de bonheur serait réalisé si le Burundi adoptait une Constitution qui s’inspire du système politique de la Suisse. Le partage du pouvoir et des responsabilités politiques au plus haut niveau chez les Helvètes se fait grâce à un système rotatif. Au Burundi, ce système rotatif permettrait à toutes les communautés burundaises, aux femmes et aux hommes d’accéder au pouvoir grâce à un système apaisé, transparent, prévisible et débarrassé de la violence des combats entre des partis politiques dont l’objectif unique semble de garder le pouvoir jusqu’au retour de Jésus.
Votre plat préféré ?
Quand j’étais enfant, je mangeais un plat qui n’existe plus dans la cuisine burundaise d’aujourd’hui. On l’appelait ikinyiga. Dans mon souvenir lointain, on faisait fondre le beurre de vache conservé dans des pots en terre. On trempait des morceaux de « mutsima » ou pâte d’éleusine dans le beurre fondu et chaud comme une fondue savoyarde. Le beurre spécifique pour faire ikinyiga avait un goût très proche de celui du Roquefort, un célèbre fromage de brebis que j’ai découvert en venant faire mes études en France en 1970 et dont je raffole. Ne me demandez pas pourquoi ikinyiga burundais de mon enfance avait le goût de Roquefort !
Cependant, grâce à mes nombreux voyages dans le monde, j’ai découvert une infinité de plats préférés dans la cuisine française évidemment, à tout seigneur tout honneur, mais aussi dans la cuisine chinoise, indienne, sénégalaise, camerounaise, marocaine, malgache, italienne, espagnole, etc.
Votre chanson préférée ?
Le hitparade de mes chansons ou musiques préférées est impossible à faire. Comme pour la cuisine, j’ai découvert la richesse absolument enivrante des musiques du monde. La psalmodie du Coran dans les minarets du Caire ou d’Istamboul m’émeut. La musique grégorienne de ma jeunesse au séminaires de Mureke et Burasira dont le « Te Deum » et « Veni Creator Spiritus », les mélodies américaines, anglaises, Jean Ferrat qui chante les poèmes d’Aragon, les musiques sénégalaises, le reggae de Bob Marley, « Imagine » de John Lennon, la sublime chanson de Kidumu « Yaramenje » dont les paroles ont été écrites par Jean-Baptiste Manwangari et qui devrait être chantée comme le deuxième hymne national burundais, la musique rwandaise, la sixième symphonie de Beethoven, la musique du Cap Vert de Cesaria Evora, la musique tsigane, la musique de Salif Keita du Mali, la musique mandingue de Guinée, la musique indienne de Ravi Shankar, l’Afro beat nigérian de Fela Kuti, des morceaux de piano de Chopin, toutes les musiques du monde, toutes absolument, me touchent et me nourrissent. Impossible donc de désigner une chanson ou une musique préférée.
Quelle radio écoutez-vous
J’écoute plusieurs radios alternativement. Les radios numériques burundaises en exil, Radio Peace FM, Humura, Inzamba, Haguruka, Umurisho forment le peloton de tête de mes radios préférées. En plus de ces radios burundaises numériques, j’écoute assidûment Radio France Internationale et Radio France Culture. De façon moins régulière, j’écoute aussi des émissions de la BBC, de VOA, de DW, etc.
Avez-vous une devise ?
Oh non. Je déteste m’enfermer dans les cages de dogmes, des croyances religieuses, philosophiques ou économiques. Les cages, même dorées, constituent des prisons pour la pensée, l’imagination et l’émerveillement.
Votre souvenir du 1er juin 1993 ?
Au début de la nuit du 1er Juin, je me souviendrai toujours du visage du ministre de l’Intérieur, M. François Ngeze, accouru à l’état-major de la campagne électorale du candidat Pierre Buyoya. Le ministre était complètement défait par la victoire de Melchior Ndadaye.
Votre définition de l’indépendance ?
L’indépendance politique du Burundi constituait en fait, la restauration de la souveraineté du pays mise entre parenthèses par la colonisation allemande puis belge pendant une cinquantaine d’années environ. L’Etat burundais existait depuis plusieurs siècles avant la colonisation. Son indépendance a été restaurée par Louis Rwagasore. La fin de la dépendance coloniale a propulsé le Burundi dans la mondialisation. Le pays, quoiqu’indépendant, devrait apprendre à vivre dans la communauté internationale et pratiquer avec intelligence et efficacité le principe défini par Léopold Sédar Senghor. Car le monde est entré dans « l’ère du donner et du recevoir», dans l’ère du multilatéralisme et de la souveraineté partagée.
Votre définition de la démocratie ?
La démocratie est un régime politique où les citoyens jouissent de tous les droits fondamentaux dont les droits à la vie, à la paix, à l’éducation, aux soins de santé, à un habitat décent, au travail, à une justice équitable qui permet aux victimes d’obtenir la réparation des torts subis et de recouvrer leurs dignité. En outre, la démocratie constitue un système politique où les citoyens ont le droit d’élire et d’être élu en toute transparence. Sans fraudes électorales ni résultats électoraux « draft ».
C’est un système politique qui assure une représentation absolument égale (50%) entre les femmes et les hommes dans toutes les institutions et à tous les échelons du pouvoir. La démocratie c’est évidemment pour tous les citoyens la liberté d’information et de communication de ses opinions via les médias. Aussi, les gérants de l’Etat sont au service des citoyens et doivent leur rendre des comptes régulièrement. C’est un système politique où l’Etat est laïc et où il demeure neutre par rapport aux confessions religieuses qu’il doit respecter tout en protégeant les citoyens contre les sectes. Celles-ci exercent parfois une captation criminelle des libertés individuelles des citoyens. Enfin, en démocratie, les pouvoirs sont rigoureusement séparés afin que les institutions exercent leurs responsabilités dans des limites fixées par la constitution et se contrôlent mutuellement.
Votre définition de la justice ?
La Justice dans une société constitue un des mécanismes indispensables de résolution des conflits. Quand elle est équitable et sereine, elle permet de confondre le coupable et de rétablir les victimes dans leurs droits et leur dignité. A l’inverse, l’impunité des crimes commis constitue un des mécanismes les plus efficaces pour détruire une communauté ou une nation.
Quel souvenir gardez-vous de votre passage à la Radio nationale ?
Avec l’aide d’Antoine Ntamikevyo et d’un coopérant français, M. Claude Thévenet, j’ai constitué la troupe extraordinaire des Mabano. Celle-ci regroupait des musiciens burundais de grand talent comme Niki Dave, Tanga et Africanova ainsi que des musiciens kenyans et congolais. Les Mabano ont participé à une compétition panafricaine organisée par Radio Nederlands, la Radio des Pays Bas basée à Hilversum. Ils ont créé notamment une musique sur la base de quelques notes d’une mélodie inventée par Manu Dibango et ont gagné le premier prix d’un groupe musical sur le continent africain.
Entre la compétition et la proclamation des résultats, j’avais quitté la Radio nationale contre mon gré et grâce au Président Bagaza, j’avais fui le Burundi pour échapper à la prison. Les résultats de cette compétition ont été publiés dans un journal panafricain, Le Continent, que j’ai acheté par hasard à Dakar où je me trouvais en mission de consultant pour le compte de l’UNESCO. Je me suis précipité vers un bureau de Poste à Dakar pour envoyer un télégramme de félicitations aux Mabano. Et c’est grâce à mon télégramme qu’ils ont appris qu’ils avaient gagné la compétition continentale. Une fabuleuse aventure, les Mabano.
Comment analysez-vous la liberté de la presse au Burundi?
Depuis des années, elle a progressé quand même. Malgré les régressions actuelles et l’emprisonnement arbitraire des quatre journalistes d’Iwacu à qui je transmets mon soutien et mes encouragements. Le progrès de la liberté de la presse est dû, en partie, au niveau de la formation des journalistes burundais qui a considérablement augmenté. Beaucoup de jeunes qui rejoignent le métier du journalisme ont actuellement un niveau universitaire de Licence ou de Master. Cependant, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir encore afin que les médias burundais, publics et privés, soient servis par des journalistes d’un niveau professionnel uniformément élevé.
Le plus grand handicap qui bloque la liberté de la presse, c’est la mainmise totale de l’Etat sur les médias publics et privés et sur les journalistes. Je rêve qu’un jour les professionnels du journalisme et de la communication se regroupent pour constituer un Parlement des Médias autonome du gouvernement. Un véritable quatrième pouvoir qui aurait la mission de défendre et de développer la liberté d’expression, la liberté d’information et la liberté de communication.
Si vous étiez ministre de la Communication, quelles seraient vos deux premières mesures ?
Devenir ministre de la Communication constituerait une régression inacceptable dans la hiérarchie politique. Car, beaucoup de nos compatriotes ne le savent pas, j’ai été président de la République du Burundi pendant le temps d’une escale à Karachi, au Pakistan.
Je vous raconte une histoire absolument incroyable. Jeune journaliste récemment revenu au Burundi après mes études à l’Ecole Supérieure du Journalisme de Strasbourg, j’ai été autorisé par le ministre de l’Information de l’époque, M. Bernard Bizindavyi, d’aller en mission pour couvrir le sommet des Chefs d’Etat des Pays non-alignés organisés au mois d’août 1976 à Colombo, la capitale du Sri Lanka.
Le Président Micombero aurait dû participer à ce sommet mais il n’est pas venu. Il a été remplacé, in extremis, par son Ministre des Affaires Etrangères, M. Melchior Bwakira, un homme remarquable. Et l’itinéraire de retour au Burundi du Chef de l’Etat passait par Karachi. Il se fait que le Premier Ministre du Zaïre, M. Karl I Bond, qui avait représenté le Maréchal Mobutu lequel n’avait pas fait le déplacement pour Colombo non plus, a offert aux délégations africaines qui le souhaitaient, un « lift » direct de Colombo jusqu’à Nairobi.
Avant de rentrer au Burundi, j’avais prévu de faire un crochet par la France et ainsi, je me suis retrouvé seul de la délégation burundaise qui aurait dû faire le voyage Colombo, Bombay, Karachi, le Caire, Nairobi et Bujumbura. Pendant tout le parcours de Colombo à Karachi, un confrère, un journaliste gabonais qui effectuait le voyage avec moi, a décidé de faire la fête dans l’avion après « le dur labeur de la couverture » du sommet des pays non-alignés.
Quand je suis arrivé à l’escale de Karachi, un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères qui n’avait pas été averti que Micombero avait annulé sa participation au sommet des non-alignés est venu accueillir le Chef d’Etat du Burundi et sa délégation. Car il était prévu que le président du Burundi fasse escale à Karachi.
Le brave fonctionnaire pakistanais chargé du protocole est entré dans l’avion, a demandé à la délégation du Burundi de se faire connaître. J’étais le seul Burundais dans l’avion et malgré les multiples coupes de champagne offertes par mon confrère gabonais, j’ai eu la présence d’esprit de lever la main et le fonctionnaire pakistanais m’a conduit au salon d’honneur qui avait été réservé pour Michel Micombero. Je suis descendu de l’avion, j’ai marché sur le tapis rouge et je suis entré dans le salon d’honneur où le chargé du protocole m’a offert une tasse de thé avant de s’éclipser et me laisser seul.
Le champagne aidant, je n’ai pas tardé à m’endormir. Et avant que l’avion ne quitte Karachi pour continuer mon vol vers l’Allemagne où je devais faire escale avant d’arriver en France, le même fonctionnaire pakistanais est revenu dans le salon d’honneur, m’a tapoté sur les épaules en me disant : Sir, Sir, Sir. Je me suis réveillé en sursaut et il m’a reconduit dans l’avion en passant par le même tapis rouge. Le temps d’une escale à Karachi au Pakistan, en août 1976, j’ai donc été traité comme le chef du Burundi.
Dans la création de l’Ecole de journaliste, il y aurait eu des divergences entre le ministre de la communication, Pierre Ngenzi et vous au sujet de son organisation. Qu’en-était-il au juste ?
Le président Bagaza nous a consultés séparément afin qu’on lui fasse des suggestions sur l’organisation de la formation des Journalistes au Burundi. Le ministre Pierre Ngenzi estimait qu’il fallait créer une Ecole qui aurait formé des « Journalistes Moyens. »
J’étais horrifié par cette expression. Au contraire, j’ai suggéré au président Bagaza de créer une Ecole de Journalisme où les candidats seraient sélectionnés par concours et auraient au moins une Licence universitaire. Les candidats pourraient provenir de n’importe quelle discipline universitaire. En deux ans de formation pointue, théorique et surtout pratique, les jeunes universitaires provenant des facultés de droit, d’économie, d’histoire, de sociologie, des sciences politiques, de l’éducation physique, de l’agriculture… auraient pu obtenir l’équivalent d’un Master d’aujourd’hui et devenir très rapidement d’excellents journalistes opérationnels et spécialisés en journalisme judiciaire, en journalisme agricole, en journalisme politique, en journalisme économique, en journalisme sportif, en journalisme diplomatique, etc. etc. Ma suggestion a été refusée et l’Ecole pour « Journalistes Moyens » a été ouverte en 1981. Deux ans après mon départ du Burundi.
Que signifie «Syatwaturo», le nom de votre chronique humoristique sur les réseaux sociaux?
Sya twa turo signifie, « transforme les dernières réserves de graines d’éleusine, uburo, en farine » afin que tu puisses nourrir la famille.
Dans la campagne burundaise, au mois de décembre environ, on entend un oiseau dont le chant a été interprété comme s’il donnait des injonctions à la population et l’incitait à moudre les dernières réserves d’éleusine. L’éleusine est une céréale constituée de petits grains. Elle est récoltée au mois de juin. Or, la fin de l’année au Burundi est souvent marquée par une disette récurrente. D’où cette incitation à consommer les dernières réserves d’éleusine afin d’en faire soit une pâte, « umutsima », ou des bouillies, « umusururu », à consommer en attendant les jours meilleurs. Quand les récoltes de la première saison agricole seraient disponibles en février ou mars.
La décision pour faire de ce bel oiseau un lanceur d’alerte sous forme de mini-billets humoristiques et sarcastiques m’a été inspiré par le nom même de ce volatile. Par simple jeu de mots, j’ai fait le rapprochement phonétique entre Syatwaturo et Twitter afin de créer un espace médiatique nouveau, un espace d’ironie, d’impertinence, de dérision des hommes et femmes politiques ou des imposteurs comme Kenny-Claude connu pour ses discours de haine virulente anti Tutsi ou Hutu.
Croyez-vous à la bonté humaine ?
Absolument. J’ai été, au cours de mes pérégrinations dans le monde, le témoin et le bénéficiaire de la bonté humaine. La bonté humaine existe, elle constitue, à mon avis, la première force de l’être humain. Même la méchanceté la plus vilaine n’arrive pas à obscurcir la bonté fondamentale des humains.
Pensez-vous à la mort ?
Certainement. Comme tous les humains je suppose. Même si l’idée de la mort nous effraye et nous dépasse. En 1993, j’ai frôlé vraiment la mort à la suite d’une hémorragie interne dans l’estomac. Elle s’est déclarée au moment où je terminais une mission au Burundi. J’ai fait ma valise à quatre pattes. Cependant, j’ai eu assez de forces pour effectuer le voyage retour à Paris. Le lendemain de mon arrivée, j’étais conduit en urgence à l’hôpital où les médecins ont découvert que j’avais un taux d’oxygène dans le sang tellement bas qu’ils se demandaient comment j’avais pu survivre et garder l’esprit lucide.
A ce taux, me disaient-ils, normalement on ferme le cercueil. Je me suis senti partir par moments. Cependant et paradoxalement, j’ai gardé de ce voyage jusqu’aux abords de la mort, un sentiment de grande sérénité. Au point que j’en ai presque voulu aux médecins qui m’avaient ramené à la vie !
Si vous comparaissiez devant Dieu, que lui diriez-vous ?
Quelle question ! Vous doutez que je ne puisse pas comparaître devant Dieu ? Puisque votre question est au conditionnel.
Je pense qu’il ne faut pas se préoccuper trop de ce qui nous arrivera après la mort. On n’en sait rien et personne n’est jamais revenu pour nous dire comment Dieu a organisé la vie des humains après la mort.
Soyons donc humbles. Le paradis où Dieu nous attend et nous juge à nos actes tous les jours, c’est la Terre. Attendons-nous à ne pas être convoqués devant Dieu dans un ciel hypothétique. Le paradis est ici, avec nous, en nous. Nous nous éteindrons comme une bougie qui a brûlé tout son carburant de cire. Préoccupons-nous de traiter avec bonté, bienveillance et humanité tous les êtres humains ou non humains avec lesquels nous partageons le merveilleux cadeau et mystère de la vie.
Propos recueillis par Egide Nikiza

 Journaliste indépendant et analyste politique, résidant en France, Athanase Karayenga a suivi des formations supérieures dans les universités de Strasbourg et de Bordeaux en France. Il est détenteur d’un Master 2 en Communication, d’un Master 1 en Sociologie, Dominante Démographie et d’une Licence en Journalisme et Techniques de la Communication.
Né à Matana (Bururi) en 1947, sa famille déménagera dans la province de Ngozi, en commune Tangara, quand il avait 10 ans. Dans sa carrière professionnelle, M. Karayenga a été journaliste à la Radio Nationale, Directeur de l’Agence Burundaise de Presse, Directeur Général de la Radio Nationale et Conseiller en Communication du Président Jean-Baptiste Bagaza entre 1976 et 1979. Il a été aussi Directeur de Boneka, une agence de Communication basée à Paris chargée de la promotion extérieure du Burundi.
En plus, Athanase Karayenga deviendra, entre autres, Fonctionnaire à l’UNESCO à Paris et Professeur visiteur à l’Ecole de Journalisme et Communication de Butare de l’Université Nationale du Rwanda et à l’Université Lumière de Bujumbura au Burundi au Département de la Communication.
En tant que Consultant en médias et communication, journaliste d’investigation et analyste politique, Athanase Karayenga a travaillé avec plusieurs médias internationaux, a produit plusieurs émissions de radio et de télévision et a écrit de très nombreux articles pour les médias écrits. Il a également créé et géré des sites internet.
Journaliste indépendant et analyste politique, résidant en France, Athanase Karayenga a suivi des formations supérieures dans les universités de Strasbourg et de Bordeaux en France. Il est détenteur d’un Master 2 en Communication, d’un Master 1 en Sociologie, Dominante Démographie et d’une Licence en Journalisme et Techniques de la Communication.
Né à Matana (Bururi) en 1947, sa famille déménagera dans la province de Ngozi, en commune Tangara, quand il avait 10 ans. Dans sa carrière professionnelle, M. Karayenga a été journaliste à la Radio Nationale, Directeur de l’Agence Burundaise de Presse, Directeur Général de la Radio Nationale et Conseiller en Communication du Président Jean-Baptiste Bagaza entre 1976 et 1979. Il a été aussi Directeur de Boneka, une agence de Communication basée à Paris chargée de la promotion extérieure du Burundi.
En plus, Athanase Karayenga deviendra, entre autres, Fonctionnaire à l’UNESCO à Paris et Professeur visiteur à l’Ecole de Journalisme et Communication de Butare de l’Université Nationale du Rwanda et à l’Université Lumière de Bujumbura au Burundi au Département de la Communication.
En tant que Consultant en médias et communication, journaliste d’investigation et analyste politique, Athanase Karayenga a travaillé avec plusieurs médias internationaux, a produit plusieurs émissions de radio et de télévision et a écrit de très nombreux articles pour les médias écrits. Il a également créé et géré des sites internet.