
Par NDAYISABA Joseph
Professeur à l’Université du Burundi
L’Université du Burundi a de gros avantages sur les autres institutions d’enseignement supérieur : c’est la plus ancienne, elle fournit au pays le gros de ses cadres, elle dispose d’un corps professoral qualifié (55% ont le titre de docteur), mais qui commence à prendre de l’âge (en 2007, 67% des professeurs titulaires avaient 50 ans et plus ! Cf. Etude sur la fuite des cerveaux, UNESCO, 2007). Il n’est pas inutile de rappeler que l’UB est le plus gros fournisseur de professeurs aux universités privées ! Cela comporte des inconvénients certes, mais l’UB devrait aussi en être fière ! Que serait l’UB si elle avait des professeurs dont personne n’a besoin ?
Cette Université fonctionne avec les subsides de l’Etat, elle dispose d’infrastructures, bénéficie de coopérations, aujourd’hui en faible intensité, en espérant que la crise politique prendra fin rapidement pour qu’elles reprennent. En apparence, cette université a ce qu’il faut pour réussir ses missions : dispenser les enseignements, faire de la recherche, et offrir des services à la communauté.
Mais le fait qu’elle soit publique, « gratuite » pour les étudiants, et servie par des fonctionnaires de l’Etat, génère aussi des défis. Le premier, c’est la massification des effectifs, à l’origine de la détérioration des conditions de vie et d’études, en particulier pour les étudiants. Les effets, on les voit notamment dans les auditoires, devenus trop étroits. Des salles de 30 m de long, avec un professeur qui parle sans matériel d’amplification de la voix et qui écrit au tableau noir… En principe dans les normes de construction des salles de classe, l’élève le plus éloigné du tableau noir doit se trouver à 12 m maximum. Au-delà, il faut une acuité visuelle bien au point, surtout que certains d’entre nous professeurs, mettons peu d’ordre dans ce que nous écrivons au tableau.

On peut facilement imaginer les difficultés qu’éprouvent les étudiants assis derrière à suivre les cours, mais aussi les pertes de temps que cela implique pour la prise de notes… puisqu’ils doivent emprunter et reproduire les notes de ceux dont ils supposent qu’ils ont « tout entendu ». Ceci expliquerait peut-être les phrases bizarres qu’on retrouve dans les copies d’examens.
Cette massification, qui implique l’extension des temps de cours et d’évaluation, combinée aux arrêts de cours suite au retard de bourses, aux revendications d’ordre académique… mais aussi avouons-le, au caractère « fonctionnaire » des professeurs, explique les gênantes prolongations des années académiques au-delà du raisonnable.
Par exemple, la promotion qui termine actuellement le BAC III est entrée à l’Université en 2011-2012. Les étudiants de cette promotion viennent donc de faire en 5 ans un BAC qu’on fait en 3 ans. Quand des étudiants dans une telle situation iront solliciter de suivre des Mastères dans d’autres universités, comment vont-ils expliquer une telle anomalie ? Sans oublier que cette situation est un gouffre financier !
Ces étudiants viennent par ailleurs d’avoir gain de cause pour une revendication qui va aggraver la situation, prolonger encore plus les années académiques : les examens en cours de semestre, qui occasionnent des arrêts de cours pour « révision », qui s’ajouteront aux autres arrêts de cours…Quand viendra le moment des évaluations interuniversitaires, envisagées dans le cadre de l’EAC, on aura du mal à expliquer la transgression de standards pourtant bien connus. La normalisation de la durée des années académique doit être prise au sérieux par les autorités de cette institution.
On est en train d’observer actuellement des phénomènes, qui dénotent probablement la perte de confiance envers l’Université du Burundi de la part des parents et des élèves. De moins en moins d’étudiants orientés dans cette université viennent prendre leur inscription : 69% en 2012-2013, 58% en 2014-2015, avec le taux le plus faible de 41% à la Faculté des Sciences. Pour les nouveaux inscrits de 2015-2016, les facultés constatent des chutes d’effectifs de près de 50%.
En plus, l’Université du Burundi compte la proportion la plus faible de filles : 17% en 2014-2015. J’échange souvent avec les étudiants sur cette faible présence de filles : deux raisons reviennent plus fréquemment : ces séjours prolongés à l’UB leur font perdre des années, qui se répercuteraient sur leur niveau d’aspiration pour leurs projets de mariage ! Plus elles « vieillissent », moins elles auraient de prétention sur « la qualité » des prétendants ! La seconde raison évoquée est la « peur du baptême». On ne sait pas dire si ces raisons sont les bonnes, mais elles traduisent un état d’esprit à l’égard de cette institution.
Par ailleurs, ce n’est plus à démontrer, beaucoup de parents qui ont les moyens n’envoient pas leurs enfants à l’Université du Burundi, mais dans des universités privées au pays, au Kenya, en Ouganda, en Inde, mais aussi en Europe, aux États-Unis et au Canada pour les plus fortunés. Ceci comporte bien sûr des risques : des enfants envoyés trop jeunes et qui piquent des crises de dépression…des enfants qui consomment des « bourses » payées par leurs parents et qui n’étudient pas…(les parents l’apprennent souvent trop tard…).
Ces « exils académiques » ont aussi et surtout de gros avantages, pour ceux qui parviennent à décrocher leurs diplômes : ces enfants reviennent bilingues, un avantage important en ce moment de l’intégration au sein de l’EAC. En plus, ils ont appris avec des équipements didactiques et informatiques les plus modernes, ils sont donc plus intéressants pour les opérateurs économiques privés (qui recommenceront à embaucher quand la crise prendra fin, et si nous nous abstenons à en provoquer d’autres). Cependant, ils devraient aussi intéresser le Gouvernement. Ce n’est pas impossible que ce soit eux qui sauvent le pays, lorsqu’ils constitueront une masse critique, capable de tirer la qualité de nos cadres vers le haut.
Sur le moyen et long terme, le choix du Gouvernement de « démocratiser » l’entrée à l’UB va desservir les étudiants, en termes de possibilités de mobilité académique, mais aussi et surtout en termes d’accès à l’emploi, surtout que les postes de « fonctionnaires » de l’Etat vont se réduire ou devenir de moins en moins intéressants en raison des bas salaires. Il est en train de venir le moment d’une féroce compétition pour l’accès aux emplois, le moment où la maîtrise de l’anglais et de l’informatique constitueront des conditions premières pour postuler à un emploi, où le fait de militer dans un parti politique ne garantira pas aux lauréats de nos universités « la priorité » d’accès à un emploi « décent ». C’est surtout triste de constater que les étudiants sont incapables de comprendre ces évolutions, se contentant d’avantages immédiats, et en plus, font des revendications qui risquent d’aggraver leur situation, comme évoqué plus haut.

Qu’en est-il des niveaux de réussite de nos étudiants ? Il est très faible, comparé à celui des universités privées. D’après un bilan effectué à l’issue de la première année de mise en œuvre du BMD, nous avons constaté, contrairement aux attentes, que ce système n’a pas amélioré les taux de réussite. On ne s’entend pas avec les étudiants sur les raisons de leurs faibles performances.
Les professeurs évoquent le faible niveau des étudiants, les prérequis insuffisants, particulièrement au niveau de la langue française (c’est hélas une réalité : il nous arrive souvent de passer près d’une heure sur une copie, à essayer de comprendre ce que l’étudiant veut dire. C’est très éprouvant !), le manque d’assiduité pour les études, visibles à travers les absences aux cours… Bref, et comme d’habitude, l’étudiant qui échoue, c’est lui le responsable.
Les étudiants expliquent cette différence des taux de réussite à l’UB et dans le privé par « la largesse » avec laquelle les étudiants du privé sont notés, surtout par nous les professeurs de l’UB, « terriblement sévères » envers ceux de l’UB. Ils nous reprochent nos méthodes d’enseignement archaïques (Cf. leur récent mémorandum sur les revendications au sujet des « évaluations continues ». Il paraît qu’on veut les obliger à changer, alors que nous, on ne veut pas bouger de nos pratiques !).
Ils expliquent aussi leurs échecs par les conditions de vie et de travail précaires (externat, logements incompatibles avec une vie d’étudiants, alimentation insuffisante, trop longues distances entre les résidences et les campus, pas d’argent pour aller dans les cyber… Il n’est pas facile d’établir le niveau d’impact de ces conditions sur les performances des étudiants. Un étudiant dont nous avons dirigé le mémoire il y a deux années, a essayé de comparer les taux de réussite des étudiants internes et les externes de la Faculté de Psychologie. Son hypothèse a été infirmée. Lui croyait fermement que les internes étaient plus performants.
Il faut néanmoins admettre que des difficultés, les étudiants en ont. Ils sont externes dans leur grosse majorité (67%) et il n’est pas impossible qu’elles aient un effet négatif sur les taux de réussite. Pour ce qui concerne les conditions de logement et l’alimentation, il faut saluer ici les capacités d’adaptation des étudiants : beaucoup n’ont pas de parents à Bujumbura pour les loger. Ils louent à 4, 5, 6 ou 7 un logement, entre 30.000 et 70 000 Fbu selon les déclarations d’un étudiant dans ce cas. Pour la nourriture, ils essayent de manger à un coût le plus bas possible : ceci veut dire une nourriture peu énergétique, 2 ou 1 seul repas par jour…Signalons aussi qu’un gros effectif d’étudiants suivent leurs cours au campus Mutanga, et Nyakabiga, le quartier voisin, était devenu leur capitale, pour le logement et l’alimentation. Une multitude de petits restaurants étaient disponibles à côté du campus. Mais depuis que Nyakabiga est sur la liste des quartiers « insurgés », il n’est plus aussi aisé d’y accéder.
Pour certains, les parents aident en leur fournissant soit quelques kilos de riz ou de haricots, un sac de charbon, un régime de bananes…Certains administrateurs communaux, conscients de l’impossibilité pour leurs étudiants de vivre à Bujumbura, mobilisent des sponsors parmi les ressortissants, qui payent un loyer pour un ou plusieurs étudiants…Sans ces aides, plusieurs étudiants ayant réussi l’examen d’Etat abandonneraient leurs études. Ce n’est d’ailleurs pas impossible qu’il y ait des cas dans cette situation.
Un problème particulier se pose pour les jeunes filles, qui face à ces difficultés de vie au quotidien, ne résistent pas aux avances de prétendus bienfaiteurs (pour les déplacements et autres appuis, intéressés). Des étudiants citent plusieurs cas de grossesses chez ces enfants, qui évidemment, compromettent leurs études.
Avant de clôturer cet article, un clin d’œil aux étudiants, qui se font piéger par une des « facilités » que permet le système BMD : le libre choix du parcours académique. Si un étudiant échoue, ne valide pas un ou deux unités d’enseignement, il peut être autorisé d’avancer de classe, quitte à reprendre les cours concernés plus tard.
Résultat : des étudiants arrivent en BAC III, et se retrouvent avec des unités non validées en 1ère ou en 2ème année. Aller suivre des cours avec des bambins de 1ère année les répugnent, et ils revendiquent (avec insistance) de passer seulement les examens sans suivre les cours ! Ils doivent apprendre à faire des choix raisonnés, et à assumer les effets de ces choix. Ils ont la possibilité de choisir de valider toutes les unités avant d’avancer de classe ! Le parcours rectiligne de l’ancien système est toujours bien ancré dans leur cerveau. Il est aussi possible que ce soit la peur de perdre la bourse qui les amène à préférer avancer avec ces « dettes ».













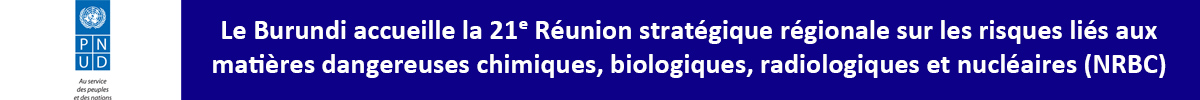







Tres bonne analyse cher Joseph. Mais un souuci: l’amphiteatre Ntahokaja et ses occupants qui illustre ton article est plutot aux 3/4 vide et donc pas archicomble. On voit meme certains etudiants se plaire derriere, a plus de 12 metres du professeur. Ont ils une acuite visuelle superieure a la moyenne?
Je ne vois pas pourquoi on ne laisserait pas les étudiants qui le souhaitent de passer les examens sans qu’ils soient obligés d’aller suivre les cours. Les cours sont faits pour aider les étudiants á réussir leurs examens, mais au niveau universitaire, je considères que la présence en amphi ne devrait pas être obligatoire. Si les étudiant sont capables de préparer les examens et le réussir sans passer par l’amphi, trés bien pour eux. Il y a deux choses qui devraient rester obligatoires: les TP et les séminaires.
Au Canada, au Québec, 3 absences, tu es dehors. Un cours non-réussi doit être repris, et si échoué une seconde fois, on te sort du programme.